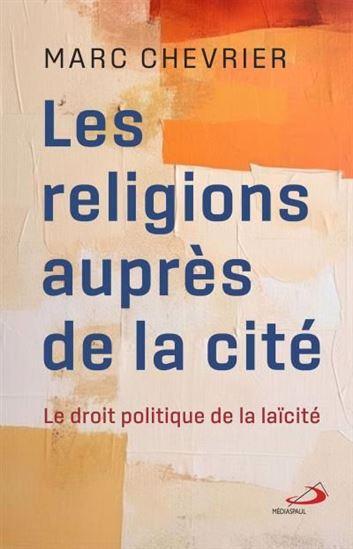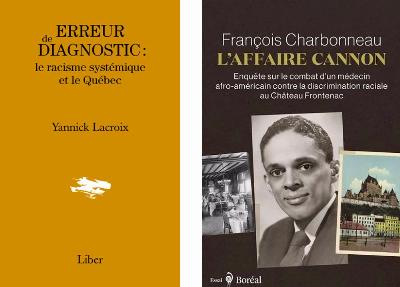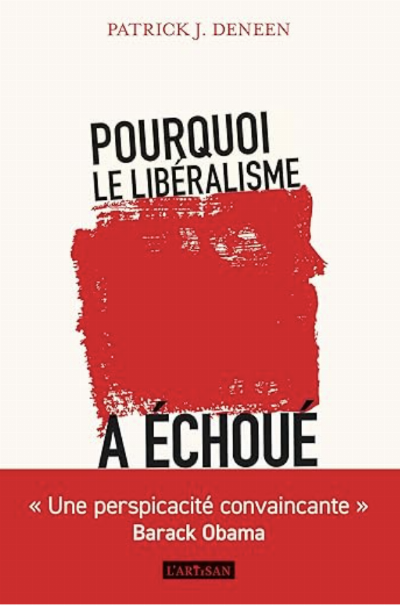Le Léviathan sanitaire
Le Léviathan, tel s’appelle l’État conçu par Thomas Hobbes au milieu du dix-septième siècle. Pendant la pandémie, cet animal à plusieurs têtes s’est comporté selon sa première raison d’être : assurer la sécurité des citoyens, fût-ce par des méthodes draconiennes. Mais même en temps normal, cet État polycéphale continue sa politique première, fondée sur la protection assurantielle contre les risques de l’existence. Sous le protectorat social du Léviathan sanitaire, les libertés individuelles (de choix) gagnées contre la nature pour assurer le confort de l’ego prennent le pas sur l’indépendance personnelle et les solidarités premières.
On a beaucoup écrit que la pandémie de la covid-19 a jeté le monde dans une épreuve inédite ; or, par bien des aspects, les mesures d’exception que les États ont prises précipitamment pour endiguer la contagion et en mitiger les ravages auprès de leur population n’ont pas conféré aux pouvoirs publics des rôles si inhabituels. Les États accomplissent ainsi la raison d’être principale pour laquelle le pouvoir moderne a vu le jour : conserver la vie de ses ressortissants et donc adopter au besoin les dispositions draconiennes nécessaires, si attentatoires aux libertés qu’elles paraissent.
À partir de la Renaissance, les penseurs ont tenté d’établir le pouvoir sur des bases plus fermes que la grâce chrétienne ou que la subtile sagesse des Anciens, qui cherchaient à définir le meilleur régime politique, dérivé de rares et difficiles vertus humaines. Terrorisé par le désordre social où les guerres de religion avaient jeté l’Angleterre, le philosophe Thomas Hobbes imagina un savant système qui devait mettre fin à toute vaine discussion sur les fondements de l’autorité. Pour Hobbes, le pouvoir érigé en État nanti de la souveraineté reposait sur la peur de la mort et des souffrances que subiraient des individus laissés à leur liberté naturelle, fautrice de violence et de rapines[1]. Plutôt que de vivre dans cette liberté primitive qui les condamne à une existence brutale et misérable, les hommes préféreraient s’en défaire et remettre à un État omnipotent leur puissance naturelle, lequel imposerait sa loi et la paix civile indispensable à la vie de tous.
 Hobbes conçoit ainsi la création de l’État comme un renoncement et un transfert qui se justifient par « la sécurité de sa personne, de sa vie et des moyens de la préserver de telle sorte qu’elle ne lui soit pas insupportable[2]. » De même, Hobbes avait compris qu’outre la peur de la mort, l’appétit pour les plaisirs de l’existence et une vie confortable conduirait aussi les humains à l’obéissance au pouvoir, sinon à une grande docilité. Il écrit : « Le désir d’une vie facile et de la volupté sensuelle dispose les humains à obéir à une puissance commune, parce que celui qui éprouve de tels désirs renonce à la protection qu’il pouvait espérer retirer de son activité et de son travail[3]. » L’État protecteur qui garde dans sa main la vie de ses sujets s’augmente dès lors de l’abandon de leur indépendance. Il devrait prendre le nom de Léviathan, ce dragon à plusieurs têtes en forme de serpent dont il est question dans plusieurs livres de l’Ancien Testament. Allusion qui prêtait aussi à ambiguïté, puisqu’elle laissait entendre que l’État tenait de la monstruosité, de l’impiété et du mal, en vue un jour d’être terrassé par la justice divine.
Hobbes conçoit ainsi la création de l’État comme un renoncement et un transfert qui se justifient par « la sécurité de sa personne, de sa vie et des moyens de la préserver de telle sorte qu’elle ne lui soit pas insupportable[2]. » De même, Hobbes avait compris qu’outre la peur de la mort, l’appétit pour les plaisirs de l’existence et une vie confortable conduirait aussi les humains à l’obéissance au pouvoir, sinon à une grande docilité. Il écrit : « Le désir d’une vie facile et de la volupté sensuelle dispose les humains à obéir à une puissance commune, parce que celui qui éprouve de tels désirs renonce à la protection qu’il pouvait espérer retirer de son activité et de son travail[3]. » L’État protecteur qui garde dans sa main la vie de ses sujets s’augmente dès lors de l’abandon de leur indépendance. Il devrait prendre le nom de Léviathan, ce dragon à plusieurs têtes en forme de serpent dont il est question dans plusieurs livres de l’Ancien Testament. Allusion qui prêtait aussi à ambiguïté, puisqu’elle laissait entendre que l’État tenait de la monstruosité, de l’impiété et du mal, en vue un jour d’être terrassé par la justice divine.
Or, ce Léviathan polycéphale devait, à l’époque de Hobbes, accomplir des tâches somme toute limitées, si on les compare à celles que nous remettons d’emblée à l’État dans les sociétés développées. Sa principale fonction consistait en la police, pour garantir aux citoyens la sûreté de leurs biens et de leur personne, alors que trop pauvre en moyens pour voir à la santé et à l’éducation, il confiait ces dernières à l’Église et à la charité des notables et des seigneurs. Il eût même paru inconcevable que pour le soin des maux de l’âme et la protection contre les aléas de l’existence du berceau au tombeau, on s’en remette à quelques officines publiques. Mais les sociétés ont bien changé depuis le 17e siècle tumultueux où Hobbes voyait son Léviathan toiser la multitude humaine, tenant d’une main l’épée, et de l’autre, la crosse, symbolisant pour la première le pouvoir civil et la deuxième, le magistère religieux. Le but premier du pouvoir n’est plus le maintien de l’ordre, comme l’a remarqué Bertrand de Jouvenel dans son fameux essai publié en 1945, Du pouvoir. Pressés par leurs populations éprouvées par les guerres et par les crises économiques, les États ont fini par assumer de nouvelles responsabilités en vue de garantir un protectorat social[4], qui pourvoit à tous les besoins de l’individu que désormais la famille et l’économie privée ne peuvent plus satisfaire. L’État s’érige alors en providence de substitution, à la faveur de l’effritement des croyances religieuses et de la diffusion de l’individualisme rationaliste, qui rend concevable une action publique tentaculaire, dispensatrice de programmes et de services voués au bonheur et à l’aisance de populations instruites et conscientes de leurs droits.
L’apparition de la santé publique comme discipline et comme ambition politique des États a métamorphosé aussi bien la nature de leur intervention dans la société que la vision de la vie et de la sécurité humaines. Comme l’a noté Didier Tabuteau dans un texte publié en 2009, à partir du XVIIIe siècle la médecine est devenue une discipline qui, s’aidant de la statistique et de l’expérience clinique, cherche à normaliser toutes les dimensions de l’existence humaine[5]. L’État s’est appuyé sur elle pour réglementer le travail, le logement, l’urbanisme, l’industrie, l’alimentation, assurer la salubrité des lieux publics, veiller à la santé des populations et prévenir les risques que certains comportements feraient subir au bien-être physique et moral de l’individu. Tout à la volonté de contrôler les déterminants biologiques et sociaux de la santé, la médecine aux ordres des États n’a eu de cesse de reconnaître de nouveaux risques auxquels s’exposent les individus dans une société sous l’emprise de la technique, risques qui justifient alors d’autres remèdes ou de nouvelles prises en charge bureaucratisées aiguillant le mal-portant vers le bon service. Or, des épisodes d’épidémie, comme le SRAS en 2002 et 2003, ont poussé nombre d’États à renforcer leur législation sanitaire, leur conférant des pouvoirs d’exception — dont ils se sont d’ailleurs prévalus pour affronter la covid-19. Mais Tabuteau y décèle là une tendance inquiétante, qui favorise « l’hypertrophie du Léviathan sanitaire », qui se nourrit d’une « politique de précaution exclusivement mue par le refus du risque[6] » et d’un sentiment généralisé de peur, que la science et l’information, loin de calmer, exacerbent — tel que l’illustre aujourd’hui la couverture médiatique anxiogène de la covid-19. Du reste, la rhétorique belliqueuse que plusieurs gouvernements ont employée pour combattre la pandémie, comparant leur mission à une guerre contre un ennemi invisible, réactive l’imaginaire hobbesien du pouvoir ; comme l’a souligné la sociologue argentine Maristella Svampa, ce discours martial a plus à voir avec la peur qu’avec la solidarité entre citoyens[7].
L’essor de la santé publique n’explique pas à lui seul l’avènement du Léviathan sanitaire. Pour en comprendre la logique sous-jacente, il faut saisir son principal dispositif technique, soit l’assurance. En réalité, l’État-providence s’est construit sur l’extension du mécanisme de l’assurance à tous les aléas de l’existence, chômage, maladie, invalidité, indigence, perte d’autonomie en raison de l’âge, accidents de la route, faute civile, pour en protéger l’individu, quoi qu’il fasse de sa vie ou quoi qu’il lui arrive. Cette logique assurantielle a accompagné l’expansion des technologies en tous domaines, notamment la reproduction, si bien que l’infertilité ou l’indisponibilité d’un fournisseur de gamètes passent pour des formes d’invalidité admissibles à l’assurance maladie publique. Ainsi s’est tissé un pacte entre l’État et l’individu, si bien que le premier promet au second une gamme grandissante de libertés de choix matérialisée par les avancées de la technique, alors que le second se décharge sur le premier du soin de réparer ses erreurs, ses manquements et ses turpitudes. Cet « empire de la liberté », comme l’a nommé aux États-Unis le critique du libéralisme Patrick Deneen, a uni un État centralisé et invasif à un individu affranchi de toute limite découlant de la nature ou la société[8]. D’une certaine manière, pour produire de l’État, il faut créer de l’individu, et vice-versa. Cette union pousse l’individu à se dégager de toute obligation à l’égard de la famille dont il est issu ou qu’il a fondée, l’État assurantiel ayant à charge la responsabilité de prendre sous son aile les enfants négligés ou mal traités, les conjoints défaillants ou violents, ainsi que les vieillards abandonnés par leurs proches ou sans ressources. L’État agit dès lors in absentia parentis, remarque Deneen, plutôt que d’appuyer de manière subsidiaire les familles et les petites communautés, présumées incapables d’envelopper l’individu de leurs liens solidaires. De la sorte, le principe assurantiel va croissant : toute autre déficience avérée dans l’individu ou dans la famille suscite une nouvelle police protectrice.
Or, que l’individu se love ainsi dans les multiples mains que lui tend l’État protecteur est concevable grâce à la vision libérale de l’autonomie qui s’est diffusée largement dans les sociétés ; elle insiste plutôt sur l’interdépendance et la circulation des individus dans les systèmes sociosanitaire et économique que sur l’indépendance et la fidélité aux communautés de proximité. L’autonomie libérale se conjugue aussi avec « un refus de toute dépendance naturelle [9]», c’est-à-dire de toute subordination entre les adultes, notamment entre les sexes et entre les époux, la seule dépendance admise étant celle, transitoire, qui lie l’enfant à ses parents. Cependant, la liberté gagnée contre les obligations naturelles se paie d’une dépendance démultipliée à l’égard de l’assistanat étatique instauré justement pour favoriser la liberté d’autodétermination de l’individu, conditionnée en fait par la disponibilité de l’aide standardisée qu’il trouvera en dehors de sa famille et de son milieu immédiat. L’interdépendance libérale, qui va croissant avec la spécialisation du travail, repose donc sur une solidarité de type formelle, légale et organisationnelle dont l’État déploie la mécanique complexe par ses multiples agences et services. Dans ce vaste système intriqué souvent conçu comme un « réseau » sans véritable commandement, des professionnels, des techniciens et des prestataires de soins, chacun à son poste, répondent de la vie, de la santé, de la probité et de l’épanouissement d’individus qui ont accoutumé de tourner leurs besoins, leurs doléances et leur mal-être vers un dispensaire universel financé par le trésor public.
Au cours des dernières années, le Léviathan sanitaire a considérablement perfectionné son dispositif assurantiel. Il a étendu sa couverture à la protection contre les angoisses de l’existence, notamment en généralisant le « droit » à « l’aide médicale à mourir », ou à la « mort assistée », qui préserve l’individu inquiet de sa fin d’avoir à souffrir une longue et pénible agonie et qui flatte en lui sa volonté, jusqu’à contrôler le moment et les modalités de son trépas. Dans certains pays, par souci de mieux maîtriser un commerce illicite et les effets de la prise de stupéfiants sur la santé publique, on a légalisé la consommation de cannabis, à des « fins récréatives », comme on le répète innocemment au Québec, manière de dire que désormais l’État assumera collectivement l’accès aux « paradis artificiels », quoi qu’il en coûte aux individus qui en deviendraient dépendants. Au nom de la lutte contre les discriminations, l’État a également instauré une foule de lois et de programmes pour lutter contre les préjugés, changer les mentalités, voire contrôler les états mentaux de ses citoyens, notamment les pensées, les sentiments et les propos qui blesseraient l’estime et l’image de soi, ainsi que la dignité des groupes et des minorités historiquement désavantagés et frappés par de lourdes stigmatisations. Et voilà que les progrès de la pharmacologie nous promettent de nouveaux traitements contre les traumas émotionnels provoqués par les ruptures amoureuses. L’État sanitaire pourra donc distribuer bientôt des pilules contre le chagrin d’amour[10].
Bref, le Léviathan assurantiel vise non plus la paix de l’âme, mais le confort de l’ego, qu’il s’agisse de franchir les étapes de l’existence ou d’assumer son identité, sociale, ethnique ou sexuelle, vis-à-vis de celle des autres. D’une certaine manière, il nous protège contre l’altérité même de la vie ou d’autrui, en abaissant incessamment en l’individu le seuil de tolérance à l’imprévu, au danger, à l’infortune, à la souffrance et à l’imperfection. Si la volonté est postulée souveraine dans l’individu hyperassuré, ses ressources morales, son intériorité et sa faculté de redressement sont réputées nécessiter, pour leur part, un assistanat palliatif que prodiguent les divers thérapeutes du système sociosanitaire. En ce sens, la lutte contre la pandémie de la covid-19, loin de marquer une exception dans les tâches du Léviathan sanitaire, le reconduit dans ses fonctions de grand ordonnateur du confort égotique. Et même, elle le confirme dans son rôle essentiel, servir de solution générale à la peur de vivre. C’est d’ailleurs pourquoi l’optimisme, plutôt que l’espérance, est de rigueur dans les sociétés contemporaines. En effet, elles placent leur foi dans les succès des sciences thérapeutiques et dans l’éthique du droit individuel que réconcilie un Léviathan au visage rassurant qui susurre aux oreilles de ses ayants droit : ça va bien aller.
[1] Thomas Hobbes, Éléments de la loi, Paris, Allia, 2006, p. 129-131.
[2] Thomas Hobbes, Léviathan, Paris, Gallimard, 2000, p. 235.
[3] Ibid., p. 189.
[4] Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, Hachette, 1972, voir le dernier chapitre « Ordre ou protectorat social ».
[5] Didier Tabuteau, « Santé et liberté », Pouvoirs, 130, 2009, p. 98.
[6] Ibid., p. 103.
[7] Maristella Svampa, « Pasajes hacia la incertidumbres (II). Reflexiones para un mundo post-coronavirus », Conversación sobre la Historia, 1er mai 2020, en ligne : https://conversacionsobrehistoria.info/tag/leviatan-sanitario/ .
[8] Patrick J. Deneen, Why Liberalism failed, Yale University Press, 2018, p. 108.
[9] Yves Charles Zarka, Figures du pouvoir, Paris, Presses universitaires de France, 2001, p. 100.
[10] Florence Méréo, « La pilule contre le chagrin d’amour arrive bientôt en France », Le Parisien, 13 février 2019, en ligne : http://www.leparisien.fr/societe/la-pilule-contre-le-chagrin-d-amour-arrive-en-france-13-02-2019-8011425.php .