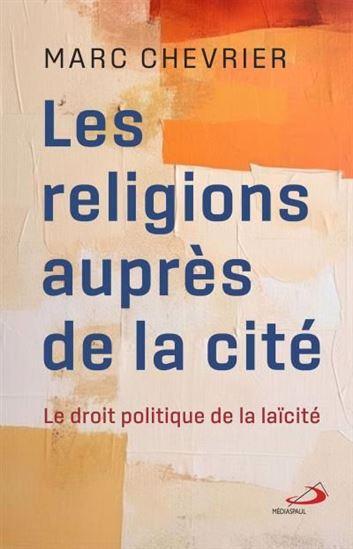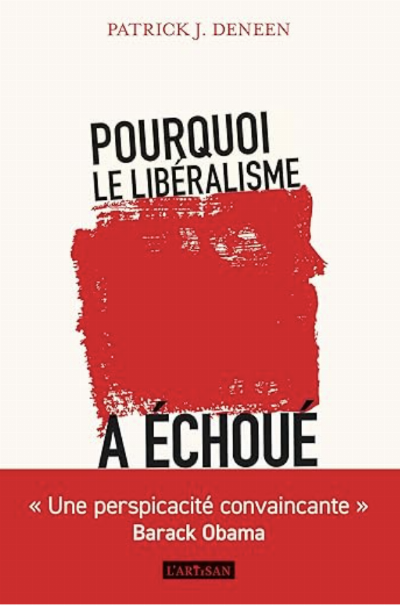Le racisme imaginaire
À propos des ouvrages de Yannick Lacroix, Erreur de diagnostic (Liber, 2025) et de François Charbonneau, L’affaire Cannon (Boréal, 2025)

Deux essais de déxintoxication intellectuelle. Autant le premier [livre] frappe par la sobriété efficace de sa démonstration, autant le second captive le lecteur ébahi par une espèce d’exubérance narrative qui le plonge dans le fascinant combat d’un médecin noir américain contre l’exclusion raciste que lui et sa femme ont subie au Château Frontenac, à Québec, en août 1945
Or, deux ouvrages récemment parus viennent, chacun à sa manière, jeter un pavé dans la mare de l’autoflagellation systémique. Deux ouvrages qui, différents par le style et la méthode, se complètent à l’avenant. Autant le premier, celui du professeur de philosophie, Yannick Lacroix, frappe par la sobriété efficace de sa démonstration, autant l’autre, celui du professeur de science politique, François Charbonneau, captive le lecteur ébahi par une espèce d’exubérance narrative qui le plonge dans le fascinant combat d’un médecin noir américain contre l’exclusion raciste que lui et sa femme ont subie au Château Frontenac, à Québec, en août 1945. Voyons ce que Lacroix et Charbonneau ont à dire.
Le racisme systémique, concept « inutile et incertain »
Contre ceux qui d’un ton péremptoire soutiennent que le racisme systémique est un fait indiscutable, même au Québec, et qu’il ne reste qu’à trouver les remèdes adéquats, le professeur Lacroix répond qu’au contraire, il y a matière à débat. Le concept de racisme systémique, intimidant par sa tournure savante, est loin de fournir selon l’auteur un outil utile et probant pour expliquer les disparités socioéconomiques observables entre les individus définis par leurs caractéristiques raciales. Ce concept procède d’une « erreur de diagnostic » et s’avère donc « inutile et incertain », pour reprendre les mots fameux dont Pascal avait jadis affublé Descartes. Ces mots ne sont cependant pas ceux du professeur Lacroix, qui place son travail de débroussaillage théorique sous le patronage de Baruch Spinoza et de Thomas Hobbes. En quelques courts chapitres consacrés à cette notion confondante, il en montre le caractère vague, instable, indéterminable, sophistique, arbitraire, superfétatoire, indémontrable et réducteur. Or, selon Lacroix, ce n’est certes pas la première fois que circulent dans la sphère intellectuelle des idées dénuées de valeur scientifique, comme celles de réification et d’aliénation. Toutefois, le racisme systémique, aussi vain que celles-ci, s’en distingue néanmoins par le fait que les gouvernements et une foule d’organismes l’invoquent pour justifier des réformes substantielles de la société. D’où la nécessité d’en vérifier rigoureusement la validité.
La méthode de Lacroix est simple : il part des définitions données du racisme systémique par divers organismes, tels que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ), la Ligue des droits et libertés ou le gouvernement de l’Ontario, etc. Le racisme systémique désigne un fourre-tout englobant, qui recoupe des réalités invisibles et involontaires, et qui expliquerait, en raison de l’interconnexion de tout phénomène avec un autre, toutes les disparités observables entre les groupes racialement définis. Quiconque s’aventurait à nier le caractère « systémique » du racisme, notamment s’il appartient à la « majorité blanche » suspecte, sera aussitôt accusé, comme le fait sans détour la CDPDJ, d’entretenir par ses dénégations ce phénomène rampant dont aucun ne peut s’extirper, sauf à entreprendre des réformes radicales des institutions. Ainsi, souligne Lacroix, le concept de racisme systémique sert une ambition révolutionnaire d’ingénierie sociale, dont la CDPDJ ne fait pas de mystère, au point de réclamer l’application de programmes de discrimination positive et le suivi de formations obligatoires pour la société. Toutefois, la notion de racisme systémique, devenue tellement élastique qu’elle recoupe toute la réalité sociale, n’ajoute, sur le plan analytique, rien de plus à la notion déjà usitée en droit du travail de « discrimination systémique », que les tribunaux peuvent constater sans exiger la preuve que l’employeur a formulé des intentions discriminatoires.
Une analyse causale déficiente
Lacroix démonte le raisonnement simpliste qui considère tout écart entre une minorité ethnoraciale et la majorité sur un indicateur quelconque comme la preuve que cette minorité subit un préjudice causé par une forme de racisme larvé et souterrain.
Lacroix ne rejette pas l’idée, tant s’en faut, d’élucider les inégalités socioéconomiques entre les groupes racialement définis par des facteurs autres que les normes institutionnelles et les intentions individuelles. Encore faut-il savoir considérer tous les facteurs explicatifs de ce qui semble une disparité désavantageuse pour un groupe ethnoracial. Le problème est que les organismes défendant la systématicité du racisme présupposent, sans aller plus loin dans l’analyse causale, que le racisme est le facteur unique et déterminant des inégalités ethnoraciales, peu importe qu’il s’agisse de chômage, d’emploi précaire, d’arrestations policières, de délinquance, de décrochage scolaire, de diplomation, d’accès au logement. Lacroix démonte le raisonnement simpliste qui considère tout écart entre une minorité ethnoraciale et la majorité sur un indicateur quelconque comme la preuve que cette minorité subit un préjudice causé par une forme de racisme larvé et souterrain. Or, estime Lacroix, on ne peut sauter aussi vite à une telle conclusion. Si, par exemple, les minorités visibles paraissent sous-représentées dans la fonction publique municipale, notamment dans la hiérarchie, c’est que celles-ci, plus récemment installées dans la société, ont un âge médian plus jeune, alors que les blancs, plus âgés, ont progressé davantage dans leur carrière. De même, la doctrine du racisme systémique est souvent aveugle aux variations à l’intérieur d’un même groupe ethnoracial, comme celles qui existent entre Arabes et Noirs. Notons qu’un écart de revenu significatif sépare les femmes des hommes noirs, les premières se débrouillant mieux sur le marché du travail que les deuxièmes. Cet écart se comprend entre autres choses par la diplomation plus élevée des femmes noires et par leur choix de carrière, privilégiant les emplois dans les services publics. Lacroix n’exclut pas pour autant que la discrimination raciale puisse expliquer une part des disparités observables. Cependant, au vu d’une foule de facteurs comme l’âge, le statut familial, la scolarité, le lieu de résidence, l’origine ou le statut migratoire, on s’aperçoit que la variable raciale influe à peine sur le revenu ; pour les femmes immigrantes noires, cette variable leur donnerait même un avantage de 3 % sur l’ensemble des travailleuses de même statut.
Mais pourquoi alors cette insistance à vouloir expliquer les disparités intergroupes par le racisme ? En accord avec l’économiste Thomas Sowell, critique de l’idéologie progressiste, Lacroix estime que la théorie du racisme systémique pose une fausse alternative, à savoir que les inégalités intergroupes trouvent leur origine uniquement dans deux causes principales, soit le postulat de l’infériorité de certaines minorités, soit la discrimination généralisée. La première cause, intenable, étant écartée, on se rabat sur la deuxième, comme le font Robin DiAngelo dans White Fragility et Ibram X. Kendi selon Lacroix. Ces intellectuels accusent souvent les institutions en place de reproduire les inégalités, comme si elles en étaient la cause, alors que, dans le cas des communautés immigrantes, ces disparités s’étaient souvent déjà formées dans leur pays d’origine. De plus, les institutions dégagent des contraintes pour tous, comme exiger la détention d’un brevet pour la profession enseignante, un fardeau qui pèse aussi bien sur les nouveaux arrivants que sur les gens du lieu. Le concept de racisme systémique, bien loin d’illuminer la compréhension des facteurs à l’origine des inégalités intergroupes, s’avère en somme un éteignoir conceptuel.
Un concept inutilisable et peu pertinent pour le Québec
En lisant l’Éthique de Spinoza qui avait eu de belles intuitions sur le ressort affectif des rapports entre les groupes humains, Lacroix montre qu’en théorie, le racisme possède trois acceptions : il est soit une idéologie prônant une hiérarchie des races, soit une attitude, qui engage l’affect et l’entendement, et qui prédispose à aimer ou à déprécier les individus selon leur appartenance raciale, soit, enfin, un système. Il est clair que devant le déclin, en Occident, des deux premières formes de racisme, les idéateurs du racisme systémique ont jeté leur dévolu sur le racisme système, qui comporte l’avantage de définir le racisme en dehors de toute intentionnalité ou psychologie humaine. Désormais, le racisme sera rattaché à une cause en apparence objective, soit le passé colonial et l’esclavagisme, qui continueraient à agir à travers l’histoire jusqu’à corrompre encore le présent. Cependant, lier consubstantiellement le racisme à l’Occident blanc moderne occulte le fait, d’une part, qu’il n’a ni inventé l’esclavage, ni été le seul, parmi les autres cultures et civilisations, à le pratiquer, ainsi que le fait, d’autre part, que le racisme prospère entre les non-Blancs. Au surplus, la volonté de définir un racisme sans racistes fait l’impasse sur la tendance universelle des êtres humains « à catégoriser les gens en fonction de leur groupe », tendance qui ne constitue pas en soi du racisme, mais qui peut y conduire, et ce dans n’importe quelle communauté humaine. Les intellectuels parlant de racisme systémique auront beau imaginer une structure engendrant, telle une machine, un racisme non intentionnel, ils ne peuvent s’empêcher de réintroduire l’attitude humaine, donc la psychologie des membres de l’institution, dans leur compréhension du racisme systémique. On aboutit dès lors, comme dans le plan d’action de l’Ontario, à des formulations contradictoires, illisibles, produisant du pur « non-sens ».
Bon prince, Lacroix n’écarte cependant pas la possibilité que le racisme système acquière un sens plausible si l’on entend par là, en songeant aux États-Unis, aux effets intergénérationnels de l’esclavage, qui persisteraient, malgré son abolition, et continueraient donc d’hypothéquer les Noirs par rapport aux Blancs. Quoi que l’on pense de cette théorie, elle ne trouve aucune pertinence pour le Québec, où rien d’équivalent à l’esclavagisme américain n’a été instauré et n’a pu produire de tels effets intergénérationnels handicapants. S’il est concevable que les Autochtones aient subi des effets discriminants comparables à ceux impactant les Noirs américains, ce fait ne justifie guère d’éclairer la condition des immigrants, noirs, maghrébins et latino-américains, par la notion de racisme systémique. Les esclaves noirs que le Québec a connus dans un passé reculé étaient trop peu nombreux pour constituer des groupes endogamiques stables dans le temps, et la grande majorité des populations noires du Québec, installée depuis un demi-siècle, provient de pays comme Haïti et n’a pas subi un « racisme d’État ». Que des organismes publics au Québec postulent l’existence d’un tel racisme illustre, selon Lacroix, une profonde méconnaissance des réalités québécoises, sinon une indifférence à la trajectoire sociohistorique du Québec qu’aggrave la propension de ces organismes à se perdre dans des « abstractions intemporelles », tel le concept vaseux de « contrat racial », et à pelleter des nuages de « doléances préfabriquées », selon les mots de Sowell, importées des États-Unis.
Bref, le racisme systémique est tellement inutilisable que les institutions sérieuses qui se sont prononcées sur des conflits ethnoraciaux lui ont préféré celui, plus maniable, de discrimination systémique. Ce qu’a fait, souligne Lacroix, le juge Viens dans le rapport qu’il a remis en 2019 sur les relations entre les Autochtones et les services publics au Québec. La notion de discrimination systémique s’est développée en droit pour cerner les effets indirects préjudiciables de normes neutres et générales sur des groupes défavorisés ou historiquement discriminés. Il n’empêche que cette idée est également problématique, selon Lacroix, puisque dans le discours des juges, notamment ceux de la Cour suprême, les effets indirects discriminatoires sont présumés par le droit, et non causalement établis par une preuve scientifique. Une preuve que les programmes d’égalité, de diversité et d’inclusion (EDI) disent détenir, sur la base des tests de cognition implicite, qui permettraient prétendument de mesurer les préjugés inconscients étant à l’œuvre dans les relations interraciales. Toutefois, même ces tests ne fournissent aucune preuve solide d’une causalité effective entre certaines associations que le cerveau humain ferait à l'égard des groupes ethnoraciaux et des comportements discriminatoires. Ces associations observées en laboratoire n’équivalent guère à des biais ou à des préjugés inconscients, encore moins à du racisme, ce qu’ont fini par reconnaître les concepteurs de ce test. De plus, les corrélations entre ces associations mentales et les comportements discriminatoires sont très faibles sur le plan statistique (r = .14). Les spécialistes de la question ne s’entendent pas non plus sur ce que ces tests peu fiables mesurent exactement, ceux-ci engendrant aux yeux de plusieurs des « fantômes cognitifs ». Le plus ironique est que les personnes les plus sensibilisées aux injustices raciales « échouent » à ces tests et affichent de « fortes préférences raciales » à l’encontre des Noirs. En somme, ces tests mesureraient des chimères « causalement inertes. »
Une meilleure explication, la théorie de la ségrégation
Outre la déficience de preuve causale, la théorie de la discrimination systémique souffre de formuler une conception de la justice indéfendable selon les standards de la philosophie libérale. En effet, elle critique les effets inégaux de normes neutres sur les groupes ethnoraciaux, en supposant que la distribution des biens et des charges doit prendre comme unité de mesure les groupes et non les individus. C’est là une entorse frontale aux principes du libéralisme qu’avait soulignée Elizabeth Anderson dans son ouvrage The Imperative of Integration qui a proposé une explication des inégalités raciales évitant le concept de racisme, surchargé de sens et galvaudé. Lacroix recourt à la théorie d’Anderson pour réfuter la prétention de la CDPJP suivant laquelle ceux qui rejetteraient le racisme systémique tourneraient le dos à l’histoire des Afro-Américains. Au contraire, on peut la comprendre sans devoir mobiliser la notion de racisme, à laquelle Anderson préfère celle de ségrégation, susceptible de prendre plusieurs expressions : légale, spatiale, communautaire, culturelle. La thèse d’Anderson est que c’est la ségrégation en elle-même qui engendre préjugés, stigmatisations et puis discriminations, et non l’inverse, c’est elle qui engage une minorité comme les Noirs américains, même quand la ségrégation a cessé d’exister en droit, dans une dynamique préjudiciable. Vivant séparément dans leurs univers et leurs quartiers, cantonnés à certains emplois, les Noirs profitent en moyenne moins bien du capital social dont dispose la majorité blanche, qui évolue dans son propre monde aux occasions d’avancement social multiples. Cette séparation persistant dans le temps finit par induire des préjugés, des stéréotypes qui assignent aux groupes ethnoraciaux des traits culturels stigmatisants qui justifient aux yeux de plusieurs des inégalités dont on ne s’étonne plus. Pour briser cette spirale causale, il faut un remède : l’intégration, c’est-à-dire éliminer tous les obstacles et les barrières, physiques et mentales, qui empêchent les groupes de se mêler, d’interagir et d’échanger les biens sociaux.
L’intégration, note cependant Lacroix, a bien mauvaise presse, car elle est souvent confondue avec l’assimilation. Mais pour l’auteur, elle est « un processus d’acclimatation mutuelle entre la majorité et les minorités » qui joue dans les deux sens, si bien que la première doit s’adapter aux autres, comme ces dernières à celle-ci. Elle vise non pas l’effacement du minoritaire dans le substrat majoritaire, mais la pleine participation de ce dernier à la chose publique, libre de barrières invisibles. La mise en contact des communautés les unes avec les autres éliminera peu à peu les vieux préjugés créés par la ségrégation, préjugés qu’entretient toutefois le fractionnement multiculturaliste de la communauté politique en mini-sociétés parallèles entre lesquels les biens et capitaux sociaux circulent mal. De saines politiques d’intégration, note Lacroix en accord avec Anderson, peuvent s’accompagner de mesures de discrimination positive modérées, à cela près qu’elles évitent les « solutions extrêmes », comme ces quotas d’embauche fixés d’après des critères ethnoraciaux qu’imposent les politiques EDI dans les universités et d’autres organisations. En somme, ces politiques nourrissent par leurs remèdes la cause de ce qu’elles prétendent corriger, soit la ségrégation intercommunautaire.
Lacroix estime que l’antiracisme contemporain se conjugue avec un « antinationalisme principiel », qui exècre la possibilité même qu’il y eût, par-delà la juxtaposition des communautés ethnoraciales, une communauté politique plus large qui soit source de solidarités communes. Ce n’est donc pas un hasard si la « montée en popularité de la théorie du racisme systémique coïncide avec la mise en minorité démographique du “référent francophone blanc” » à Montréal, où plusieurs organismes municipaux ont répercuté cette théorie. Celle-ci sert à disqualifier l’idée même que la société soit l’héritière d’un héritage culturel et que les groupes minoritaires trouveraient leur profit à se l’approprier par l’intégration, à laquelle concourt également la majorité en se rapprochant de ceux-ci. À rebours de ce que proclame la CDJPJ, Lacroix considère que le racisme systémique constitue une « notion délétère qui fragilise le tissu social » et qui fomente, au fond, un projet politique, sous des airs faussement savants. En fermant l’ouvrage de Lacroix, on se demande s’il ne serait pas temps que l’Assemblée nationale du Québec, par l’une de ses commissions, se penche sur les étranges préconisations de la CDJPJ.
Le racisme n’est pas là où vous croyez
L’antiracisme contemporain cède aussi à l’esprit d’abstraction, comme l’a relevé Lacroix en citant Gabriel Marcel, qui voit le monde et les êtres à travers des abstractions qui tournent sur elles-mêmes sans s’attacher à la réalité concrète des individus et des sociétés, tel l’espace-temps québécois, dont se moquent les défenseurs du concept de racisme systémique. Or, un ouvrage inattendu vient justement de prendre le contrepied de cet esprit d’abstraction, par le récit d’une histoire à la fois belle, touchante et instructive, racontée sous la forme d’un suspense documentaire signé par le politologue François Charbonneau, fin connaisseur de l’histoire politique américaine et des minorités françaises au Canada. Son essai, L’affaire Cannon, sert un démenti ébouriffant à l’idée qu’il y aurait, depuis longtemps, un racisme structurel qui mine la société québécoise. Examinons l’affaire.
Tout commence avec une chronique du journaliste Jean-François Nadeau publiée dans Le Devoir le 8 juin 2020, intitulée « Le Château. » Cette parution intervient quelques jours après la mort atroce de George Floyd, un citoyen afro-américain arbitrairement arrêté et maintenu au sol jusqu’à la suffocation. La diffusion par vidéo de cette arrestation policière crée une onde de choc dans les opinions publiques, aux États-Unis et par-delà. Détenteur d’un doctorat en histoire, Nadeau essaie de montrer qu’un « système d’exclusion raciale informel » existerait depuis fort longtemps au Québec et continuerait de produire aujourd’hui ses effets sur les Noirs québécois. Pour le prouver, il raconte une affaire survenue en août 1945 au château Frontenac, à Québec, en 1945. Un médecin américain, George D. Cannon, et sa femme, Lillian Moseley, parce qu’ils étaient noirs, se firent refuser l’accès à la salle à manger de l’hôtel où ils avaient pourtant loué une chambre. Le couple ne se laissa pas démonter et intenta une poursuite en dommages-intérêts devant un tribunal de Québec. Le 6 août 1945, le couple remporta une première manche dans sa bataille contre le Château, bien que Nadeau n’en dise guère plus, car ce qui l’intéresse, c’est de chercher noise à tous les « petits et gros Zemmour locaux » qui agiteraient « le spectre d’un pseudoracisme anti-blanc » pour dénier la réalité du racisme qui affligerait encore la communauté noire au Québec. Nadeau reproche aussi aux Québécois d’avoir indûment tiré à eux « une partie de la douleur noire » en osant comparer leur combat pour l’émancipation nationale avec la « lutte noire américaine. »
Lecteur fidèle du chroniqueur Nadeau, Charbonneau a le sentiment que quelque chose cloche dans cette relation. Il lui apparaît peu plausible que dans un hôtel devant appartenir à des intérêts anglo-saxons, l’ordre d’exclure le couple Cannon-Moseley de la salle à manger eût pu provenir d’un subalterne franco-québécois. Comme le dit Charbonneau, « jamais un Canadien français, employé de la Canadian Pacific Railway Company, n’aurait osé à l’époque approcher un client américain de sa propre initiative pour lui demander de quitter la salle à manger » parce que celui-ci aurait une peau de pigmentation foncée. Tout le livre de Charbonneau consiste à montrer que la conclusion que Nadeau décrète dans son texte, soit l’existence d’un système d’exclusion racial informel au Québec, est infondée, puisque la vraie histoire de l’affront infligé au couple Cannon-Moseley est tout autre.
Dans un article publié en 1948 sur le Canada français par la correspondante de la revue Harper’s à Montréal[...] on apprend que le médecin Cannon avait reçu de nombreux appels de Québécois pour l’inviter à dîner chez eux. L’exclusion prononcée contre le couple s’expliquait par « l’influence pernicieuse américaine », puisque la direction de l’hôtel aurait décidé de barrer l’entrée au couple Cannon-Moseley, à la suite de plaintes formulées par des clients américains.
La lecture fortuite d’un article publié en 1948 sur le Canada français par la correspondante de la revue Harper’s à Montréal, Mariam Chapin, décida Charbonneau à se lancer dans une recherche de quatre ans, riche en rebondissements, rencontres, déconvenues et découvertes jubilatoires. Dans cet article, la journaliste américaine rapporta l’incident survenu au château Frontenac ; on y apprend que le médecin Cannon avait reçu de nombreux appels de Québécois pour l’inviter à dîner chez eux. De plus, la journaliste note que les Canadiens français n’avaient pas de « préjugés en ce qui a trait aux personnes de couleur. » L’exclusion prononcée contre le couple s’expliquait par « l’influence pernicieuse américaine », puisque la direction de l’hôtel aurait décidé de barrer l’entrée au couple Cannon-Moseley, à la suite de plaintes formulées par des clients américains. Alors que Nadeau conclut en 2020 à la permanence du racisme au Québec à partir de cette exclusion d’août 1945, la journaliste américaine, en 1948, s’était avisée plutôt que « l’absence de préjugés de couleur a longtemps été une vertu du Canadien français. »
Charbonneau ne se contente pas de ce premier démenti de la thèse de Nadeau. Il remue les fonds d’archives, les bibliothèques, multiplie les rencontres avec les quelques survivants qui auraient pu connaître de loin ou de près les Cannon-Moseley, et se déplace même aux États-Unis, pour tenter de reconstituer la trame historique de cet événement et la vie du médecin George Cannon et de son épouse. Charbonneau finit par mettre la main sur l’autobiographie, non publiée, du médecin. Car il n’est pas n’importe qui. Outre un médecin d’exception par son parcours professionnel, il fut également l’une des figures de proue de la cause noire américaine « dans la première partie du XXe siècle avant Martin Luther King. » Cette autobiographie contient une mine d’or de renseignements qui confirme les observations de Chapin sur l’incident d’août 1945 et révèle l’ampleur du combat que le médecin Cannon a mené contre l’exclusion raciale. Charbonneau donne à sa reconstitution une profondeur convaincante en cherchant à corroborer et à documenter ce que Cannon dit de sa vie comme de la condition noire aux États-Unis. Quasiment la moitié de l’ouvrage établit le portrait de George et de sa femme, qui a droit à un chapitre distinct. Il brosse du médecin et militant Cannon un tableau touchant, généreux, parfois poignant, qui révèle la lutte d’un combattant contre la maladie et toutes les avanies, les exclusions, les limitations qu’un racisme encore omniprésent, notamment dans la profession médicale de son temps, sème sur la voie de Cannon.
Le portrait chevaleresque d’un médecin engagé
Tout le prédestinait à se faire le chevalier de la liberté et de la santé accessible pour la communauté afro-américaine. Issu « d’une longue lignée d’Afro-Américains libres depuis le XVIIIe siècle » par son père, George Cannon naquit au New Jersey et suivit la voie de ce dernier, médecin de renommée et défenseur de la cause noire. La tuberculose obligea George à interrompre ses études ; il perdit un poumon, séjourna deux ans dans un sanatorium, au début de la Grande Dépression. Pour payer ses études, il multiplia les petits boulots, placier, porteur de valises, en soutenant un rythme de travail qui « dépasse l’entendement », note Charbonneau. Cannon se dévoua très tôt au traitement de la tuberculose, qui frappait plus sévèrement les Afro-Américains. Cannon finit par commencer sa pratique médicale à Harlem en 1937, dans des conditions difficiles, où la ségrégation raciale sévissait encore dans les hôpitaux new-yorkais, y compris contre les médecins noirs refoulés dans les établissements moins prestigieux ; en 1943, il réussit par être admis à un hôpital juif new-yorkais. Cannon eut cette formule saisissante « la tuberculose est au Noir du Nord ce que la corde à lyncher est au Noir du Sud. »
Le médecin comprit tôt que son indépendance farouchement gagnée lui conférait un statut unique, qui lui procurait la liberté de s’engager pour la santé et les droits civiques des Noirs américains. Ainsi, entre 1937 et son voyage à Québec, il s’investit dans toutes sortes de causes, de comités et d’associations pour promouvoir l’égalité raciale, dans l’armée, dans les institutions et auprès des associations médicales restées hostiles aux médecins noirs. Désolé de voir que les Noirs fussent « habitués à mourir », il compta parmi les promoteurs les plus actifs de services de santé publics. Il n’en fallait pas plus pour que les autorités américaines le soupçonnent de « communisme » et demandent au FBI de constituer un dossier sur sa personne entre 1940 et 1960, encore qu’il ait été de connivence avec les communistes américains, devenus des « champions de l’égalité raciale. » Tel était l’homme qui se vit refuser avec sa femme l’entrée dans la salle à manger du château Frontenac au début d’août 1945, alors que le couple avait pu s’y restaurer sans encombre en croyant y vivre un séjour de délassement auprès du majestueux Saint-Laurent.
Une poursuite inédite
Charbonneau raconte ensuite la saga judiciaire, inédite pour l’époque, qui s’enclencha. La décision d’exclure le couple avait été prise par le directeur adjoint de l’hôtel, un certain George-J. Jessop, après que le directeur de l’établissement sous propriété d’intérêts anglo-saxons eut reçu des plaintes de clients américains offensés d’avoir eu à côtoyer des Afro-Américains. On intima même au couple de rester dans leur chambre pour se nourrir. Profondément indigné, Cannon chercha aussitôt à attaquer l’hôtel en justice, il réussit même à obtenir deux ordonnances de la Cour supérieure contre le Château pour le forcer à les réadmettre lui et sa femme dans la salle à manger, grâce au sympathique et bien nommé avocat Édouard Laliberté, avec lequel Cannon se liera d’amitié. L’amitié du médecin et de son épouse, qui avait choisi Québec comme destination de vacances par amour de la langue française, s’étendra à une bonne part de la ville de Québec, que l’affaire, ébruitée dans les médias de l’époque, passionna. Les Cannon-Moseley reçurent de nombreuses marques de sympathie de la population locale, outrée par l’intolérance dont ils avaient été frappés, ce qui n’a pas échappé à l’attention du Time qui a fait écho à l’affaire à la fin d’août 1945. Le reportage du magazine américain donna un rayonnement inespéré à la cause Cannon-Moseley, au prix du congédiement d’un employé francophone de l’hôtel qui avait eu le malheur de se réjouir ouvertement de la fortune judiciaire du couple.
L’amitié du médecin et de son épouse, qui avait choisi Québec comme destination de vacances par amour de la langue française, s’étendra à une bonne part de la ville de Québec, que l’affaire, ébruitée dans les médias de l’époque, passionna. Les Cannon-Moseley reçurent de nombreuses marques de sympathie de la population locale, outrée par l’intolérance dont ils avaient été frappés,
Charbonneau a buté sur plusieurs difficultés pour reconstituer les archives judiciaires de cette affaire, dont le refus inexplicable de Bibliothèques et Archives Canada de livrer au chercheur détective l’essentiel du dossier qui avait appartenu au bureau d’avocats représentant le Château. On apprend que George Cannon et le Château avaient convenu d’un arrangement à l’amiable, au terme duquel celui-là obtiendrait une compensation financière et la garantie que l’hôtel « n’exercerait aucune discrimination à l’encontre des personnes de couleur en tant que telles. » Il est malaisé d’établir si ce règlement a mis définitivement fin à la ségrégation raciale, qui s’était, hélas !, pratiquée dans plusieurs hôtels du Canada. Charbonneau constate toutefois que la cantatrice Marian Anderson, qui s’était déjà butée sur la ségrégation dans des hôtels canadiens pendant ses tournées, reçut en 1946 au Château Frontenac un traitement royal et rencontra le premier ministre de l’époque, Maurice Duplessis. On découvre aussi l’émouvante lettre publiée en français en septembre 1945 dans les médias de Québec où George Cannon dit toute sa gratitude à la « population française de Québec », qui « a voulu nous faire savoir que nous étions bienvenus dans leur ville, et que les préjugés de race ne dépendent pas d’eux, mais sont le fait d’étrangers. »
François Charbonneau administre une telle preuve que le discours sur le racisme systémique au Québec s’effondre, de même que les accusations gratuites qui en procèdent, qui incrimineraient une nation entière, présumée entretenir un racisme latent. L’auteur donne une leçon de rigueur et de méthode à tous ceux qui invoquent l’histoire pour lui faire servir une cause, et qui, sans souci des faits et de l’expérience réelle des peuples, intentent à ces derniers un procès moral. Ce faisant, au rebours d’un certain antiracisme nourri au ressentiment, Charbonneau oppose à la déconstruction compulsive une vertu oubliée dans les universités — l’admiration — que l’auteur voue aussi bien à Cannon, chevalier exemplaire de la cause noire américaine, qu’à tous ceux qui l’ont appuyé, depuis son avocat roublard jusqu’aux bonnes gens de Québec.
La carrière de Cannon après 1945 n’est pas moins captivante : Charbonneau nous apprend que le médecin de Harlem s’est inquiété de ce que les universités américaines commencent à imposer des quotas d’admission pour les Noirs au moment même « où l’on tente de les abolir dans les autres universités. » Si Cannon dénonce « la montée en puissance du ressentiment blanc », il est stupéfait de voir les militants noirs « opposer la société blanche et la société noire. » Au sujet de cette nouvelle pratique de discrimination qui privilégie le recrutement sur la base de la couleur, au « mépris délibéré des capacités individuelles », Cannon eut ces mots à méditer : « C’est le Ku Klux Klan à l’envers. »