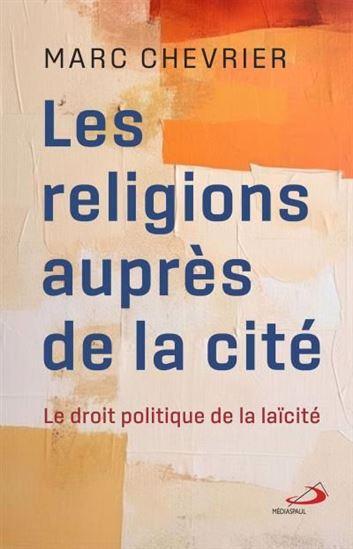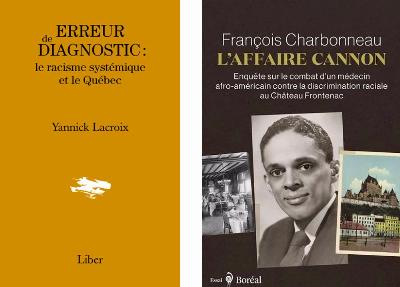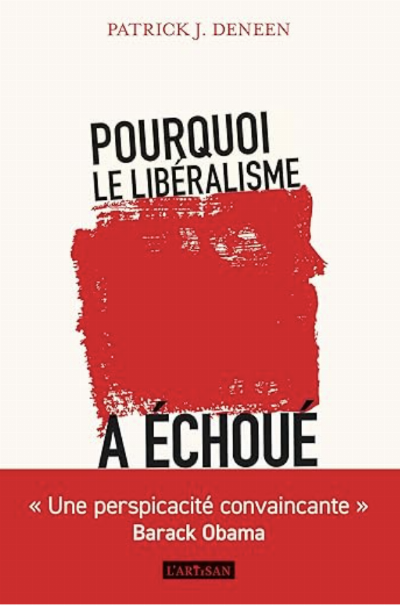La France et son parlement empêché
Là où en Europe, on voit un président élu côtoyer un premier ministre responsable devant la chambre nationale, comme en Finlande, au Portugal et en Autriche, on a dû se résoudre à limiter ou à abaisser la fonction présidentielle pour consolider l’autorité du premier ministre. La France a suivi le chemin inverse, soit empêcher son parlement, et donc son premier ministre, pour conserver la grandeur et l’immunité présidentielles.

La réouverture, en grande pompe, de Notre-Dame de Paris le 7 décembre dernier, plus de cinq ans après l’incendie qui en avait dévoré les entrailles et fait s’effondrer la flèche édifiée selon les plans de Viollet-le-Duc, a fait resplendir la France meurtrie par cette catastrophe et aujourd’hui ragaillardie par la reconstruction spectaculaire de la cathédrale chantée par Victor Hugo. Le président de la République française, Emmanuel Macron, à son meilleur dans les fastes cérémonieux de la commémoration et de la solidarité nationale, a touché les dividendes d’un pari, il faut en convenir, audacieux, soit la restauration à l’identique de Notre-Dame, en cinq ans. Cependant, si le monde entier avait les yeux braqués sur le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump, assis au premier rang aux côtés de Brigitte Macron et de quelques figures des royautés européennes, les médias n’ont pas manqué de rappeler que cette réouverture majestueuse cachait à peine les misères de la Ve République, qui venait de perdre, quelques jours auparavant, son gouvernement. Il s’agissait de celui de Michel Barnier, renversé par une motion de censure le 4 décembre, après seulement 89 jours en fonction, ce qui en fait le gouvernement le plus éphémère qu’ait compté la Ve République française.
Depuis la naissance de cette république en octobre 1958, le curieux régime qui en est sorti a soulevé un problème de classification. Car ce régime combine deux logiques difficiles à concilier. Tout d’abord, le présidentialisme, qui met au centre du jeu politique un monarque républicain, élu directement par le peuple français à partir de 1965 ; puis le parlementarisme, qui offre au président qui surplombe les institutions le renfort d’un premier ministre responsable, avec son gouvernement, devant la députation nationale. Il est acquis qu’en régime parlementaire, le président ou le monarque constitutionnel s’efface devant le premier ministre, qui est à la fois le chef du parti majoritaire ou dominant à la chambre et le chef effectif du gouvernement. Rien de tel en France ; sauf en période de cohabitation le privant d’une majorité à l’Assemblée nationale, le président exerce les prérogatives les plus éminentes du gouvernement et ravale le premier ministre au rôle d’intendant, qui donne forme aux volontés présidentielles. Ce système, appelé « semi-présidentiel », maintient au sommet de l’exécutif deux têtes concurrentes, mais inégales en autorité.
Cependant, la formule que certains publicistes ont avancée, le « parlementarisme empêché[1] », qualifie mieux ce système déroutant. Le premier élément d’empêchement réside dans la nature du mandat confié au président de la République en France. Censé voir à la continuité de l’État et agir hors de l’influence des partis, le président échappe à tout contrôle, à toute censure parlementaire. Il est irresponsable politiquement. Or, dans un régime parlementaire, si puissant que devienne le premier ministre, il exerce sa magistrature sous la vigile constante de la chambre élue, s’exposant à la critique, et parfois, à la censure de l’opposition. En France, les débats à l’Assemblée nationale et au Sénat transpirent quelque chose d’irréel. Les partis d’opposition visent, à travers la critique du gouvernement présent en chambre, un grand absent, le président, qui lui n’y apparaît jamais et ne répond à aucune de leurs questions, sauf quand il lui chante d’orchestrer une entrevue télévisée. Ce qui dévalue le travail parlementaire et diminue la stature du parlement face à un prince sacré par l’onction populaire qui ne rend de comptes à personne. Le seul moment où le président comparaît devant les parlementaires, c’est à l’occasion du discours qu’il peut décider, de son propre chef, de prononcer devant tous ces derniers réunis, députés et sénateurs, requis de se déplacer en congrès à Versailles. Par cet exercice de discours-spectacle, le président lie sa déclaration solennelle pour se retirer aussitôt après de la scène, en laissant ensuite les parlementaires en discuter, sans lui, et sans pouvoir voter sur ce qu’ils ont entendu. Depuis que cette procédure de la déclaration présidentielle a été introduite en 2008, les présidents Sarkozy et Hollande y ont recouru une fois chacun, et le président Macron, plus soucieux de sa mise en scène égotique, deux fois.
Un régime parlementaire confie normalement le choix du premier ministre aux forces partisanes existantes en chambre à la suite des élections ou de la chute du gouvernement. Le président ou le monarque constitutionnel se contente de ratifier le candidat issu de ces forces et qui s’avère apte à diriger un gouvernement majoritaire ou viable à l’assemblée. En France, la nomination du premier ministre étant la prérogative du président, celui-ci ne laisse guère les forces politiques à l’Assemblée pourvoir le poste de chef du gouvernement, ainsi qu’on l’a vu au lendemain des élections législatives françaises de l’été 2024 ou plus récemment, le 13 décembre, avec la nomination de François Bayrou comme premier ministre, issu d’un parti allié au parti présidentiel. Un président français nomme son premier ministre tel un magicien sortant un lapin de son chapeau.
Hors France, une fois un premier ministre aux commandes, il reste en poste jusqu’à ce qu’il perde la confiance du parlement ou de son parti ; le président ou le monarque constitutionnel n’intrigue pas en coulisse pour le démettre de ses fonctions. À l’inverse, en France, un premier ministre, même en symbiose idéologique avec le président, s’expose continûment au risque d’être relevé de ses fonctions, bien que le président de la République ne puisse formellement le forcer à démissionner. Cependant, son autorité est telle qu’il obtient aisément la démission des premiers ministres dont il ne veut plus, tel un enfant se lassant d’un jouet devenu ennuyeux ou encombrant. On pense en particulier au cas d’Élisabeth Borne, dont Emmanuel obtint le congédiement pour rajeunir son gouvernement en nommant le trentenaire Gabriel Attal en janvier 2024, comme au cas d’Édouard Philippe, premier ministre de mai 2017 à juillet 2020, remplacé par Jean Castex. Par ailleurs, dans un régime parlementaire fonctionnel, le premier ministre est souvent chef de parti, et doit son ascension à l’autorité qu’il exerce sur ce dernier. Les premiers ministres en France sont fréquemment des technocrates, avec plus ou moins d’expérience parlementaire, que le président désigne pour l’assister et non pour lui faire ombrage.
On observe qu’en régime parlementaire, le premier ministre est maître du calendrier électoral et peut, librement ou à certaines conditions, déclencher des élections anticipées. Le président français, maître des horloges, décide de la dissolution de l’Assemblée nationale, avec pour seule contrainte d’attendre un an avant de prononcer une autre dissolution. Si le scrutin législatif anticipé aboutit à une majorité défavorable au président en place, celui-ci conserve néanmoins son poste, alors qu’ailleurs, un premier ministre défait aux élections démissionne. Il est d’ailleurs amusant de penser que le Président vient de nommer, en remplacement de Michel Barnier, le centriste François Bayrou, lequel, plus jeune, prônait la démission du président de la République en cas de défaite de son parti aux élections législatives, ce que Macron a refusé de faire après le désaveu essuyé aux législatives de l’été 2024[2].
Autre élément de comparaison : la stabilité des partis, qui clarifie l’offre électorale et les prépare à l’exercice du pouvoir. En France, depuis 1958, les partis se créent et se défont incessamment, soumis aux luttes intestines que provoquent les ambitions présidentielles des uns et des autres, prêts à former leur propre véhicule électoral, comme le fit d’ailleurs Emmanuel Macron quand il était ministre du président Hollande, en créant ex nihilo en 2016 le mouvement En Marche, fer de lance de sa candidature aux présidentielles de 2017.
Enfin, la constitution de la Ve république prévoit des mécanismes profitant à l’exécutif, conçus pour brider les pouvoirs des parlementaires, dont le fameux article 49.3, qui permet au premier ministre de forcer l’adoption d’un texte législatif à moins que l’Assemblée nationale, saisie d’une motion de censure dans les vingt-quatre heures, ne retire sa confiance au gouvernement. La censure adoptée par cette assemblée le 4 décembre dernier et celle d’octobre 1962 votée contre le gouvernement de Georges Pompidou demeurent des événements rares qui attestent, non la prééminence du Parlement français, mais sa dépendance structurelle à l’égard d’un chef d’État irresponsable et invisible en chambre. Là où en Europe, on voit un président élu côtoyer un premier ministre responsable devant la chambre nationale, comme en Finlande, au Portugal et en Autriche, on a dû se résoudre à limiter ou à abaisser la fonction présidentielle pour consolider l’autorité du premier ministre. La France a suivi le chemin inverse, soit empêcher son parlement, et donc son premier ministre, pour conserver la grandeur et l’immunité présidentielles. Peut-être que le président Macron, sorti affaibli de la dissolution malavisée qu’il a ordonnée le 9 juin 2024, devra se résoudre à ce que son nouveau premier ministre, François Bayrou, devienne le capitaine véritable de l’exécutif, si le centriste et maire de Pau, petite commune des Pyrénées françaises non loin de Lourdes, parvient à s’imposer et à se maintenir au pouvoir au-delà d’une saison.
[1] Voir notamment Michel Soudais, « La faute du Conseil constitutionnel », Politis, 15 avril 2023, en ligne : https://www.politis.fr/articles/2023/04/la-faute-du-conseil-constitutionnel/ ; de même Alexis Fourmont, « Et si on abolissait le ministère des Relations avec le parlement? », FigaroVox, 20 mars 2024, en ligne : https://www.lefigaro.fr/vox/politique/et-si-on-abolissait-le-ministere-des-relations-avec-le-parlement-20240320 .
[2] « Quand François Bayrou prônait la démission du président de la République en cas de défaite aux législatives », Le Figaro, 15 décembre 2025, en ligne : https://www.lefigaro.fr/politique/quand-francois-bayrou-pronait-la-demission-du-president-de-la-republique-en-cas-de-defaite-aux-legislatives-20241215 .