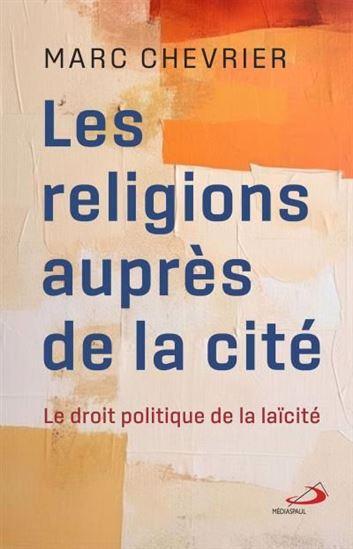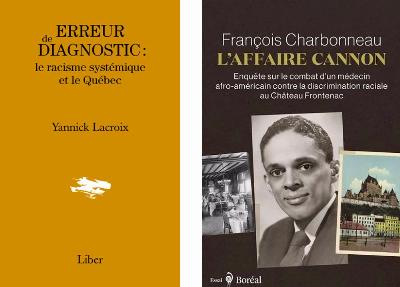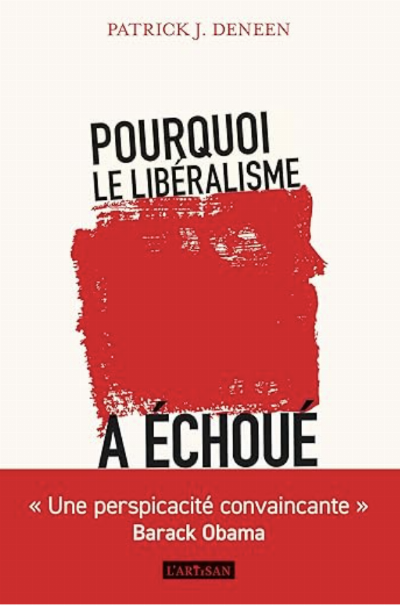Les élections britanniques et françaises de 2024 en miroir
Deux élections législatives ont ébranlé l’Europe au début de l’été 2024, celles du 4 juillet pour renouveler la Chambre des communes britannique et celles des 26 et 27 juin, ainsi que des 6 et 7 juillet pour regarnir l’Assemblée nationale française. Dans les deux cas, il s’est agi de scrutins anticipés.
Au Royaume-Uni, le premier ministre en poste, Rishi Sunak, avait déclenché des élections estivales, dans l’espoir d’éviter le désastre, après plus de 14 années de gouverne conservatrice depuis mai 2010, qui a vu défiler plusieurs premiers ministres, dont Liz Truss et Sunak après la démission calamiteuse de Boris Johnson en juillet 2022, lequel avait pourtant remporté un succès éclatant aux élections de 2019. En France, sitôt annoncés les résultats des élections européennes le 9 juin 2024, qui enregistrent la progression du Rassemblement national à 31,4 % des voix, le président français, Emmanuel Macron, à la surprise générale, a dissous sans tarder l’Assemblée nationale. Ces élections inattendues, qui ont semblé répondre à un caprice du président ou à de mauvais calculs, ont retenu largement l’attention des médias, en jetant dans l’oubli le scrutin britannique, néanmoins riche d’enseignements. Comparons ces deux scrutins à partir de quelques chiffres, les deux pays utilisant un système de type majoritaire, à la différence qu’en France, il suit deux tours, le deuxième mettant en lice les candidats qui ont obtenu au moins 12,5 % des voix, mais sans avoir gagné une majorité absolue au premier tour dans leur circonscription, parmi les 577 que compte le pays.
Retour des travaillistes aux commandes, mais sans triomphe réel
33,7 %, c’est le pourcentage des voix que le parti travailliste dirigé par Keith Starmer a remporté et qui lui a assuré une confortable majorité parlementaire de 411 sièges, soit plus de 63 % des 650 disponibles aux communes. Pourtant, avec une proportion similaire obtenue au premier tour des législatives françaises, soit 33,2 %, la liste menée par Jordan Bardella du Rassemblement national a récolté, à l’issue du deuxième tour, seulement 143 sièges, soit à peine 24 % de la députation du Palais Bourbon. De première force politique qu’elle était après les élections européennes et le premier tour des législatives, la liste du Rassemblement national et de ses alliés venus d’une frange dissidente du parti Les Républicains (LR), s’est trouvée reléguée en troisième position à l’Assemblée, après le Nouveau Front populaire (NFP), qui coalise des partis de gauche de toutes tendances, et la liste centriste proche du président, conduite par le premier ministre sortant, Gabriel Attal. Mais comment un même niveau d’appui électoral peut-il engendrer des résultats aussi différents dans les deux pays ? L’explication en provient pour une bonne part des effets des modes de scrutin utilisés dans ces pays.
Au Royaume-Uni, les élections législatives n’ont qu’un tour, les votants ne peuvent donc revenir sur leur choix. Pour gagner les élections, un parti doit remporter à la seule majorité simple, dans chacune des circonscriptions de la carte électorale, le plus de sièges possible, sans devoir obtenir une majorité absolue dans chacun d’eux. Il suffit que ses candidats dépassent en nombre de voix les autres candidats, comme c’est aussi l’usage aux États-Unis, au Canada (Québec compris). La conséquence de ce système est qu’il donne au parti vainqueur des élections un pourcentage des sièges qui excède, parfois de beaucoup, celui des voix exprimées. La plupart du temps, un parti affiche une grosse majorité parlementaire, grâce à une simple minorité de voix sur le plan électoral. On observe ainsi au Royaume-Uni de même qu’au Canada une tendance à porter au pouvoir des partis élus par de faibles minorités électorales, inférieures à 40 % des suffrages totaux. Rappelons que le travailliste Tony Blair a réussi à se faire réélire en 2005 à la tête d’un gouvernement majoritaire avec aussi peu que 35,2 % des voix exprimées au pays. Au Canada, en 1997, le libéral Jean Chrétien décroche un mince gouvernement majoritaire avec 38 % des voix aux élections fédérales, et en 2011, le conservateur Stephen Harper obtient un gouvernement majoritaire un tantinet plus conséquent avec un peu moins de 40 % des voix. Au Québec, en 2018, la Coalition Avenir Québec a raflé de même une majorité parlementaire avec à peine 37,4 % des voix exprimées.
En réalité, la victoire des travaillistes de juillet 2024 n’a rien d’éclatant. Le parti a amélioré son score par rapport aux élections de 2019 de 1,7 % seulement, une faible marge que les Britanniques appellent le « swing » pour désigner les mouvements de l’électorat d’une élection à l’autre. Starmer doit sa confortable majorité aux communes à la division du vote chez les conservateurs. Le scrutin majoritaire accorde au parti victorieux d’importantes majorités parlementaires quand paradoxalement le vote des citoyens incline à se porter sur de tiers partis nombreux, ce qui est arrivé le 4 juillet. Les conservateurs de Sunak ont pâti de l’irruption d’un concurrent à leur droite, le Reform UK de Nigel Farage, dont plusieurs des candidats ont capté des voix utiles qui normalement seraient allées aux conservateurs. Face à des forces divisées, des candidats travaillistes l’ont emporté avec parfois de faibles marges, même dans des circonscriptions réputées favorables aux torys. De plus, les travaillistes ont profité de l’effondrement de l’appui au Scottish National Party, parti indépendantiste qui avaient éclipsé le Labour en Écosse depuis les élections générales de 2015. Le concurrent idéologique le plus immédiat des travaillistes, les libéraux-démocrates, a augmenté sa performance d’assez peu pour se maintenir à la troisième place de l’échiquier politique, ce qui a aussi ménagé le Labour. Les travaillistes récoltent également les fruits de leur repositionnement programmatique sous l’impulsion de Starmer qui a compris, à l’instar de Tony Blair, que le Labour ne peut conquérir le pouvoir en s’éloignant du centre, ce qu’avait fait néanmoins le chef précédent, Jeremy Corbyn, plus radical et soupçonné d’antisémitisme, qui avait conduit ses troupes à deux échecs électoraux cuisants.
Un retour aux basses eaux politiques d’avant le Brexit
En réalité, les résultats des élections britanniques de juillet 2024 ont ramené le pays dans la dynamique politique qui existait avant le Brexit. Celui-ci a divisé les Britanniques, et trois élections ont gravité autour de cet enjeu, celles de 2015, 2017 et 2019, qui ont donné deux gouvernements minoritaires conservateurs dirigés par Theresa May et un gouvernement majoritaire qui a porté en triomphe Boris Johnson, lequel, sitôt élu, mit fin à l’imbroglio juridico-parlementaire où le référendum de juin 2016 avait jeté le royaume par le vote, en mars 2020, d’une loi actant le retrait britannique de l’Union européenne. Seule la question de l’Irlande du Nord continuera d’embêter les conservateurs de Johnson par la suite, en raison des craintes de ses alliés nord-irlandais de voir l’union de leur territoire avec l’Angleterre entravée par des frontières douanières découlant du protocole négocié avec l’Union européenne pour fluidifier les flux entre les deux Irlande. (D’ailleurs, le Sinn Fein nord-irlandais a bien performé en juillet 2024, avec 7 députés, qui ne siègeront toutefois pas aux communes, par refus de prêter le serment d’allégeance au roi requis par la loi. Les unionistes du DUP ont pour leur part perdu des députés [3 sur 8]).
Les élections générales tournant autour du Brexit avaient polarisé la population, au bénéfice des deux grands partis, qui chacun incarnait un camp, les Brexiters d’un côté, les Remainers, de l’autre. Par exemple, aux élections de 2017, les conservateurs et les travaillistes décrochent ensemble plus de 82 % des voix, en 2019, plus de 75 %. En revanche, aux élections de 2024, le Brexit cessant d’être un enjeu, bien qu’on ait discuté de ses conséquences, le « duopole » des deux partis n’obtient que 57,4 % des voix, tandis que la participation électorale baisse de plus de 7 points par rapport à 2019. Le Royaume-Uni a connu en somme une marée basse électorale en juillet 2024, après plusieurs marées hautes. Le retour des travaillistes au pouvoir marque aussi une nette alternance gouvernementale, malgré qu’environ deux tiers des Britanniques n’aient pas appuyé ce changement et que de nouvelles forces en émergence, telles que le Reform UK (14,3 % des voix) ou les Verts (6,7 %), pointent leur museau. Si les élections du 4 juillet avaient suivi le système électoral appliqué en Écosse, lequel incorpore une part de proportionnelle, les travaillistes auraient décroché 236 sièges au lieu de 411, et le Reform UK, 94 au lieu de 51.
Les subtilités du scrutin majoritaire à deux tours en France
À l’inverse de son voisin d’outre-Manche, la France a réservé un autre sort au vainqueur apparent des législatives de juin et juillet et fait mentir de nombreux pronostics. D’ordinaire, le système majoritaire à deux tours usité en France révèle des effets semblables à celui du scrutin britannique. Le parti qui obtient le plus de voix au premier tour parvient, grosso modo, à amplifier sa victoire au second tour et à décrocher une majorité parlementaire, seul ou avec des partis alliés, nécessaire à l’Assemblée pour soutenir le chef de l’exécutif, d’ordinaire le président, élu au suffrage universel, et parfois le premier ministre, en cas de cohabitation.
Entre les tours, il arrive que les partis d’une même famille politique conviennent d’une liste de candidats communs, pour éviter de diviser leurs voix et de favoriser les candidats des camps adverses. Au second tour, en effet, le scrutin met en scène le plus souvent des duels, deux candidats en lice dans une circonscription, voire des triangulaires (trois candidats), plus rarement des quadrangulaires (4 candidats). La mathématique électorale conduit les partis à s’entendre sur le désistement de plusieurs candidats au second tour, même s’ils sont légalement qualifiés, en vue de maximiser les chances de l’emporter.
Cependant, avant les élections de 2024, ces arrangements entre partis n’ont pas vraiment neutralisé l’amplification majoritaire qui profite en général au parti ou à la liste de partis prépondérants à la suite du premier tour. Un bel exemple de cette amplification : aux législatives de 2017, la liste qui appuie le président Macron obtient 32,3 % des voix au premier tour et décroche au deuxième 62,5 % des sièges. Or, il peut se produire que la liste arrivée en seconde place au premier tour se rattrape au deuxième ; par exemple, en 1973, la liste du centre droit menée par le premier ministre Pierre Messmer, distancée de peu par la liste dirigée par le socialiste François Mitterrand au premier tour, se hisse à la première place au deuxième avec 47 % des voix, lui valant près de 64 % des sièges à l’Assemblée. En 1997, Lionel Jospin, à la tête des socialistes, obtient 23,5 % des voix au premier tour des législatives, mais grâce à une alliance avec d’autres formations de gauche — la gauche plurielle — il parvient à constituer un groupe majoritaire à l’Assemblée nationale, au grand déplaisir du président Jacques Chirac, issu de la droite gaulliste, qui avait provoqué une dissolution anticipée alors qu’il disposait d’une majorité pour le soutenir. Bref, règle générale, le scrutin majoritaire à deux tours récompense le parti ou l’alliance de partis (appelée liste) arrivés en première position au premier tour.
Les législatives françaises de l’été 2024, un scrutin de marée haute
Cependant, les scrutins de juin et juillet 2024 ont donné un tout autre résultat. Mais pour comprendre le contexte, considérons le sens même des législatives en France. À vrai dire, ces élections ne tiennent pas la première place dans la hiérarchie des rendez-vous démocratiques. Toute la vie politique de la Ve République tourne autour de la conquête du pouvoir présidentiel, les partis et les forces qui s’agitent dans ce pays visent à porter l’un des leurs à la tête de l’exécutif français, aux pouvoirs considérables, ce qui rend d’ailleurs comparable le régime français à la république composite qui existait au temps de Weimar en Allemagne. Celle-ci unissait un Président puissant élu au suffrage universel et un parlement aux forces politiques émiettées où tentait de gouverner un chancelier précaire.
La vie politique française suit un cycle précis : conquérir d’abord la présidence, puis répercuter la victoire dans une élection législative qui apportera au président nouvellement élu le contingent de parlementaires nécessaire pour appuyer sa politique et confirmer sa prééminence institutionnelle. D’où le fait que les législatives soient devenues des élections de reconduction, de relais, de gonflement des résultats de la course présidentielle. Si celle-ci marque la marée haute dans le cycle politique français, les autres votations en symbolisent la marée basse, si bien que les législatives passionnent moins les Français et qu’elles enregistrent des taux de participation plus faibles qu’aux présidentielles. Cette vision est tellement ancrée dans la vie politique française que le parlement, après la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans décidée par référendum en octobre 2000, a voté en 2001 une loi organique qui déplace les législatives tout de suite après le scrutin présidentiel. Une façon aussi de réduire les risques de cohabitation, que le pays avait expérimentée à trois reprises sous Mitterrand et Chirac, quand une élection législative survenue au milieu d’un mandat présidentiel se retournait contre le président et lui imposait un premier ministre issu d’une famille politique adverse.
En cela, la dissolution anticipée résolue le 9 juin dernier, le soir même des élections européennes, lesquelles ne prennent pourtant aucune part dans le choix du personnel gouvernant français, venait tout d’un coup défaire ce que l’alignement du calendrier électoral établi en 2001 devait instaurer durablement. En agissant en Jupiter, le président Macron qualifiait également l’enjeu de cette campagne expresse, qui précipitait les Français vers un marathon électoral : après un succès aux européennes, il fallait infliger une défaite au Rassemblement national, catalogué par une grande portion des élites et des médias français comme un « ennemi » de la République. De plus, le président, à quelques jours du premier tour, a dramatisé la signification du scrutin en évoquant un risque de « guerre civile » à laquelle conduirait la victoire du Rassemblement national ou de La France insoumise (LFI), parti de gauche qui flirte avec le néo-léninisme et dont le chef, Jean-Luc Mélenchon, s’est attiré le surnom de « Robespierre2 ». Dans ce contexte, ces élections législatives revêtaient une dimension inhabituelle ; le président remettait le sort de sa mandature restante — jusqu’en 2027 — dans les mains des Français et de la nouvelle Assemblée issue de leurs suffrages. Soudain, l’Assemblée, ravalée d’ordinaire en chambre d’enregistrement et de discussion des volontés présidentielles, trônait au centre de la vie nationale. Une marée haute grondait.
Comment des alliances électorales peuvent-elles changer le cours d’une élection ?
Or, déjouant les prédictions savantes et les sondages, qui semblaient indiquer une victoire du Rassemblement national au deuxième tour, mais fort seulement d’une majorité relative, le deuxième tour a accouché d’une configuration parlementaire surprenante. Ce parti et sa frange alliée issue des Républicains schismatiques ont quand même amélioré leur score, à 37 %, sans pouvoir traduire cette avancée par un pourcentage de sièges conséquent. Avec 143 sièges, soit un quart de la députation, la liste du Rassemblement national obtient un résultat qu’un scrutin majoritaire réserve en général à un parti perdant les élections. L’alliance des partis de gauche, appelée le Nouveau Front populaire (NFP), parvient, même si ses appuis faiblissent au deuxième tour de 28,1 % à 25,7 %, à grossir sa députation, à 31 % des sièges, alors que la liste du centre macronien, en dépit de ce qu’elle a perdu 95 députés par rapport aux législatives de 2022, progresse de 20 à 23,2 % au second tour et sauve les meubles avec 26 % des députés. Les républicains qui ont refusé de joindre Éric Ciotti dans son alliance avec le RN échappent à l’hécatombe, avec un contingent de 39 sièges. Aucun des trois grands blocs électoraux n’est donc en mesure de former seul un gouvernement viable, à moins qu’une entente entre ces forces ne cristallise une forme de coalition de partis qui exclurait d’office le Rassemblement national, jugé infréquentable, même si comparativement aux conservateurs britanniques, le RN s’avère moins radical sur plusieurs questions comme l’intégration européenne, et plus à gauche en matière économique. La France connaît ainsi une situation inédite, digne des temps des III et IVe républiques, où les gouvernements de coalition étaient la norme et duraient en moyenne six mois. Et le président Macron doit agir comme jadis le faisaient ses prédécesseurs avant 1958, en simple agent catalyseur des majorités émergeant à l’Assemblée. Le gouvernement Attal a attendu le 16 juillet pour remettre sa démission, et devra administrer les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement, décision que le président Macron a reportée au plus tôt à mi-août 2024, au grand dam du NFP qui l’avait pressé de pourvoir le poste de premier ministre par une candidate issue de son camp.
En fait, la dynamique politique enclenchée par le second tour a vite retourné la situation, au début favorable au Rassemblement national, qui avait profité du fait que le scrutin avait viré en référendum sur la présidence de Macron, en écho aux résultats médiocres pour lui des européennes. Toutefois, devant la crainte que ce parti prît le pouvoir à Matignon et imposât donc un gouvernement de cohabitation, les autres forces du pays, de la gauche milicienne à la droite dite « républicaine », sont parvenues à transformer le sens du second tour : envoyer ou non le Rassemblement national au gouvernement.
Au deuxième tour, beaucoup de sièges restaient à pourvoir, 501 en tout, parmi lesquels on comptait 409 duels et 89 triangulaires, dont un grand nombre opposait un candidat de la liste du Rassemblement national à un candidat associé aux autres blocs concurrents, le NFP manœuvré par la France insoumise, les macronistes et affidés, ainsi que les républicains anti-lepénistes. En un temps record, ces forces concurrentes qui se détestent et s’étaient traitées de tous les noms ont passé des accords pour présenter contre les candidats du Rassemblement national des candidatures uniques et coordonner leurs votes grâce aux désistements, au nombre inédit de 220. Malgré les réfractaires et les dissidents, ce cartel électoral entre blocs, d’une redoutable efficacité, a privé le Rassemblement national de la victoire attendue, d’autant mieux que les électeurs se sont mobilisés pour aller voter, avec un taux de participation d’environ 67 %, un seuil inhabituellement élevé pour des législatives en France. Une marée haute anti-RN a donc endigué la poussée annoncée de ce parti diabolisé qui incarnerait, selon le spécialiste des sondages, Jérôme Fourquet, une « force solitaire » proche de la France « populaire » qui incline, davantage que les couches supérieures, à donner des prénoms anglais à ses enfants comme Jordan, Kevin ou Tiffany3.
Victoire en deçà de la Manche, désastre par-delà
Les résultats du deuxième tour aussitôt connus, les ténors du NFP ont crié au triomphe et réclamé le poste de premier ministre. Or, avec 25,7 % des voix, ce front bigarré de la gauche française dépasse de peu le score catastrophique obtenu par les conservateurs britanniques, soit 23,7 %. Selon le mot célèbre de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées ; erreur au-delà. On pourrait dire depuis l’été 2024 : triomphe en deçà de la Manche, déconfiture au-delà. Citons à ce sujet le politiste Dominique Reynié : « En réalité, la gauche a remporté, comme souvent, une victoire médiatique, celle de l’interprétation des résultats, mais électoralement, elle a subi un échec important. Si, au second tour, on additionne les scores des partis du NFP avec ceux de toutes les gauches, on obtient laborieusement 27,28 % des suffrages exprimés… soit 17 % des électeurs inscrits. Les gauches reculent même par rapport aux élections européennes du 9 juin, où ce total de toutes les gauches dépassait 33,7 % des suffrages exprimés. » Aux dires de Reynié, des législatives françaises n’a émergé aucun vainqueur parmi les trois blocs principaux.
En réalité, la gauche a remporté, comme souvent, une victoire médiatique, celle de l’interprétation des résultats, mais électoralement, elle a subi un échec important. (Dominique Reynié)
Pour les conservateurs britanniques, leur malheur ne s’arrête guère à leur défaite, l’une des pires de leur histoire. Ils voient s’installer dans le paysage politique un concurrent funeste, le Reform UK, qui lui a siphonné une partie de son électorat le 4 juillet 2024. Son dirigeant, Nigel Farage, qui s’est ainsi fait élire pour la première fois aux communes, n’est pas une figure inconnue. Il s’était distingué tout d’abord comme l’un des fondateurs et le dirigeant d’un parti souverainiste, défenseur du Brexit, le UKIP, qui avait fait des percées aux élections européennes de 1999 à 2019, au point même de hisser son parti au premier rang aux européennes de 2014. Cependant, si la proportionnelle pratiquée pour choisir des députés britanniques au Parlement de Strasbourg a souri à Farage, le scrutin majoritaire et ses rigueurs lui ont fermé les portes des communes où il a tenté de se faire élire sans succès. L’un des grands promoteurs du Brexit, politicien au style coloré qui amuse les classes populaires, Farage est revenu hanter les conservateurs aux dernières élections pour leur disputer des électeurs sur des thèmes tels que l’immigration, dont les torys n’arriveraient pas à contrôler les flux selon les reformers. À la tête d’un quintette de députés, Farage peut néanmoins capter l’attention des médias et tenter de supplanter les conservateurs pour incarner l’opposition radicale au gouvernement travailliste de Starmer. Farage compte même arracher aux conservateurs quelques députés transfuges. Dans ce contexte, les travaillistes ont déjà confié à l’un de leurs stratèges la préparation des élections générales de 20294.
L’intégration des contestataires dans le jeu politique, gage de longévité des régimes ?
Dans un ouvrage récent sur le postpopulisme, le politiste Thibault Muzergues, s’appuyant sur les travaux de l’historien René Rémond, observe que la longévité de la IIIe République française, qui s’est étendue de 1870 à 1940, résidait dans sa capacité à intégrer dans le jeu politique les forces contestataires, comme les radicaux, socialistes et communistes5. Cette observation vaudrait en contexte britannique : l’exceptionnelle longévité des partis britanniques s’expliquerait peut-être dans le fait qu’ils constituent des coalitions de plusieurs tendances et mouvements au sein d’un même véhicule, qui veille à ne pas laisser s’échapper les franges mutines. C’est ce qu’ont réussi les conservateurs sous la houlette de l’impétueux Boris Johnson, qui ont embouché la trompette du Brexit pour resserrer les rangs, même si plusieurs dirigeants du parti penchaient pour le maintien du pays dans l’Union européenne. Pensons à l’ancien premier ministre David Cameron (2010-2015), qui avait repris du service comme ministre des Affaires étrangères du défunt gouvernement Sunak. Toutefois, le parti conservateur a perdu aujourd’hui sa capacité unificatrice, en s’aliénant une partie de la haute finance londonienne et de sa base populaire6.
Si on applique cette maxime à la France actuelle, soit que l’intégration des contestataires est gage de longévité pour un régime, on peut se demander si la Ve république pourra longtemps sans dommage reléguer à l’indignité un parti devenu le premier parti de France, qui représente plus du tiers de l’électorat votant, c’est-à-dire près de onze millions d’électeurs, fort d’appuis qui désormais rejoignent toutes les classes de la société, pas seulement les classes populaires ou « périphériques » et toutes les régions françaises, hormis Paris. Pour l’instant, les partis dominants en France préfèrent penser que l’option de l’exclusion est gage de santé démocratique. Après la raclée administrée au Rassemblement national au deuxième tour des législatives, le cartel anti-RN a réussi à renouveler son exploit lors d’un troisième tour parlementaire, c’est-à-dire lors de la répartition des postes de responsabilités au sein de l’Assemblée nationale. Alors que le règlement de l’Assemblée prévoit une répartition proportionnelle aux forces parlementaires existantes, les partis du cartel ont boycotté systématiquement les candidats du RN, pour les empêcher d’obtenir un quelconque poste de vice-président de l’Assemblée, de président de commission, de secrétaire ou de questeur. De l’avis de trois constitutionnalistes français réputés, Pierre Avril, Jean-Pierre Camby et Jean-Éric Schoettl, l’installation d’un tel « cordon sanitaire » contre le RN dans le fonctionnement même de l’Assemblée nationale porte une atteinte grave au pluralisme partisan et à la démocratie parlementaire7. On voit aussi que la France ne possède pas encore de culture parlementaire de l’opposition, qui est institutionnalisée et respectée à Westminster.
Il n’empêche qu’une telle exclusion dans l’hémicycle peut tourner à l’avantage du parti conspué. Ce fut le cas du parti Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, devenue chef du gouvernement italien en 2022, à la tête d’une coalition de droite où sa formation occupe la place prépondérante. Tout un revirement quand on songe au fait que son parti avait récupéré les restes de l’ancien parti postfasciste, l’Alliance nationale, auquel le chef d’alors, Gianfranco Fini, avait administré une politique de dédiabolisation dont se sont inspirées Giorgia Meloni et Marine Le Pen. Fini avait même obtenu la présidence de la chambre des députés de 2008 à 2013.
À ses débuts, Fratelli d’Italia paraissait un mouvement marginal, distancé par la Ligue du Nord menée par le charismatique Matteo Salvini, devenu vice-président du Conseil en 2018 avec le mouvement hors norme 5 Étoiles pour constituer un gouvernement « antisystème ». Cette coalition étrange, qui remplaça la ligue de Salvini par les démocrates du centre gauche à l’été 2019, s’est effondrée au début de 2021. Le président de la République, Sergio Mattarella, nomme alors à la tête du gouvernement italien un technicien, le banquier Mario Draghi, s’entourant de ministres issus de neuf formations politiques, de la gauche à la droite, à l’exclusion du parti de Meloni. Ainsi en viendra-t-il à incarner l’opposition et l’alternance pour le prochain gouvernement italien.
Rien ne garantit que ce genre de scénario se réalisera pour la France, car beaucoup d’inconnu pèse sur l’identité des premiers ministres et la durée des gouvernements que le président Macron nommera au cours des dernières années de son mandat. Il reste que le Rassemblement national, implanté dans tout le territoire et les couches sociales du pays, pourra prétendre figurer la véritable opposition face aux gouvernements composés par un président en fin de cycle et mal aimé, à la merci des desiderata d’une gauche remontée et d’un centre en froid avec son propre géniteur politique. Cependant, selon l’ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, si Giorgia Meloni a réussi à prendre en main la droite italienne, qui forme un bloc uni malgré ses divisions en partis concurrents, en France, la droite demeure fracturée entre sa frange « républicaine » proeuropéenne, réduite « à sa portion congrue » et la droite qu’il dit « populiste », portée par une vague grandissante8.
Deux destins politiques, deux parlementarismes
Avec les dernières élections britanniques, le Royaume-Uni semble renouer avec une certaine normalité institutionnelle, à la différence que le Parlement britannique se trouve à être plus souverain que jamais, le pays ayant rompu les ficelles avec l’Union européenne, après un divorce âprement négocié. Le Brexit traversé, après avoir mis à l’épreuve le parlementarisme britannique paralysé par l’indécision, ce régime a montré sa capacité à s’adapter aux événements, même les extrêmes, guerres, pandémie, fronde décolonisatrice. Il a résisté aux tentatives de réformer son mode de scrutin, aux imperfections notoires, mais aux mérites éprouvés pour engendrer des gouvernements stables et un renouvellement périodique du personnel dirigeant, quand un parti a épuisé ses cartouches après de longues années au pouvoir. Ce parlementarisme ancien, rénové par à-coups, connaîtra une petite mue, quand les travaillistes de Starmer élimineront les 92 pairs héréditaires restants de la Chambre des Lords, qui avaient survécu à la réforme entreprise par Tony Blair en 1999. Cette mesure fait partie de toutes celles que le nouveau gouvernement, à l’occasion du discours du Trône prononcé le 17 juillet par le roi dans le cérémonial fastueux traditionnel, vient d’annoncer pour remettre le pays sur pied. À l’issue de l’embrouillamini politico-institutionnel consécutif au référendum de 2016, l’ironie de l’histoire veut que ce soit le parti adversaire du Brexit qui doive normaliser le nouveau statut gagné par le royaume de Charles III, ce Global Britain sans amarrage européen, sans menace indépendantiste écossaise à l’horizon, dont l’empire s’est rapetissé aux îles britanniques et à des micros-possessions d’outre-mer. Il demeure la sixième puissance économique du monde, devançant la France par son produit intérieur brut (PIB) et la richesse par habitant, bien qu’il ait augmenté sa dette publique et lutte contre une inflation élevée depuis la pandémie. Cependant, il doit remettre son armée en état, affaiblie par des années de désinvestissement, même si le Royaume consacre déjà 2,35 % de son PIB à la défense, proportion que les travaillistes veulent porter à 2,5 % (contre 2 % en 2024 pour la France).
...la France entre dans une période d’incertitude, peut-être une crise de régime qui délitera la Ve République.
Plus endettée que jamais, championne européenne de la pression fiscale, la France entre dans une période d’incertitude, peut-être une crise de régime qui délitera la Ve République. À l’ouverture des Jeux olympiques à Paris le 26 juillet, la France s’est trouvée sans nouveau gouvernement stable en vue. Le parlementarisme, en France, apparaît sous la forme d’une greffe après la Révolution. Il ne parviendra guère à s’enraciner dans les mœurs, la classe politique et même le peuple français étant tentés plutôt par un pouvoir de type monarchique, quitte à élire le monarque par l’onction populaire, ou par un régime d’assemblée dont l’exécutif relaie les volontés. Deux formules différentes en esprit, quoique toutes deux incompatibles avec un régime parlementaire où l’exécutif se soumet tout entier au contrôle de la chambre en échange d’une autonomie de décision. À long terme, si la France se destine à devenir une grande province de l’Empire européen, le régime français, qui combine un parlementarisme imparfait et un président irresponsable politiquement, finira peut-être par paraître trop tarabiscoté pour la vocation véritable du pays. Deux voies de simplification pourraient s’imposer aux esprits : neutraliser la fonction présidentielle (sans l’éliminer formellement) pour transférer le pouvoir exécutif réel à un premier ministre responsable uniquement devant l’Assemblée nationale ; adopter un régime présidentiel, de type américain, qui enlèverait le premier ministre au profit d’un président concentrant l’autorité gouvernementale. Un historien a comparé Emmanuel Macron au roi Louis-Philippe 1er, animé d’un esprit de revanche9. La France aime bien se débarrasser de ses rois depuis la Révolution, fussent-ils héréditaires, constitutionnels, plébiscités ou élus. Mais se lassera-t-elle un jour d’en introniser ? Une histoire à suivre, digne d’une télésérie.
1) « Electoral reform : Lord, make us proportional – but not yet », The Economist, 13 juillet 2024, p. 12.
2) Vincent Trémolet de Villiers, « Pourquoi la stratégie de Mélenchon ressemble à celle de Lénine en 1917 », Le Figaro Vox, 22 septembre 2017, en ligne : https://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/09/22/31001-20170922ARTFIG00129-pourquoi-la-strategie-de-melenchon-ressemble-a-celle-de-lenine-en-1917.php.
3) Jérôme Fourquet, « La France est fracturée en trois blocs idéologiques », Le Figaro Magazine, 12 juillet 2024, p. 31-37.
4) Rowena Mason, « We are planning for 2029 election and will fight like “insurgents” – McSweeney », The Guardian, 13 juillet 2024, p. 12.
5) Postpopulisme, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2024, p. 166-167.
6) Voir Bagehot, « What now for Britain’s right-wing parties? », The Economist, 5 juillet 2024.
7) Pierre Avril, Jean-Pierre Camby et Jean-Éric Schoettl, « L’installation d’un cordon sanitaire dans l’hémicycle bafoue la démocratie représentative », Le Figaro, 23 juillet 2024, p. 17.
8) Enrico Letta, « C’est la dernière tentative pour faire survivre la Ve République », L’Express, no 3810, 10 juillet, p. 18.
9) Propos recueillis par Lauréline Dupont, « Macron ressemble à Louis-Philippe, le roi animé par un esprit de revanche », L’Express, no 3810, 18 juillet 2024, p. 39.