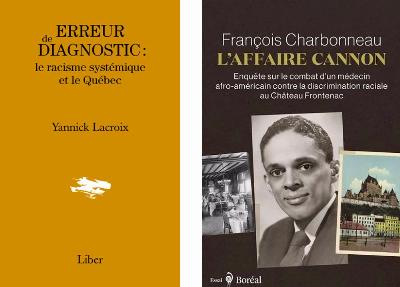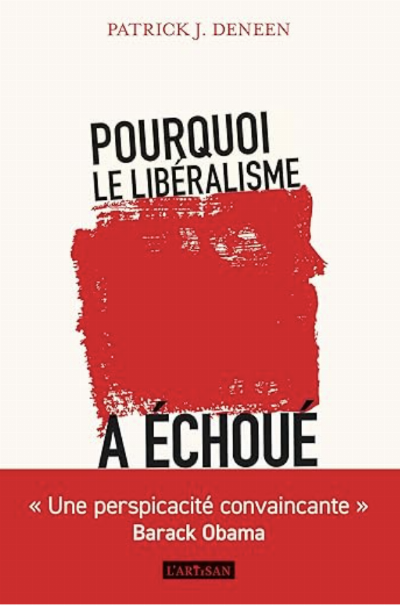La constitution ferroviaire
«Le Canada est né d’un chemin de fer, mais il s’est dépêché de l’oublier. Il n’est pas nécessaire d’être un expert pour constater que, comparativement à l’Europe, à l’Asie et même à certaines régions des États-Unis, le train est un secteur sinistré au Canada. S’il fallait juger le Canada sur l’état de ses trains, on devrait le classer quelque part entre les pays émergents et ceux du tiers-monde.» Le Canada détruit donc l'image qu'il s'est faite de lui-même. Marc Chevrier fait ici la lumière sur ce paradoxe que soulignait Christian Rioux dans le Devoir du 12 juillet 2013.
La constitution ferroviaire
La puissance canadienne dans le brasier du Lac Mégantic
 L’horrible tragédie survenue au Lac Mégantic, qui a coûté la vie à 47 personnes carbonisées par l’explosion d’un train transportant du pétrole de schiste pompé dans le Dakota du Nord, a soudain braqué l’attention du public et des médias sur une activité qui passe en général inaperçue : le transport ferroviaire. Or, le rail, au Canada, n’est pas un moyen de transports ordinaire, à mettre sur le même plan que l’automobile, l’avion ou le bateau. Il a joué un rôle déterminant dans la création du Canada en 1867 et marqué la rédaction même de la loi constitutionnelle qui a divisé les pouvoirs entre un État fédéral surpuissant et des entités fédérées à l’autonomie restreinte. Aux élites coloniales qui ont créé le Dominion canadien à l’ère victorienne, il était impératif que ce dernier ait tous les moyens légaux et financiers requis pour soutenir la construction de lignes intercontinentales devant créer un axe économique est-ouest qui contrecarre l’attraction économique américaine. Depuis le printemps québécois de 2012, on a vu une partie de la jeunesse québécoise se remonter contre le gouvernement Charest sur la hausse des frais de scolarité et les révélations de la commission Charbonneau sur les pratiques endémiques de corruption éclabousser la sphère municipale. Or, se livrant depuis à un exercice d’auto-flagellation collective, le Québec n’a eu de cesse de blâmer sa classe politique pour sa mauvaise administration, en oubliant que l’État fédéral continue d’exercer des compétences névralgiques qui échappent pourtant à l’examen critique.
L’horrible tragédie survenue au Lac Mégantic, qui a coûté la vie à 47 personnes carbonisées par l’explosion d’un train transportant du pétrole de schiste pompé dans le Dakota du Nord, a soudain braqué l’attention du public et des médias sur une activité qui passe en général inaperçue : le transport ferroviaire. Or, le rail, au Canada, n’est pas un moyen de transports ordinaire, à mettre sur le même plan que l’automobile, l’avion ou le bateau. Il a joué un rôle déterminant dans la création du Canada en 1867 et marqué la rédaction même de la loi constitutionnelle qui a divisé les pouvoirs entre un État fédéral surpuissant et des entités fédérées à l’autonomie restreinte. Aux élites coloniales qui ont créé le Dominion canadien à l’ère victorienne, il était impératif que ce dernier ait tous les moyens légaux et financiers requis pour soutenir la construction de lignes intercontinentales devant créer un axe économique est-ouest qui contrecarre l’attraction économique américaine. Depuis le printemps québécois de 2012, on a vu une partie de la jeunesse québécoise se remonter contre le gouvernement Charest sur la hausse des frais de scolarité et les révélations de la commission Charbonneau sur les pratiques endémiques de corruption éclabousser la sphère municipale. Or, se livrant depuis à un exercice d’auto-flagellation collective, le Québec n’a eu de cesse de blâmer sa classe politique pour sa mauvaise administration, en oubliant que l’État fédéral continue d’exercer des compétences névralgiques qui échappent pourtant à l’examen critique.
Pas de rail, pas de Canada
L’historien du droit et bibliothécaire de l’assemblée législative du Québec, Jean-Charles Bonenfant, a su très bien résumer en quelques mots l’esprit du projet canadien de 1867 :
« La Confédération est née sous le signe de l'urgence, non pas pour réaliser un beau rêve unanime, mais pour sortir le mieux possible des difficultés immédiates. Elle a été engendrée par les magnats des chemins de fer et les banquiers de l'époque, grâce à la collaboration de Cartier aidé par le clergé catholique, le tout cuisiné par cet admirable opportuniste qu'était John A. Macdonald avec la bénédiction d'une Angleterre qui se désintéresse de ses colonies. »(1)
L’idée de fédérer les colonies du Canada-Uni (la province créée en 1840 pour fusionner le Haut et Bas-Canada et minoriser ce dernier), des Maritimes et du Pacifique devait servir une grande ambition économique, bien loin des nobles principes philosophiques invoqués pour justifier cette union : il fallait une nouvelle structure gouvernementale puissante, dont les capacités d’emprunt et de réglementation excéderaient celles des colonies britanniques existantes, propre à seconder la bourgeoisie de l’époque dans ses projets d’expansion. Et le projet de l’heure était la construction de voies ferroviaires intercontinentales, qui reliraient les Maritimes et les Pacifiques en passant par le Canada central, des projets coûteux qui attisaient la convoitise des industriels britanniques et canadiens. L’Amérique du nord britannique, en 1860, comptait à peine 2065 milles de rails, contre 15 000 pour les États-Unis, mais connaissait déjà un essor rapide des investissements dans les réseaux ferroviaires. Comme les capitaux mobilisés par ces projets étaient considérables, la bourgeoisie industrielle ne voulut pas en assumer seule la facture : il parut dès lors nécessaire que l’État, par sa capacité d’emprunt et de taxation, prît le relais. C’est pour cette raison que l’un des arguments invoqués à l’époque pour justifier la création d’un Dominion, était la célébration des bienfaits de l’endettement public, vu comme un facteur de puissance. Le ministre des finances du Canada-Uni, Alexander Galt, et fervent défenseur d’une union canadienne, déclara : « Mais il faut bien se rappeler que l’absence de certains items (sic) de dépense du budget d’un pays est souvent plutôt une preuve de faiblesse et de dépendance qu’une source de satisfaction(2). » En somme, plus la dette publique est considérable, plus un État se signale par sa puissance et son prestige, une façon de penser qui remonte, selon le sociologue Stéphane Kelly, à l’idéologie de l’élite whig anglaise qui, sous le premier ministre Robert Walpole, au pouvoir entre 1721 et 1742, prit le parti de lier l’essor du commerce et de l’industrie à l’existence d’un État fort, canalisant les ambitions à son profit. Cette élite libérale, ou le Court Whig selon les termes employés par les historiens, plaçait ses espoirs dans une monarchie commerciale dont elle prenait la tête. Au Canada, cette idéologie, comme l’a montré Kelly, était largement partagée par les pères fondateurs et les membres de la bourgeoisie coloniale. La création du Dominion paraissait au fond un instrument de crédit servant à financer des projets que les investisseurs britanniques ne voulaient plus s’aventurer à soutenir seuls avec de petites colonies au crédit limité. Les représentants de l’industrie ferroviaire canadienne ont suivi de près les pourparlers en cours pour créer une union canadienne et firent pression auprès de Londres. Plusieurs des pères fondateurs avaient partie liée avec les compagnies ferroviaires, à titre de membres de leur conseil ou d’avocats mandataires. Pensons à George-Étienne Cartier, avocat au service du Grand Tronc depuis 1864. Or, comme le note Kelly, c’était au Bas-Canada, marqué par le républicanisme des Patriotes, que la méfiance à l’égard de l’endettement public était la plus grande : « L’influence du républicanisme chez les Canadiens français suscite une méfiance à l’égard de l’endettement public et de la taxation. Au moment de la résistance de 1837, notamment, cette réserve est dominante dans le discours des Patriotes ». Réserve qui semble avoir été vaincue une deuxième fois en 1867(3).
La souveraineté ferroviaire canadienne
Cette ambition ferroviaire et capitaliste se traduisit dans la structure même de la loi constitutionnelle que le parlement de Londres adopta en 1867 pour créer une union canadienne, portant le titre de Dominion – loi qu’on appelle abusivement « constitution » au Canada, bien qu’elle n’ait rien à voir avec la définition moderne de la constitution (4). Cette loi, ou Acte de l’Amérique du Nord Britannique (AANB), depuis 1982 nommée Loi constitutionnelle de 1867, est encore considérée comme le texte fondateur du Canada, en ce qu’il fixe le régime de l’État et le partage des pouvoirs entre l’État fédéral et les États provinciaux. L’AANB porte ainsi la marque de la grande ambition ferroviaire canadienne de diverses façons.
Tout d’abord, fort loin des grandes déclarations de principes qui émaillent les constitutions américaine et française, les constituants étaient obsédés par la réalisation d’un chemin de fer reliant la vallée du Saint-Laurent au port d’Halifax, au point d’inscrire dans l’AANB, à son article 145 abrogé en 1893, l’obligation faite au gouvernement fédéral d’entreprendre, dans les six moins consécutifs à l’union, les travaux de construction d’une telle voie intercontinentale. Dans le décret impérial érigeant en 1871 la Colombie-Britannique en État de l’union canadienne figurait aussi l’obligation de relier la côte pacifique au reste du Canada par le rail, obligation qui, selon la Cour suprême dans un jugement rendu en 1994, n’imposait pas au gouvernement fédéral de maintenir à perpétuité un service ferroviaire une fois la voie construite(5).
Ensuite, l’AANB, à son fameux article 91, accorde au parlement fédéral des compétences stratégiques pour le développement du rail. Ainsi, les alinéas 1A, 3 et 4 lui donnent une capacité illimitée de prélever des impôts et de contracter des dettes. Il peut ainsi prélever des deniers « par tous modes ou systèmes de taxation » et faire, sans restriction, des emprunts de « deniers sur le crédit public. »(6) Voilà réalisée l’ambition de Galt, instaurer une puissante machine de crédit. De plus, ce parlement peut légiférer à sa guise sur la « dette et la propriétés publiques. » Cette disposition, en apparence anodine, est déterminante. Dès qu’un bien quelconque, un ouvrage physique, y compris une voie ferroviaire, devient propriété de l’État fédéral, il tombe automatiquement sous sa compétence législative exclusive. D’ailleurs, l’article 108 et l’annexe trois de l’AANB prévoyaient que les « chemins de fer, actions dans les chemins de fer, hypothèques et autres dettes dues par les compagnies de chemins de fer » qui appartenaient à la Province du Canada-Uni devenaient propriétés publiques de l’État fédéral canadien.
De plus, l’article 92, qui définit en général les compétences des États provinciaux, prévoit de nombreuses exceptions en matière de transports. Ainsi l’alinéa 10 soustrait à leur compétence tous les moyens de transports qui n’ont pas un caractère strictement local. Ainsi tout chemin de fer qui déborde les frontières d’un État provincial est réputé tomber sous la compétence exclusive de l’État fédéral. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, le parlement fédéral, dans l’exercice de son pouvoir à l’égard des entreprises ferroviaires interprovinciales et internationales, peut réglementer exclusivement les matières connexes à l’activité ferroviaire, comme les relations de travail, la qualité des services, la sécurité, etc. Ces entreprises deviennent en quelque sorte des enclaves fédérales sur le territoire des États provinciaux, immunisées contre plusieurs de leurs lois. Ce logique d’immunisation s’applique à d’autres entreprises fédérales, comme en téléphonie par exemple, tant et si bien qu’au Québec, comme ailleurs au Canada, coexistent de deux codes du travail différents.
Mais le constituant canadien, non content d’accorder à l’État fédéral une panoplie aussi impressionnante de pouvoirs à l’égard des chemins de fer, ajouta une disposition, soit l’alinéa 92 10)c), que les constitutionnalistes au Canada nomment le « pouvoir déclaratoire ». C’est un pouvoir unique, dont on ne voit pas l’équivalent dans les constitutions de plusieurs fédérations, qui confère au parlement fédéral, de manière totalement discrétionnaire, le pouvoir de déclarer qu’un ouvrage physique quelconque, incluant les voies ferroviaires, est à « l’avantage du Canada ». L’effet d’une telle déclaration dans une loi fédérale est de transférer l’ouvrage ainsi visé dans l’orbite des compétences fédérales exclusives. Les tribunaux n’ont pas voulu mettre de conditions strictes à l’exercice de ce pouvoir qui fait exception à la logique du fédéralisme et érige l’État fédéral en souverain plénier, qui décide lui-même de l’étendue de ses compétences. Entre 1867 et 1961, le parlement s’est prévalu 470 fois de ce pouvoir magique, en grande partie pour déclarer à l’avantage du Canada des lignes de chemins de fer, dont notamment des voies au nord de Sept-Îles en 1947 et en 1960(7). Une spécialiste du pouvoir déclaratoire, Andrée Lajoie, qui lui a consacré une étude parue en 1969, a conclu à sa désuétude dans un texte publié en 2006(8), au vu de son manque de légitimité en régime fédéral. Mais dans un texte publié en 2009, elle se ravise, constatant que le parlement s’est prévalu de ce pouvoir en 2007(9). Ce pouvoir exorbitant est à mettre au compte des nombreux mécanismes grâce auxquels l’État fédéral modifie discrétionnairement le partage des pouvoirs en sa faveur et qui situent selon elle encore aujourd’hui le Canada entre l’État unitaire et la fédération. C’est par ce mécanisme que le parlement fédéral s’est octroyé la compétence exclusive sur les ouvrages servant à produire de l’énergie nucléaire. Un autre constitutionnaliste, Peter Hogg, est aussi d’avis que ce pouvoir ne s’est pas éteint. Un chemin de fer déclaré à l’avantage du Canada ne devient pas la propriété de l’État fédéral, mais celui-ci, usant des larges pouvoirs d’expropriation reconnus par les tribunaux, peut aussi exproprier des voies ferrées, et ainsi s’en rendre maître, en tant que législateur et propriétaire.
L’article 88 de la Loi sur les transports au Canada, adoptée en 1996, donne un exemple spectaculaire de l’usage du pouvoir déclaratoire à l’égard des infrastructures ferroviaires. Cet article précise à quels types de compagnies de chemin de fer la loi s’applique. Elle s’étend « aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Parlement » fédéral. Cependant, pour plus de sûreté, on précise, aux alinéa 2 et 3, que « tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d’une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement » est « déclaré être un ouvrage à l’avantage du Canada ». En somme, il suffit qu’une compagnie ferroviaire fédérale loue un petit tronçon de voies ferrées pour qu’elles soient automatiquement déclarées à l’avantage du Canada. Cette façon de légiférer illustre comment le parlement fédéral tient à exercer à l’égard des infrastructures ferroviaires une souveraineté absolue, parfaite, sans faille, libre à lui de laisser aux États provinciaux des tronçons sans intérêt, ni pour lui, ni pour l’industrie. Du reste, l’article 95 de la Loi sur les transports au Canada confère aux compagnies ferroviaires fédérales les pleins pouvoirs pour construire tout ouvrage, pont, aqueduc, tunnel, nécessaire à la construction de leurs infrastructures, et pour « détourner ou changer les cours d’eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer » comme si l’État fédéral prêtait sa puissance à des entités corporatives déléguées.
Emprise fédérale et colonie commerciale
Henri Dorion et Jean-Paul Lacasse, respectivement géographe et juriste, ont su analyser la dynamique engendrée par ce qu’ils appellent les « emprises fédérales ». Ils désignent ainsi des portions du territoire qui sont soustraites à la responsabilité des États provinciaux du fait de l’exercice par l’État fédéral des multiples pouvoirs à l’égard d’ouvrages, de terrains ou de personnes tombant sous son autorité exclusive. Parmi ces emprises figurent les réserves indiennes, les bases militaires, les terrains des anciens combattants, les parcs fédéraux, les stations agricoles expérimentales, les ports et havres publics, les quais et installations portuaires, les canaux, les aéroports, certaines routes et ponts (le pont Champlain à Montréal), les oléoducs et gazoducs, les édifices publics fédéraux, et bien sûr, les chemins de fer (10). Même si les États provinciaux ont la propriété des terres publiques et sont responsables de l’aménagement du territoire, l’État fédéral, en vertu des pouvoirs verticaux reposant sur sa souveraineté d’exception, peut s’arroger telle ou telle portion du territoire, le plus souvent en faisant fi des priorités fixées par l’État provincial et les municipalités. Ils résument cette dynamique par l’expression : « le vertical peut gruger l’horizontal. »(11) L’expropriation unilatérale des meilleures terres agricoles du Québec en vue de construire à Mirabel un aérodrome gigantesque qui s’avéra un éléphant blanc illustre cette dynamique érosive, aux conséquences catastrophiques pour une région.
On peut aussi mieux comprendre la dynamique des pouvoirs instaurée par l’ordre canadien et sa relation au territoire en prenant en compte le type de développement colonial qui s’est imposé au Canada. Dans un texte riche en intuitions sur la tradition architecturale au Québec, le professeur d’architecture François Dufaux, s’appuyant sur les travaux d’Anthony D. King sur les villes coloniales, observe que les métropoles européennes ont privilégié deux types d’occupation du territoire colonial, soit la colonie de peuplement et la colonie commerciale(12). Dans la première, la métropole essaie d’y reproduire à l’identique son propre cadre urbain et architectural, en y favorisant le peuplement et les échanges entre les deux économies. Dans la deuxième, l’investissement dans le cadre urbain est minimal, seul compte l’aménagement de voies de communication pour accéder aux ressources et les exporter vers la métropole. Fondée comme colonie de peuplement sous le régime français, la Nouvelle-France passa, par la Conquête, sous un régime de colonie commerciale, où l’investissement urbain et architectural fut négligé au profit de l’accès rapide aux ressources, par voies de chemins de fer, de canaux, de ports, etc., et des industriels qui les exploitent. Or, selon Dufaux, « [l]e cadre constitutionnel actuel maintient l’extension de la logique coloniale commerciale au Québec. » Il observe qu’en matière d’aménagement du territoire et d’architecture prime une logique verticale de subordination des États provinciaux et des municipalités aux « projets immobiliers sous compétence fédérale », dont la construction sert le clientélisme et les gros acteurs de l’industrie. Ce qui crée une dépendance qui « explique aussi l’importance accordée à l’obtention du contrat plutôt qu’à la qualité de l’aménagement, préoccupation spéculative récurrente d’une colonie commerciale. » On pourrait ajouter à l’analyse de Dufaux ce fait fondamental : le système constitutionnel canadien est ainsi fait qu’il donne à l’État fédéral tous les moyens nécessaires pour pratiquer sur le territoire les percées que l’industrie, le plus souvent étrangère, requiert pour accéder librement aux ressources, sans subir l’interférence des paliers « inférieurs », et les extraire et les réacheminer, sans transformation, vers les marchés extérieurs. Demeuré aujourd’hui une économie extractive de ressources, le Canada cultive encore les ambitions et les préoccupations d’une colonie commerciale. Il suffit de voir tous les projets d’oléoducs et de gazéoducs de l’industrie de l’énergie fossile qu’Ottawa continue d’avaliser aujourd’hui, avec un empressement qui interdit toute réflexion à long terme sur les conséquences de cette fuite dans l’extraction folle des ressources et sur un modèle de développement économique et d’occupation du territoire qui n’a pas varié depuis le temps de Macdonald et de Cartier.
La tragédie du Lac Mégantic a aussi donné à voir, de manière cruelle sinon cynique, la manière dont au Canada les acteurs économiques, l’État supérieur et les paliers inférieurs se partagent les responsabilités dans une simili-colonie commerciale(13). Les premiers saisissent les bonnes occasions extractives, les exploitent et les épuisent, avec le concours de l’État fédéral qui voit à poser le cadre général de l’extraction, à réglementer le système des infrastructures des transports, dans une gestion distante d’avec la réalité des villes et des régions aux prises avec les contrecoups de cette extraction et du transport des matières premières. Finalement, l’État provincial et ses municipalités, souvent complices de cette extraction généralisée, en amortissent les contrecoups et voient à adapter la population aux mutations de cette exploitation par la dispensation de services aux personnes: recyclage, éducation, santé, sécurité du revenu, dépollution. En cas de catastrophe, les pompiers et des enquêteurs sont dépêchés sur place, pendant que les autorités provinciales et municipales distribuent aux victimes consolation et indemnités monétaires, impuissantes contre les défaillances d’une compagnie de chemin se plaçant sous la loi de la faillite, elle aussi de compétence fédérale exclusive...(14) Bref, au privé les profits, à Ottawa la régie générale, aux pouvoirs inférieurs, la solidarité compensatoire.
La souveraineté impériale canadienne
Dans La Petite loterie, Stéphane Kelly rappelle une des intentions fondatrices des pères du Dominion canadien, largement oubliée aujourd’hui, soit « transformer l’ancien système colonial en un nouvel Empire canadien. » (15) Il ajoute : « Suivant le principe anglais de l’imperium in imperio, il s’agit de créer un Empire canadien au sein de l’Empire britannique. » John Macdonald aurait caressé ce rêve depuis 1860 et déclara à ce sujet : « Il est vrai que le gouvernement a proposé une confédération des provinces d’Amérique du Nord britannique […] afin de constituer un vaste empire. » Il peut paraître étrange de parler ici d’Empire canadien, alors qu’on vient de voir que le système économique canadien a gardé son empreinte coloniale initiale. En réalité, ce qui fait le paradoxe du régime canadien, c’est qu’il juxtapose un système de pouvoir impérial par sa structure à une économie demeurée dépendante des ressources naturelles et des marchés extérieurs, jadis l’Empire britannique, depuis la Deuxième Guerre mondiale les États-Unis, et bientôt la Chine. Ce système de pouvoir est impérial dans un double sens : 1- il sert l’expansion du capitalisme, devenu en lui-même une nouvelle forme d’empire où l’économique s’émancipe du politique (16); l’État fédéral a longtemps présidé à cette expansion au Canada en favorisant la concentration industrielle dans un marché national protégé. 2- Ce système s’appuie sur l’expansion continue des pouvoirs fédéraux au sein de l’ordre constitutionnel canadien, maintenant la supériorité de celui-ci vis-à-vis des États provinciaux, des municipalités et des conseils autochtones.
 Après le développement anarchique des chemins de fer au Canada pendant les premières décennies du Dominion, le gouvernement fédéral décida de concentrer l’industrie entre deux joueurs, le Canadien national, constitué en 1919 en société d’État, ou les Chemins de fers nationaux du Canada, et le Canadian Pacific, une entreprise privée restée l’alliée et la protégée d’Ottawa dans la colonisation de l’Ouest. Ce duopole mixte marqua pendant quelques décennies la politique ferroviaire fédérale, placé sous la surveillance d’un organisme indépendant de réglementation. Mais en 1987, sous l’influence des politiques de déréglementation en vogue en Occident, Ottawa fit adopter une nouvelle loi sur les transports, inspirée d’un énoncé au titre évocateur, « Aller sans entraves »(17), en vue d’alléger la réglementation et de libéraliser les prix, le transport ferroviaire ayant été conçu jusqu’alors comme un service public. Puis en 1996, le gouvernement libéral de Jean Chrétien privatisa le CN, dont les actions finirent vite dans des mains américaines(18). L’article 5 de la Loi sur les transports au Canada résume bien le nouvel esprit déréglementaire qui règne dans le pays depuis plusieurs années. Même si la lecture en est pénible - la langue législative fédérale tient souvent du galimatias - il est bon d’y jeter un coup d’œil :
Après le développement anarchique des chemins de fer au Canada pendant les premières décennies du Dominion, le gouvernement fédéral décida de concentrer l’industrie entre deux joueurs, le Canadien national, constitué en 1919 en société d’État, ou les Chemins de fers nationaux du Canada, et le Canadian Pacific, une entreprise privée restée l’alliée et la protégée d’Ottawa dans la colonisation de l’Ouest. Ce duopole mixte marqua pendant quelques décennies la politique ferroviaire fédérale, placé sous la surveillance d’un organisme indépendant de réglementation. Mais en 1987, sous l’influence des politiques de déréglementation en vogue en Occident, Ottawa fit adopter une nouvelle loi sur les transports, inspirée d’un énoncé au titre évocateur, « Aller sans entraves »(17), en vue d’alléger la réglementation et de libéraliser les prix, le transport ferroviaire ayant été conçu jusqu’alors comme un service public. Puis en 1996, le gouvernement libéral de Jean Chrétien privatisa le CN, dont les actions finirent vite dans des mains américaines(18). L’article 5 de la Loi sur les transports au Canada résume bien le nouvel esprit déréglementaire qui règne dans le pays depuis plusieurs années. Même si la lecture en est pénible - la langue législative fédérale tient souvent du galimatias - il est bon d’y jeter un coup d’œil :
Il est déclaré qu’un système de transport national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un environnement durable et qui utilise tous les modes de transport au mieux et au coût le plus bas possible est essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la croissance économique dans les régions rurales et urbaines partout au Canada. Ces objectifs sont plus susceptibles d’être atteints si :
· a) la concurrence et les forces du marché, au sein des divers modes de transport et entre eux, sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces;
· b) la réglementation et les mesures publiques stratégiques sont utilisées pour l’obtention de résultats de nature économique, environnementale ou sociale ou de résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans pour autant favoriser indûment un mode de transport donné ou en réduire les avantages inhérents;
· c) les prix et modalités ne constituent pas un obstacle abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exportation des marchandises du Canada;
· d) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation des personnes, y compris les personnes ayant une déficience;
· e) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour le maintien d’un système de transport intégré.
Cet article constitue un habile exercice de camouflage des véritables intentions du législateur fédéral. On y brode des phrases sur la sécurité des transports, le respect d’un environnement durable et sur le mariage entre le public et le privé; seulement, ce qui frappe le plus, c’est la clarté avec laquelle on énonce les credos du libéralisme économique : primat de la rentabilité du système et primat de la concurrence et des forces du marchés, reconnues comme « les principaux facteurs en jeu dans la prestation de services de transport viables et efficaces »; tout dessein de service public ferroviaire est abandonné par un souverain jaloux encore de ses vieilles prérogatives mais point désireux de bousculer lesdites « forces », avec des conséquences que l’on sait, dont la tragédie du Lac Mégantic n’est pas éloignée. Sans compter que le primat reconnu aux forces du marché a emporté la marginalisation du transport des passagers, confié à une société sans moyens, Via Rail, dont le réseau est digne du Tiers-Monde, en faveur du transport des marchandises, activité très lucrative qui a valu au duopole privé CN-CP des profits mirobolants, reversés pour une bonne part à des actionnaires étrangers. Le duopole, en se concentrant sur les activités les plus rentables, utilisent moins de rails, soit environ 74% du réseau au lieu de 90% pendant les années 1990, ce qui a laissé la voie libre à une quarantaine de petites compagnies ferroviaires, dont la tristement fameuse Montreal & Maine Atlantic Railway. Après avoir connu une baisse à la fin des années 1990, le nombre d’accidents ferroviaires a cru significativement entre 2002 et 2005, au point que le ministre fédéral des transports s’avisa en décembre 2006 de demander l’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire(19). Bref, tout laisse croire que la rationalisation du système de transports ferroviaires s’est faite au détriment de la sécurité.
Une pensée dissociée
Dans les cercles médiatiques et universitaires, on discute peu de ces considérations bassement matérielles, et encore moins de leur rapport avec l’ordre constitutionnel canadien. Il faut dire que beaucoup ont accoutumé de n’envisager dans la discussion publique que les questions sociales, morales, culturelles, en laissant de côté, comme si elles étaient lointaines, sans intérêt ou incompréhensibles, les bases matérielles de la civilisation. Cette dissociation est sans doute l’effet du fédéralisme canadien lui-même, tel qu’il a été conçu peu avant 1867. Au Canada français se distingua un penseur influent de l’union fédérale, Joseph-Charles Taché, qui publia en 1858 un ouvrage en présentant l’architecture. Il était convaincu qu’elle serait fondée sur une division nette des tâches : en vertu de sa vocation spirituelle, le Québec s’occuperait de tout ce qui touche à l’immatériel, culture, éducation, alors que l’État fédéral prendrait en charge la dimension matérielle de l’union, les sciences, la technique, les conditions de la prospérité économique, etc. (20). Or la tragédie du Lac Mégantic et les réactions qu’elle a suscitées sont peut-être le reflet de cette vieille division qui, par l’effet de l’habitude, conduit la population et la classe politique à nourrir une pensée dissociée, qui sépare culture et nature, mémoire et territoire, esprit et matière. Un peu comme si de la vallée laurentienne et du bouclier de forêts et de lacs jadis arpentés par leurs ancêtres les Québécois n’étaient que des locataires précaires qui, se berçant sur leur balcon, regardent le train passer (21).
Marc Chevrier
Notes
1. « L’esprit de 1867 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 17, no 1, 1963, p. 21.
2. Cité par Stéphane Kelly, La Petite Loterie, Boréal, Montréal, 1997, p. 52.
3. Pour un exemple de critique républicaine de l’endettement public dans le contexte des débats sur l’union canadienne, voir le texte d’Alphonse Lusignan, « La Confédération, couronnement de dix ans de mauvaise administration », Montréal, Le Pays, 1867, p. 19-22, dont des extraits sont reproduits dans Marc Chevrier, Louis-Georges Harvey, Stéphane Kelly et Samuel Trudeau, De la République en Amérique française, Québec, Septentrion, 2013, p. 203-208.
4. Voir les développements que j’ai consacrés à cette question dans La République québécoise, Montréal, Boréal, 2012.