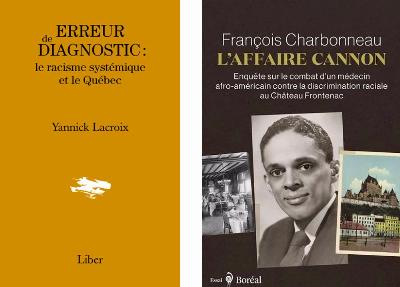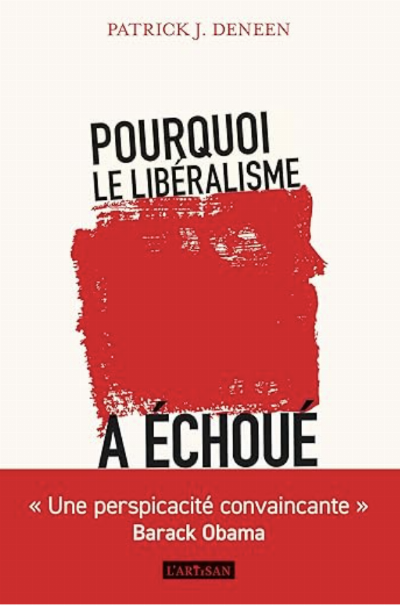Le souverainisme français ou la protestation contre la machine Europe
La construction européenne a toutefois dressé contre elle des sceptiques et des opposants. Le référendum que la France a tenu en septembre 1992 sur le traité de Maastricht a montré que l’appui de la population française au projet européen était plutôt mitigé; à peine 51% des suffrages appuyèrent ce traité qui devait mettre en marche l’unification monétaire de l’Union. Des hommes politiques comme Philippe Séguin et Charles Pasqua ont mené l’opposition contre un processus d’intégration qui menaçait à leur avis l’identité de la France ou entamait sa souveraineté. Depuis les dernières élections européennes de 1999 – largement boudées par les électeurs français, Charles Pasqua et ses sympathisants ont commencé à se réclamer du «souverainisme», terme emprunté aux souverainistes québécois. Ce nouveau mouvement politique français cherche à rétablir une double souveraineté: la souveraineté nationale de la France, c’est-à-dire la capacité de l’État français de prendre librement des décisions sur des questions vitales sans les contraintes envahissantes venues de Bruxelles; la souveraineté du peuple français, c’est-à-dire son droit de regard sur ceux qui le gouvernent.
Bien des Québécois seraient surpris d’apprendre que des Français se disent «souverainistes», alors qu’on a d’emblée présenté l’Union européenne comme un modèle pour l’avenir du Québec. Cette surprise s’explique sans doute par le fait que des Québécois verraient dans l’Union ce qu’ils pourraient gagner par l’acquisition d’un nouveau statut politique et que des Français se désolent d’y voir ce que la France a perdu ou est en train de perdre. Bien malin qui pourrait livrer les propriétés de ce modèle, si tant est qu’il existe. Pour le bénéfice du lecteur nord-américain, disons que l’Union européenne c’est un peu comme si, par hypothèse, les Premiers ministres des États provinciaux au Canada, réunis en conseil, se substituaient au parlement fédéral. Toute la législation fédérale serait ainsi approuvée par les premiers ministres provinciaux, sur proposition d’une commission d’experts nommés par les gouvernements provinciaux. Le parlement fédéral participerait tout au plus à la procédure législative sans en être le maître. Il n’y aurait plus de gouvernement fédéral, ni ministre, ni premier ministre, et l’administration publique fédérale verrait sa taille réduite à celle d’un secrétariat comptant à peine plus de 3 000 employés. Les ressources de cette structure commune représenteraient moins de 3% du PIB. Cependant, pour légère qu’elle paraisse, elle régirait en profondeur l’union économique, administrerait des politiques communes en matière agricole, par exemple, et harmoniserait les lois des États en plusieurs autres domaines.
Le rétablissement du politique par la «révolution» souverainiste: un essai de Marc Joly
L’essai que vient de faire paraître le jeune Marc Joly, militant du Mouvement des citoyens présidé par Jean-Pierre Chevènement, fournit un éclairage utile sur la doctrine souverainiste française1. Il ne s’agit certes pas de la première analyse proprement souverainiste. Le député européen Paul-Marie Coûteaux, qui revendique la paternité de l’importation du concept de «souverainisme», avait déjà esquissé dans plusieurs de ses ouvrages les éléments d’une pensée souverainiste. Le souverainisme de Marc Joly se distingue par sa prétention à vouloir fonder sur une analyse scientifique les stratégies d’action que devraient adopter les souverainistes français.
Bien que du point de vue juridique les institutions européennes – le Conseil des ministres, la commission de Bruxelles et le parlement de Strasbourg soient des entités distinctes des États membres de l’Union, dans l’esprit de Marc Joly, cette séparation n’est pas si nette. En fait, ces institutions fonctionnent de connivence avec les États, car elles sont contrôlées par les élites nationales elles-mêmes, qui voient à diriger l’intégration européenne contre leur propre État. Si ces derniers ont vu leur souveraineté s’amoindrir depuis 1957, ce n’est point sous l’impulsion d’un gouvernement européen, qui n’a jamais existé, mais sous celle des élites nationales qui, travaillant de concert, ont imposé à leur population, par le truchement d’institutions échappant à leur contrôle, des décisions que ces élites n’auraient pas osé adopter dans le cadre national. En somme, soutient Joly, l’Union européenne crée une dissociation croissante entre ce qu’il appelle la réalité du pouvoir – le lieu où s’exerce le pouvoir politique – et la réalité de la démocratie – l’espace où se situe le débat politique. Alors que la démocratie est restée rattachée à la vie nationale, animée en France par la rivalité entre la gauche et la droite, l’exercice du pouvoir ultime s’est déplacé progressivement à Bruxelles. Or, cette dissociation s’est réalisée, selon Joly, au nom d’une idéologie apolitique qui ne vise que l’efficacité. Ce fonctionnalisme nie toute transcendance politique en réduisant les conflits politiques en problèmes techniques résolus par des experts en dehors des forums démocratiques. En effet, l’Union ne vise pas tant à créer un nouvel État-nation doté d’un véritable gouvernement européen qu’à entretenir son propre système. Il s’ensuit que les élites politiques nationales, portant le double chapeau de la patrie et de l’Europe, se trouvent déconnectées des populations qui les élisent. Le déficit démocratique tant reproché aux institutions européennes ne serait donc pas une anomalie passagère; c’en serait le principe même.
Selon Joly, la construction européenne a ainsi débouché sur un processus de recomposition des pouvoirs qui a imbriqué les États nationaux dans une nébuleuse complexe d’intérêts où règnent le lobbying et le consensus technocratique. Le système européen entretient fondamentalement deux ambiguïtés: les décisions qu’il produit apparaissent comme une réalité extérieure s’imposant aux États, quoique ce soient eux qui les ont suscitées. (Ce serait l’administration française, prétend Joly, qui aurait incité Bruxelles à adopter le controversé projet de règlement interdisant le fromage au lait cru); les institutions de ce système, en principe séparées et concurrentes, sont solidaires en pratique. On voit à tort, d’après Joly, dans les institutions européennes un embryon de fédéralisme. Dès avant le traité de Rome de 1957, les fondateurs du marché commun avaient écarté la méthode fédérale au profit d’une méthode qui ferait participer les élites nationales à la déconstruction de leur propre État.
L’enjeu de la contestation souverainiste est dès lors la «refondation» du politique contre un système qui le nie. Joly n’hésite pas à appeler de ses vœux une révolution, comparable à celles qui renversèrent les régimes communistes de l’Europe de l’Est en 1989, qui accomplirait un changement de garde à la tête des États. Voulant élargir la contestation souverainiste au-delà de la clientèle votant traditionnellement à droite en France, Joly entonne le refrain de la lutte des classes. Il écrit: «Le concept de citoyenneté européenne est une escroquerie intellectuelle […] ce n’est rien d’autre que l’instrument des privilégiés pour échapper aux contraintes de la solidarité nationale.» Pour le souverainisme de gauche de Joly, la «mondialisation libérale» et la construction européenne sont toutes deux à combattre.
Si audacieuses qu’elles paraissent, les thèses de Joly se buteront à l’incrédulité de bien des lecteurs. Malgré l’ambition de l’auteur de les fonder sur une analyse prétendument scientifique, il y a loin de la coupe aux lèvres. Son argumentation s’encombre d’une lourde quincaillerie de concepts dont l’utilité n’est pas assurée et qui est étayée par assez peu de preuves empiriques. Ainsi, Joly soutient que la construction européenne a dépossédé les États de l’essentiel de leurs moyens d’action et de décision, transférés à Bruxelles ou neutralisés par des normes communautaires. C’est à croire que la France n’est plus qu’une coquille dont la substance a été ravie par Bruxelles. On peut bien déplorer que la France n’exerce plus souverainement plusieurs de ses anciennes prérogatives, elle demeure toutefois encore un État souverain disposant d’une armée et d’ambassades, un État qui signe des traités, établit son budget et prélève l’essentiel des impôts, organise les systèmes de santé et d’éducation, fixe la loi pénale et dirige la police.
Les normes européennes, il est vrai, enserrent de plus en plus l’exercice que la France fait de plusieurs de ses compétences, mais c’est encore elle qui applique ces normes. On conçoit mal comment la «réalité de la démocratie» demeure l’apanage des États s’ils ne jouissent encore de pouvoirs véritables. Les souverainistes desservent leur cause à trop souvent crier au cataclysme sitôt que la somptueuse Marianne perd un de ses cheveux. Joly croit voir dans l’Union une conspiration des élites. Où est le verbatim du complot ourdi? L’auteur tombe aussi dans le travers du chauvinisme hexagonal. À le lire, seule la France pourrait mener une politique indépendante en Europe et la fronde souverainiste. Or, il n’y a que de petites nations comme l’Irlande et le Danemark qui ont su dire non à un traité européen, point la France.
L’Europe, un empire technique?
L’Union européenne a éveillé chez nombre de politiques et d’intellectuels des fantasmes d’empire. On a cru y reconnaître, qui la nouvelle Rome, qui un Saint-Empire berlinois, qui un avatar élargi de l’empire des Habsbourg. Joly rejette, avec raison, les comparaisons faciles que l’on pourrait établir entre l’Union, qui est encore un nain militaire, et les formes anciennes d’empires dominés par une dynastie ou des césars. Cependant, l’idée d’empire ne perd pas toute pertinence pour autant, surtout si on l’entend sous l’acception contemporaine que lui a donnée Jean-Marie Guéhenno, c’est-à-dire un réseau informel qui concentre le pouvoir sans posséder ni centre géographique, ni hiérarchie verticale. En ce sens-là, le système européen ressemble à un empire technique qui a pour but la puissance économique et qui se déploie en incorporant les États-nations. Tout à la poursuite de l’efficacité économique, le système européen n’a eu de cesse d’accroître son domaine territorial, de soumettre les politiques des États à la logique de la déréglementation et d’attirer vers lui les élites heureuses d’échapper au circuit des carrières nationales.
La France et le Québec, des nations embourbées?
Malgré ses outrances péremptoires, les analyses de Marc Joly ont le mérite de mettre en lumière une caractéristique trop souvent oubliée du système européen: bien loin de former un véritable gouvernement qui se superpose à ceux des États-nations, il constitue un système de pouvoirs auquel participent directement ces États et leurs élites dirigeantes. Le plus inquiétant dans le débat sur l’avenir de l’Europe, ce n’est point que Bruxelles enlève aux États telle ou telle compétence, mais l’intention qui précède la recomposition des pouvoirs sur laquelle s’est édifiée l’Union européenne. Dans ce débat, on ne peut s’abstraire du fait qu’une bonne partie de l’intelligentsia et de l’élite gouvernante en Europe, et notamment en France, serine à qui veut les entendre toujours cette même histoire: les nations sont des héritages encombrants, débarrassons-nous en. Simone Weil avait bien vu dans L’enracinement en quoi précisément la Seconde Guerre mondiale serait une catastrophe pour l’Europe: ce conflit consacrerait l’hégémonie des États-Unis, jeune nation oublieuse de tout passé. Depuis, lente à exorciser ses démons, l’Europe occidentale secrète sa propre honte d’avoir une longue mémoire, et plusieurs de ses intellectuels travaillent à la sape de la maison qui les a nourris. La nation était la victime toute désignée pour expier, par son effacement, tous les crimes infâmes qu’on a commis en son nom. Elle est devenue un monstre commode qui dispense ces intellectuels de penser. À ce propos, l’écrivain Benoît Duteurtre a écrit: «Le monstre de notre époque n’est pas tant la nation que cette loi brutale du Meilleur des mondes qui appauvrit l’esprit, aplatit la vie et suscite en retour, du Proche-Orient à l’ex-monde soviétique, les réactions les plus barbares.»2
Les souverainistes français prennent bien soin de distinguer leur combat de celui des souverainistes québécois. Ces derniers visent l’indépendance politique du Québec, les autres, le rétablissement de la souveraineté d’un État déjà indépendant. Dans sa préface de l’ouvrage de Joly, Philippe de Saint Robert écrit au sujet du souverainisme québécois: «Que les Québécois ne sachent pas ce qu’ils veulent, ou ne l’osent pas, on s’en est souvent rendu compte au cours des dernières années. Pour atténuer leur revendication au regard de leur puissant partenaire canadien, ils feignent de prendre pour modèle l’Union européenne, sans bien se rendre compte que cette machine fonctionnaliste… va exactement dans le sens inverse de ce qu’ils imaginent…» Les Québécois ne savent pas ce qu’ils veulent, sans doute, mais les Français savent-ils davantage où ils vont? Que le souverainisme croisse des deux côtés de l’Atlantique est peut-être le signe que la France et le Québec partagent désormais un sort commun. Minées de l’intérieur par une partie de leur avant-garde qui aimerait en hâter la dissolution, ces nations cousines s’embourbent de l’extérieur dans des systèmes politiques qui en contraignent l’autonomie et qui les annexent à de grands blocs économiques. Seraient-elles donc si lasses d’exister?
Notes
1. Marc Joly, Le souverainisme. Pour comprendre l’impasse européenne, Paris, François-Xavier De Guibert, 2001, 289 p.
2. Benoît Duteurtre, Requiem pour une avant-garde, Paris, Robert Laffont, 1995.