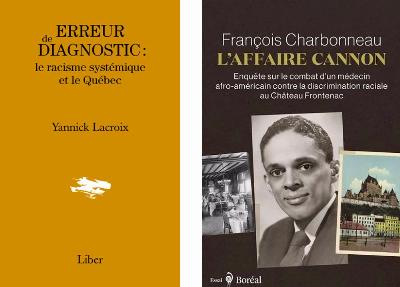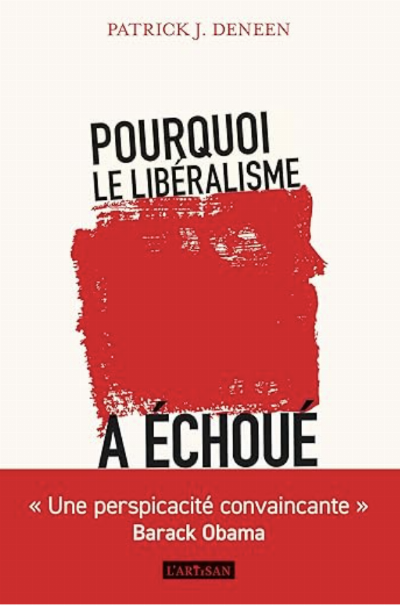Le papisme légal
Ce n'est pas un hasard si Mill salue la Réforme et ses suites. Si l'on regarde l'histoire des idées, ces fleurons du libéralisme politique que sont les libertés de conscience, d'opinion et d'expression doivent beaucoup à la liberté d'examen que les protestants du XVIe siècle arrachèrent par un schisme sanglant à l'état ecclésiastique qui dominait l'Église romaine. De tous les réformateurs, le plus éloquent fut sans doute Martin Luther, ce moinillon de Wittenberg, une petite ville de la Saxe - aujourd'hui le Land de Saxe-Anhalt -, dont les idées changèrent la face de l'humanité, du jour qu'il afficha, le 31 octobre 1517, ses quatre-vingt-quinze thèses sur les indulgences, sorte d'acomptes sur le paradis dont l'Église faisait à l'époque un commerce florissant. De ce manifeste de 1517 partit le raz de marée du protestantisme, qui propagea l'idée que Luther prôna toute sa vie: le libre examen, à savoir que «chacun, maître d'interpréter à sa guise l'Écriture, pût en faire à soi-même ses dogmes» (2).
Interrogé sur ses idées en 1520 devant l'empereur Charles Quint à Trèves, Luther rétorqua à l'official qui lui demanda de se rétracter: «Tant que tu ne m'auras pas convaincu par des preuves scripturaires ou une raison d'évidence, - car je ne crois ni au Pape, ni aux conciles, qui ont souvent erré -, je suis lié par mes propres textes.» Peu après, dans son Manifeste à la Noblesse chrétienne d'Allemagne, il s'attaqua à la «tyrannie» qu'exerçaient les «Romanistes» sur la Chrétienté. «Les Romanistes ont avec une grande habilité dressé autour d'eux trois murailles, dont ils se sont garantis jusqu'ici afin que personne ne puisse les réformer; et c'est ainsi que toute la Chrétienté a été réduite à la misère.» L'une de ces murailles était la prétention de ces Romanistes, le Pape et les prêtres, d'être les seuls maîtres de l'Écriture et que nul n'a le droit de l'interpréter, si ce n'est le Pape. Contre cette muraille, Luther lança cette charge: «Ils se glorifient seulement de leur autorité, bavardent en paroles éhontées, en se vantant de ce que le Pape ne peut errer dans la foi, qu'il soit mauvais ou preux, mais ils ne peuvent citer une syllabe en ce sens.» Contre le droit que revendiquait le Pape d'expliquer seul l'Écriture et d'imposer son interprétation, Luther opposa cette réponse: «... nous sommes tous prêtres, ... nous avons tous une seule foi, un seul Évangile, une pure série de sacrements. Comment donc n'aurions-nous pas le pouvoir de goûter et de juger de ce qui est juste ou faux dans la foi.» Bref, le sacerdoce est universel. Cette bible que les Romanistes tenaient à l'écart du peuple, Luther la lui remit, en la traduisant du latin et du grec dans la langue vulgaire, un Hochdeutsch qui donna à l'allemand ses lettres de noblesse. Le fidèle, l'homme du commun peut lui aussi s'approprier les textes sacrés et en devenir l'interprète. «Nous devons être libres et courageux, écrivait toujours Luther en 1520, et ne pas nous laisser arracher - comme le dit saint Paul - l'esprit de liberté (der geyst der Freyheit), par les inventions verbales du Pape, mais au contraire juger avec énergie tout ce qu'ils font et permettent, selon notre intelligence de la foi, et les contraindre à obéir à ce qui est meilleur, et non selon leur propre interprétation.»
Il ne faut pas croire toutefois que Luther ait été le précurseur du libéralisme tel que nous l'entendons aujourd'hui. S'il défendit le libre examen, Luther soutint aussi le serf arbitre contre les thèses d'Érasme, attaché à la conception augustinienne du libre arbitre. Certes, Luther préconisa le droit du fidèle de lire lui-même les Écritures et de se pénétrer de leurs lumières. Cependant, ces lumières viennent par l'opération du Saint Esprit, non par celle de la raison ou de la science humaine. Et Luther ne prôna pas la limitation du pouvoir temporel. Bien au contraire, en prêchant d'un côté la totale soumission du Chrétien à ce dernier, et en attaquant de l'autre l'autorité du Pape et de l'Église, Luther brisait le seul contre-pouvoir qui pût faire contrepoids aux princes allemands et à l'empereur, tant et si bien qu'on a pu voir dans le réformateur un précurseur non du libéralisme mais de l'autoritarisme.
Des théologies séculières
En quoi ces vieilles querelles théologiques, qui opposent encore catholiques et protestants, peuvent-elles éclairer nos débats présents? Regardons, par exemple, les écoles de pensée qui s'affrontent aux États-Unis sur l'interprétation du texte constitutionnel. Le conflit, que l'audition du juge Bork au sénat américain en 1987 a contribué à médiatiser, met en scène les conservateurs et les progressistes de l'interprétation constitutionnelle. Les premiers, les «non-interpretivists», voient dans le texte constitutionnel une parole «figée» par l'intention des constituants de 1787, dont le juge ne peut s'écarter, sauf à la restituer dans son sens authentique. Les autres, les «interpretivists», considèrent le jugement comme essentiellement un acte d'interprétation. Comme un texte fixé en 1787 ne peut pourvoir à tout, le juge doit nécessairement l'augmenter par ses interprétations, l'adapter aux valeurs des nouvelles générations, aux fins entre autres de perfectionner la démocratie. Il existe aussi un autre débat, moins connu, entre ceux qui remettent d'emblée aux seuls tribunaux l'application du texte constitutionnel, et d'autres, comme Louis Fisher, pour qui «... constitutional law is not a monopoly of the judiciary. It is a process in which all three branches converge and interact with their separate interpretation (3).» L'interprétation du texte constitutionnel est selon lui une entreprise conjointe, qui reconnaît autant au législatif, à l'exécutif qu'au judiciaire le devoir de définir les valeurs de la politie, d'en résoudre les conflits et de veiller à l'intégrité de l'État.
Un autre américain, Sanford Levinson, a mis en lumière l'étrange analogie qui existe entre les querelles théologiques nées de la Réforme et les thèses actuelles sur le rôle de la justice constitutionnelle dans une démocratie libérale. Dans son essai Constitutional Faith, Levinson baptise autrement le conflit des conceptions de l'interprétation constitutionnelle. Il contraste une vision protestante avec une autre, la catholique. La première postule la dispersion de l'autorité interprétative; il ne saurait y avoir d'interprète infaillible et exclusif du texte constitutionnel. La deuxième concentre l'autorité interprétative dans une institution, l'appareil judiciaire, chapeautée par la Cour suprême, laquelle serait au système politique ce qu'est le pape à la religion catholique. On se rappellera l'aphorisme du juge Jackson de la Cour suprême des États-Unis, qui affirma sans ambages en 1953: «We are not final because we are infaillible, we are infaillible because we are final.» Selon Levinson, ces deux visions concurrentes du constitutionnalisme aux États-Unis dédoublent deux vieilles questions théologiques:
Toutefois, il existe des conceptions concurrentes du constitutionnalisme qui ont pour pendants les diverses conceptions du christianisme (et d'autres religions) dont je viens de discuter plus haut. Par exemple on doit tout d'abord décider ce qu'il faut entendre par «Constitution» avant même d'arrêter ce qu' «elle» peut vouloir dire. La «Constitution» renvoie-t-elle au texte particulier du document rédigé en 1787, amendé par la suite de temps à autre, ou comporte-t-elle aussi une composante non écrite que l'on peut déduire des présupposés implicites des traditions politiques américaines? En second lieu, on doit répondre à cette autre question, relative à l'autorité institutionnelle apte à interpréter la Constitution. La Constitution s'institutionnalise-t-elle (s'incarnant en tant que «parole faite chair») par les personnes particulières exerçant une fonction judiciaire? (4)
Ainsi, le catholicisme constitutionnel, ou papisme légal, combine deux thèses: 1) le sens du texte constitutionnel peut être augmenté de celui qui leur prêtent les juges et les docteurs en droit, ou ce qu'on appelle en droit la doctrine, et ainsi varier suivant l'évolution des valeurs de la société. 2) Les tribunaux, au premier chef la Cour suprême, possèdent une autorité exclusive pour disposer définitivement des conflits d'interprétation soulevés par la Constitution. C'est là la vision forte du papisme légal. On peut en imaginer une vision atténuée ou fondamentaliste. Dans ce cas, les juges sont astreints à respecter l'intention première du constituant, quitte à la figer à jamais, bien qu'ils soient les seuls habilités à se prononcer sur l'interprétation du texte.
Le papisme légal canadien
Si l'on veut observer le papisme légal dans toute sa splendeur, il faut jeter ses regards au-delà du 45e parallèle, dans cette belle monarchie constitutionnelle qui se donne en exemple d'État post-moderne: le Dominion du Canada. Cette fédération tarda à acquérir la souveraineté étatique. En 1931, par le Traité de Westminster, puis enfin en 1982, par une dernière loi du parlement impérial, elle accéda à l'indépendance, quoique en conservant le monarque constitutionnel. Jusqu'en 1982, dix parlements provinciaux et un parlement fédéral, héritiers de la suprématie parlementaire, avaient régné sans partage. Par la réforme de sa constitution accomplie en 1982, le Dominion accordait, à l'instar de la république américaine, à l'ensemble des tribunaux de droit commun, eux aussi présidés par une Cour suprême, le pouvoir d'annuler les lois jugées incompatibles avec une charte constitutionnelle des droits, la Charte canadienne des droits et libertés. Le premier ministre Pierre-Elliott Trudeau fut le principal instigateur de cette réforme, somme toute conservatrice, qui évitait de bousculer l'organisation judiciaire du pays, bien qu'il eût été concevable de confier le contrôle des lois à un tribunal spécialisé, comme en Europe. Ainsi, n'importe quel citoyen peut saisir un tribunal et lui demander d'annuler une loi contraire aux droits constitutionnalisés ou de lui octroyer toute autre réparation appropriée. Quel esprit animait cette réforme? Le droit, écrivait le premier ministre Trudeau en 1970, doit servir à préserver les valeurs de la société canadienne; «bien utilisé, [il] permet le changement sans sacrifier la stabilité (5)». Que voulait-il dire au juste? Pour le savoir, examinons ce qui est advenu de la justice constitutionnelle au Canada depuis 1982.
Entre 1982 et 1996, les tribunaux ont prononcé au Canada soixante et une annulations de textes de loi au motif qu'ils enfreignaient la nouvelle charte constitutionnelle. De ce nombre, environ une quarantaine sont le fait de la Cour suprême, le reste, des cours d'appel des États provinciaux et des tribunaux de première instance. L'invalidation faite, la balle revient dans le camp du législateur. Généralement, les parlementaires se mettent à discuter du jugement prononçant l'invalidité de la loi, en apprécient les conséquences, puis tendent de concevoir une loi de remplacement. Ainsi, sur ces soixante et une annulations, quarante-quatre d'entre elles ont poussé le législateur compétent à modifier sa loi. En sept occasions seulement le législateur a abrogé la loi; en treize autres, il la laisse telle qu'elle est, amputée de articles invalidés. Le législateur agit diligemment; dans soixante-quinze pour cent des cas d'annulation, le législateur prend de nouvelles dispositions dans les deux années qui suivent le jugement.
En très peu de cas voit-on un parlement protester contre un jugement d'invalidation, contester l'interprétation que les juges ont tirée du texte constitutionnel. La soumission qu'observent les législateurs canadiens et québécois vis-à-vis des décrets judiciaires est d'autant plus étonnante que le droit constitutionnel du Dominion leur accorde formellement le pouvoir de renverser une décision de justice qui annule l'une de leurs lois. Ainsi, en théorie, il est concevable qu'après l'annulation d'un texte, les parlementaires remettent en question le bien-fondé de la décision de justice et adoptent une loi de dérogation, qui suspende l'effet de cette décision. Ce pouvoir légal, que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît à tous les parlements du Dominion, n'est pas vraiment un veto. Il suspend l'application du contrôle judiciaire pendant une période d'au plus cinq ans, et à l'égard seulement de certains articles de la Charte canadienne, qui concernent les libertés fondamentales, les garanties pénales et les droits à l'égalité. L'usage de ce pouvoir est cependant renouvelable, si bien que la suspension du contrôle judiciaire pourrait durer indéfiniment. En théorie, ce pouvoir de dérogation tout à fait constitutionnel met en place les conditions nécessaires à l'expression d'une voix autre que judiciaire, qui puisse elle aussi se poser en gardienne et en interprète des libertés constitutionnelles. Il est donc possible que le judiciaire et le législatif au Canada deviennent coresponsables de l'application de ces libertés, chacun fondé à faire valoir sa conception des libertés constitutionnelles, quitte à l'opposer, dans une espèce de dialogue, à celle que l'autre pouvoir dégage. En réalité toutefois, le catholicisme constitutionnel a triomphé du protestantisme, la parole du juge, une fois exprimée, réduisant au silence celle du législateur.
En effet, ce pouvoir de dérogation est en voie de tomber en désuétude. En 1988, la Cour suprême du Canada annula le régime de la Charte de la langue française qui rendait obligatoire l'affichage unilingue français dans le domaine commercial, au motif qu'il enfreignait la liberté d'expression. L'Assemblée nationale du Québec s'empressa de voter une loi de remplacement, qui assouplissait le régime de l'affichage commercial et qui incorporait une clause de dérogation, nécessaire aux yeux du gouvernement libéral de Robert Bourassa pour protéger la Charte de la langue française de toute autre contestation judiciaire. Cependant, si l'Assemblée nationale recourut au pouvoir de dérogation, ce n'était point pour dire aux juges de la cour, tous nommés par l'exécutif fédéral, qu'ils s'étaient trompés dans l'interprétation de la Charte canadienne ou de la loi québécoise, encore moins pour leur disputer leur conception du constitutionnalisme. Certes, de nombreuses voix s'élevèrent pour affirmer qu'il revient à l'Assemblée de garantir le visage linguistique du Québec, décision politique qui n'entre pas dans la compétence des juges. Cependant, invoquer la suprématie parlementaire au nom de la priorité du politique sur le droit, ce n'est pas se poser en interprète de la constitution. C'est se mettre en dehors de la démocratie constitutionnelle, non s'y insérer.
Ce qui explique peut-être pourquoi au Canada anglais on a décodé, à tort ou à raison, la loi dérogatoire de l'Assemblée nationale comme une violation éhontée des libertés constitutionnelles. Il n'en fallait pas plus pour retourner l'opinion publique canadienne-anglaise contre le projet d'accord constitutionnel que les premiers ministres du Dominion avaient conclu en juin 1987 pour réparer l'affront fait au Québec par la réforme de 1982, qui avait réduit son statut politique et ses compétences. Comme le constata un fin observateur de la justice constitutionnelle au Canada: «After the events of December, 1998, it became virtually impossible to defend the existence of section 33 (le pouvoir dérogatoire) outside Quebec (6).«Désormais au Canada anglais, une règle de droit non écrite frapperait d'illégitimité l'exercice du pouvoir de dérogation.
Or, ce pouvoir semble maintenant susciter une suspicion équivalente au Québec. Y recourir y paraît ou illégitime, ou politiquement trop coûteux. Ainsi, en octobre 1997, la Cour suprême invalidait le régime réglementant les dépenses admissibles dans une campagne référendaire, qui avait encadré les trois référendums d'autodétermination tenus au Québec en 1980, 1992 et 1995. Ce régime limitait plus qu'il ne fallait la liberté d'expression des personnes et des groupes tiers, non affiliés à l'un ou l'autre des comités nationaux qui doivent regrouper aux termes de la loi les forces adverses dans une campagne référendaire. Aussitôt après ce jugement, des personnalités pressèrent l'Assemblée nationale de rétablir l'effectivité de la loi québécoise par l'adoption d'une clause de dérogation. Cette option fut vite exclue. Ainsi, les parlementaires québécois s'évertuèrent à fixer un nouveau régime de limitation des dépenses électorales qui se conformerait au jugement de la cour. Il n'était point question d'engager avec la Cour suprême un dialogue sur la portée de la liberté d'expression en matière électorale, encore moins de lui donner la réplique par une interprétation plausible de la manière de réconcilier une réglementation équilibrée du processus électoral avec les libertés constitutionnelles
Également, les lois de remplacement votées par les parlements révèlent l'absence d'une conception «protestante» ou commune de l'interprétation constitutionnelle, dont la Loi constitutionnelle de 1982, pour imparfaite et controversée qu'elle fût, aurait néanmoins pu favoriser l'émergence. Tout ce que révèlent les débats parlementaires consécutifs à l'annulation d'une loi est la volonté des parlementaires de se conformer aux conclusions des tribunaux. Les parlementaires le font d'ailleurs si bien que, lorsque la Cour indique dans son jugement une solution de rechange à la loi fautive, ils s'empressent de l'incorporer dans la nouvelle loi, sans véritable discussion. Les corps législatifs au Canada, déjà réduits à enregistrer les volontés de l'exécutif, tombent cois devant les oracles judiciaires. Dans une chronique publiée le lendemain de l'avis consultatif de la Cour suprême sur la souveraineté du Québec, le journaliste Jeffrey Simpson décrivait ainsi ce monologue: «... in our constitutional democracy, courts talk, legislature listen, then consider options about how - not whether - to respond to courts rulings about Charter violations (7).» Le 17 juin 1998, le Globe and Mail de Toronto avait tiré des conclusions similaires: «At present, interesting and significant judgments generate all kinds of debate in the media, in the Commons lobby and in legal circles. The floor of Commons, by contrast is dead silent, greeting pronouncements from the Supreme Court with vague deference or at most, mild unease.» Par ailleurs, la Cour suprême elle-même ne voit guère se nouer de dialogue entre elle et le législatif. Dans un commentaire donnée à La presse le 8 avril 1998, le juge en chef Antonio Lamer a déploré l'absence d'un tel dialogue, soulignant que bien des décisions de la Cour «se heurtent au silence écrasant du Parlement».
Mais ce silence écrasant ne serait-il pas la conséquence de la muraille dogmatique que la Cour a érigée autour d'elle? Dès 1985, la Cour décréta que les déclarations parlementaires du constituant n'ont pas de valeur probante à ses yeux pour interpréter le texte constitutionnel. Ce faisant, elle disqualifie la prédétermination du texte faite par le constituant, et se confère à elle-même, et à tout l'appareil judiciaire qu'elle préside, un monopole sur l'interprétation du texte constitutionnel. Que penserait-on d'un pape qui disposerait que le recours à l'Ancien Testament ou aux épîtres de Saint Paul est de peu de poids pour interpréter l'Évangile? Le texte étant ainsi libéré de toute attache au contexte historique de son adoption, la Cour peut alors le transformer à loisir, lui «insuffler» un sens nouveau, que ses longs jugements, aux opinions multiples et souvent discordantes, lui prodigueront. L'immense liberté interprétative que la Cour s'est donnée la conforte ainsi dans le pouvoir d'accorder au texte un sens contraire à l'intention du constituant. Ainsi, en 1988, elle invalida les dispositions du Code criminel fédéral qui pénalisaient l'avortement. Elle invoqua le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, alors que les rédacteurs du texte étaient persuadés que le libellé exclurait l'invalidation judiciaire.
Cette cour vraiment suprême a une conception panjuridique de la société: il ne saurait y avoir de domaine que le droit ne toucherait pas. Contrairement à la Cour suprême des États-Unis, la cour canadienne ne refuse pas d'entendre une réclamation pour la raison qu'elle soulève une question politique. En 1985, elle se déclarait compétente pour réviser la décision du cabinet fédéral d'autoriser l'essai de missiles de croisière en Alberta. En 1998, elle se prononçait sur la plus politique des questions: le statut d'une minorité nationale, qui à deux reprises s'était vue demander d'accéder au concert des nations souveraines. On aura beau prier cette cour de se dessaisir d'une question politique, elle y trouvera toujours du droit. Dans son esprit, le droit et le politique s'interpénètrent, le premier définissant le deuxième.
La Cour s'est ainsi enhardie à annuler nombre de textes de loi, allant jusqu'à penser que le contrôle de validité des lois inclut aussi leur rectification pure et simple. Ainsi, la Cour s'est attribué le pouvoir, alors qu'elle ne peut citer une seule syllabe à l'appui de sa prétention, de modifier elle-même le libellé des textes qu'elle juge incompatibles avec la constitution. Inutile donc de laisser au législateur le soin de refaire lui-même son ouvrage, d'en délibérer par un débat ouvert et public: les juges y pourvoient eux-mêmes, comme si le législateur, atteint d'une soudaine défaillance, tombait sous l'administration d'un syndic de faillite. Dès que la Cour croit posséder la solution technique d'un texte de remplacement à un libellé fautif, elle ne se retient plus d'agir. C'est à l'occasion de l'affaire Vriend que la Cour fit, en 1997, l'usage le plus spectaculaire de son pouvoir de rectification. Elle ajouta tout simplement à la loi albertaine de protection des droits individuels l'orientation sexuelle comme motif de discrimination interdit, parce que l'omission de ce motif dans la loi violait les droits à l'égalité. Imaginez, on viole maintenant la Constitution par abstention de légiférer. C'est peut-être une bonne chose que les homosexuels se voient accorder reconnaissance et égalité. Si bonne soit cette cause, justifie-t-elle un tel empiétement du législatif par le judiciaire et le court-circuitage du débat démocratique? Il vaut la peine de lire les motifs du jugement, dont voici un passage:
[...] il faut, encore une fois, insister sur le fait que, par le truchement de ses élus, le peuple canadien a choisi, dans le cadre de la redéfinition de la démocratie canadienne, d'adopter la Charte et, par suite, de donner aux tribunaux un rôle correctif à jouer.
Par ce passage, nous entrons au coeur de la mythologie du papisme légal canadien. Sans citer un seul élément de preuve textuel ou historique à l'appui, la Cour pond ce que l'on pourrait appeler le miracle de l'immaculée conception. En effet, ce «peuple canadien» invoqué par la Cour est une pure abstraction. En 1982, ce peuple n'a été ni consulté par référendum sur la «redéfinition de la démocratie canadienne» entreprise par les gouvernements du Dominion, ni invité à y participer lui-même par une convention constitutionnelle, deux choses plutôt étrangères au génie national. Cette «redéfinition», concoctée par des parlementaires jaloux de leurs prérogatives et des fonctionnaires légistes, avalisée à toute vapeur devant un comité conjoint de la chambre des Communes et d'un Sénat nommé par l'exécutif fédéral, s'est accomplie malgré l'opposition d'une minorité nationale, dont le gouvernement avait été écarté des négociations à l'origine de la réforme. Au fond, cette réforme est une «conception immaculée», conclue par les gouvernants en accord avec l'esprit du régime, sans être entachée de la participation réelle du peuple aux œuvres constitutionnelles. Ensuite, il est remarquable qu'une Cour suprême fabrique un tel mythe pour s'octroyer ce pouvoir de rectification. Que je sache, le contrôle de constitutionnalité autorise les juges à annuler des textes fautifs, non point à les réécrire péremptoirement. L'infaillibilité judiciaire rendrait-elle à ce point le législateur inutile?
Autre marque du papisme légal: les prétentions intellectuelles de la Cour. À son dire, le contrôle judiciaire porte essentiellement sur les effets de la législation sur les «valeurs» consacrées par la Charte constitutionnelle. Tel un législateur, elle se met ainsi à raisonner l'opportunité d'une politique publique en mettant dans la balance des considérations sociales, politiques et éthiques. Pour ce faire, la Cour s'aventure dans le monde de la statistique sociale, fait parfois témoigner des experts de plusieurs disciplines, effectue elle-même ses propres recherches - sans en soumettre le résultat au contradictoire -, émaille ses jugements de citations pigées dans la philosophie, la littérature et les sciences sociales, tel un grand Hercule du savoir, dont l'omniscience préside aux destinées de la société canadienne. Cela fait de beaux salmigondis, incompréhensibles pour le commun des mortels. La Cour pousse l'audace jusqu'à annuler les politiques publiques trop restrictives à son sens si on ne lui fait pas démonstration qu'elles reposent sur des raisonnements validés par des études scientifiques publiques. À quand un traité de la méthode scientifique écrit par les juges? Cependant, si infaillible qu'elle prétende être, la Cour commet de nombreuses erreurs, de fait et de logique. Curieusement, il lui arrive de mésestimer l'impact de ses décisions sur le système judiciaire, qu'elle est censée pourtant bien connaître. En 1990, dans l'affaire Sioui, la Cour se disait compétente pour «se fonder sur sa propre connaissance de l'histoire et sur ses recherches», démarche essentielle semble-t-il pour interpréter les droits des peuples autochtones constitutionnalisés en 1982. Cela ne l'a pas empêchée d'admettre comme preuve d'un traité prétendument conclu entre les Hurons et l'armée britannique en 1760 un faux, contrefaçon d'un simple sauf-conduit (8).
Les juges de la Cour suprême du Canada n'évoluent pas dans l'univers du positivisme juridique, qui sépare le droit de la morale, le fait de la valeur. Au contraire, ne s'embarrassant pas de ces catégories, elle se voit elle-même engagée dans la définition des «valeurs», des «aspirations fondamentales de la société canadienne», et investie du mandat d'énoncer les «postulats non écrits qui constituent le fondement même de la Constitution du Canada». «Les fondateurs de notre pays, écrivait-elle en 1985, ont certainement voulu, entre autres principes fondamentaux d'identification nationale, que le Canada soit [...] une société soumise à la primauté du droit. Bref, juger au Canada, c'est faire du «nation-building», c'est mettre le sacerdoce du droit au service du nationalisme canadien.
Malgré ses erreurs et ses prétentions, la Cour suprême n'a pas manqué d'habilité politique, et ne voulant pas s'aliéner l'opinion publique, elle a ouvert le prétoire à l'intervention de groupes d'intérêts, extérieurs au litige constitutionnel, dans une procédure élargie que le juge en chef Antonio Lamer lui-même a comparée aux travaux d'une commission parlementaire. Ce faisant, par la réforme de sa procédure, la Cour essaie d'accréditer l'idée de la légitimité procédurale du droit. Dans l'ensemble, la Cour cherche à se ménager des appuis de part et d'autre en se plaçant dans le centre du spectre politique, par un mouvement de balancier. Dans ses jugements, elle en donne tantôt aux grandes entreprises et aux professions libérales, tantôt aux minorités «discrètes et isolées», tantôt aux conservateurs, tantôt aux libéraux progressistes, tantôt un peu au Québec, dont elle a validé certaines lois, du moins dans leurs principes, tantôt beaucoup au gouvernement central, dont elle a consolidé l'autorité. Elle aime bien rendre des jugements à la Salomon, en contentant les deux parties à la fois, à l'un la consolation de la légitimité, à l'autre le régal de la légalité, comme la Cour le réussit par son avis d'août 1998 sur la souveraineté du Québec.
Une incarnation moderne de l'autorité
Une question se pose. Comment se fait-il qu'une cour aussi souveraine n'ait pour seul écho de ses fiat que le «silence écrasant» des parlementaires? Voilà tout un mystère: les parlements muselés par les tribunaux.
En fait, nous assistons au Canada - comme dans plusieurs autres pays où se manifeste le retour en force du droit - à un phénomène de transfert d'autorité du pouvoir élu vers le pouvoir juridictionnel. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Il a été pensé dès le milieu du XVIIIe siècle. Dans son article «Qu'est-ce que l'autorité», Hannah Arendt a déjà souligné la «ressemblance frappante» qu'il y a entre l'auctoritas dont le sénat augmentait les décisions de l'empereur dans la Rome antique et l'autorité de la branche judiciaire de Montesquieu, puissance «en quelle façon nulle», «qui constitue néanmoins la plus haute autorité dans les gouvernements constitutionnels.» Dans son Essai sur la révolution, Arendt montra comment les pères fondateurs de la république américaine, fidèles à l'antique distinction entre pouvoir et autorité, attribuèrent la fonction de l'autorité non pas au sénat, mais à la Cour suprême.
D'où viendrait alors l'autorité qui auréole aujourd'hui la Cour suprême du Canada? Le droit public anglais enseigne que: «Règle générale, l'autorité des juges ne peut découler que de la Couronne et ceux qui prétendent posséder le droit acquis d'exercer une charge judiciaire ne le peuvent que par un octroi implicite du Roi (9).» C'est sans soute pour cette raison que les juges de la Cour suprême sont nommés par lettres patentes délivrées par le Gouverneur général avec le Grand Sceau de Sa Majesté la Reine du Dominion du Canada.
S'ils ne croient pas à la transsubstantiation du corps du Christ dans l'hostie, les Orangistes canadiens se persuadent de celle de l'autorité du monarque dans la bouche du juge. Mais le vieux symbolisme de cette curieuse monarchie ne saurait tout expliquer. Regardons le système politique. Inspiré du modèle britannique, le système parlementaire canadien est une forme de monarchie élective (10), qui permet à un parti, avec aussi peu que 38% des suffrages exprimés, de prendre possession de la souveraineté et de la transférer au Premier ministre. Ce dernier gouverne à la manière d'un régent qui, au surplus, concentre en lui des prérogatives qu'un régime républicain accorderait à d'autres pouvoirs ou soumettrait à la Constitution. Le premier ministre fédéral pourvoit ainsi à la nomination des juges et des sénateurs fédéraux, des chefs des États provinciaux, ainsi qu'à celle des directeurs-généraux d'une constellation d'organismes créés par l'État-providence fédéral. Ce ministre-régent règne en maître sur son parti, et contrôle par ce biais le Parlement, de même que l'appareil gouvernemental. Devant une telle puissance, les mécanismes institutionnels de contre-pouvoirs sont peu efficaces. Le vérificateur-général et les multiples ombudsmen la chatouillent en vain de leurs remontrances. La presse, déjà concentrée dans les mains d'un oligopole, joue à l'opposition officielle, sans se soumettre toutefois à l'éthique de la responsabilité politique. En somme, le seul contre-pouvoir efficace qui demeure, c'est le pouvoir judiciaire. Jouissant, comme le veut la tradition de la Common Law, d'une grande indépendance et d'une autorité dans les affaires civiles et criminelles, le juge canadien en vient à incarner la résistance démocratique, le point d'appui institutionnel qui permette au citoyen de contrecarrer la toute-puissance exécutive canadienne. Or, si cela est vrai, comment se fait-il que Pierre Elliott Trudeau, ministre-régent qui ne dédaigna pas exercer tout l'imperium de sa fonction, se soit fait l'avocat opiniâtre du contrôle judiciaire des lois? Ma thèse est que le grand Lord canadien avait compris que le contrôle judiciaire permet de canaliser les demandes de changement et le mécontentement populaire tout en conservant le régime, quitte à ce que de temps à autre, après de longues et coûteuses procédures, un juge casse une loi ou un décret. La République ne se fait pas par les juges. C'est ainsi qu'il faut comprendre la phrase énigmatique que Trudeau écrivit en 1970: le droit «permet le changement sans sacrifier la stabilité». On ne saurait mieux dire.
La combinaison de la monarchie élective et du papisme légal dévoile un des paradoxes de la démocratie constitutionnelle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le contrôle judiciaire des lois ne produit pas nécessairement plus de libertés, plus de débats démocratiques, ce fameux «antagonisme» des idées dont Mill faisait le ressort du gouvernement représentatif. Ce contrôle des juges peut aboutir aussi, comme cela semble se confirmer au Canada, à plus de dogmes, à plus de conformisme, à moins de liberté de penser par soi-même. Comme l'expliqua Hannah Arendt dans «Qu'est-ce que l'autorité», les Romains avaient compris qu'ils ne pouvaient bâtir un empire sur la discussion démocratique ou sur la tyrannie éclairée d'un roi-philosophe. Il leur fallait un principe intermédiaire de légitimité, qui assure la pérennité des institutions et évite les écueils de l'une et de l'autre. Ce principe, ils le trouvèrent dans l' «auctoritas» des patriciens, ces chefs des tribus qui descendaient des fondateurs de Rome et qui perpétuaient à travers eux l'oeuvre de la fondation. Si aujourd'hui les juges incarnent à leur tour l'autorité, ce n'est point pour continuer une fondation mythique, à moins que ce ne soit celle de l'arche sacrée de la constitution. Au Canada, l'auctoritas des juges, comme à l'époque de l'antiquité romaine, permet aux gouvernants de gagner l'adhésion de la population au régime et de freiner la discussion démocratique. Sitôt que le juge parle, le débat politique cesse, censuré par le jugement. Et ces conflits obsédants, comme celui qui oppose au Canada une minorité nationale à une majorité qui rêve d'un État unitaire sous couvert de fédéralisme, ou comme ces conflits moraux, tels l'avortement, l'euthanasie, la religion dans les écoles, faute d'être vraiment solutionnés par le juge, acquièrent par son entremise quelque rassurante vérité. En maestro télégénique, Trudeau a réussi à convaincre une bonne partie de la population canadienne, surtout en dehors du Québec, qu'une Charte constitutionnelle redonnerait aux citoyens la parole et une plus grande prise sur le politique. Ainsi, cette charte est devenue un objet de vénération et de fierté, le nouveau langage dans lequel doivent être formulées les aspirations politiques. Des facultés de droit canadiennes sortent des légions d'avocats qui disséminent la bonne nouvelle que la société se réforme par les tribunaux. Grisés par leur science et leur foi inébranlables, certains d'entre eux, devenus grands guerriers de la procédure, parlent le langage des croisés.
Sur le patriotisme constitutionnel allemand
On m'accusera sans doute de m'attaquer à l'ultima ratio de l'État de droit. Pourquoi rogner ce qui reste d'autorité quand le juge constitutionnel ploie sous la confiance des justiciables? N'en n'est-il pas ainsi dans d'autres pays, tel l'Allemagne par exemple, qui après avoir perdu son identité dans une terrible éclipse totalitaire, s'est retrouvée dans sa Loi fondamentale, son ordre démocratique, dont le tribunal constitutionnel de Karlsruhe est le gardien attitré (11)? Le Verfassungspatriotismus ne serait-il pas l'expression tout à fait moderne de la compréhension qu'ont les citoyens du rôle du droit et du juge dans la sauvegarde des valeurs démocratiques? Avant de poser une équivalence facile entre le patriotisme de la charte canadienne et celui de la Loi fondamentale, il convient de garder à l'esprit le cadre politique particulier dans lequel s'exerce au Canada la justice constitutionnelle.
La démocratie constitutionnelle allemande a des fondements clairement républicains, au contraire de celle que la Reine Élizabeth II a proclamée pour son Dominion d'Amérique. Que l'on observe la manière dont le chef de l'État et les juges, fédéraux et constitutionnels, sont nommés, la manière dont les responsabilités sont réparties entre les pouvoirs, le constitutionnalisme allemand rattache la formation des institutions à la souveraineté du peuple et sépare rigoureusement les pouvoirs. Ainsi les 16 juges de la Cour constitutionnelle sont élus pour moitié par le Bundestag (chambre basse fédérale), pour moitié par le Bundesrat (chambre haute qui représente les États fédérés, ou Länder.) Le gouvernement fédéral, les gouvernements de Land ainsi qu'au moins un tiers des membres du parlement fédéral peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'une question touchant à la légalité d'une loi. Le républicanisme allemand est exemplaire au point d'inspirer maintenant les Anglais, dont certains songent à établir la République (12). Au Canada, le peuple n'est pas officiellement souverain; la souveraineté appartient aux parlementaires et aux représentants de la Couronne; les pouvoirs y étant mal séparés, l'exécutif fédéral possède des prérogatives exorbitantes. Ensuite, les parlementaires ne peuvent eux-mêmes saisir les tribunaux d'une question constitutionnelle.
On envisage généralement en Europe le contrôle de constitutionnalité comme un recours subsidiaire. On en appelle au juge quand les voies de règlement politique sont épuisées ou bloquent. Le jugement constitutionnel est l'ultime recours au verdict duquel le politique se soumet puisque c'est lui-même qui l'a sollicité. Au Canada, la justice constitutionnelle est la continuation du politique par d'autres moyens. C'est un mécanisme de gouvernance, conçu au Canada comme un moyen d'endiguer les velléités d'émancipation nationale du Québec et de soumettre les États provinciaux à des normes nationales permanentes, sans faire intervenir directement l'État central canadien. Celui-ci n'a d'ailleurs pas été inactif pour mettre en oeuvre ce beau programme. Finançant déjà depuis la fin des années 1960 une pléiade de groupes d'intérêts pour légitimer ses grandes politiques d'unification nationale - le bilinguisme et le multiculturalisme -, il a allongé les subventions pour les encourager à utiliser la Charte canadienne comme instrument de promotion de leurs intérêts. En conséquence, ces groupes ont été nombreux à se constituer parties civiles ou intervenants dans les affaires impliquant cette charte. Des politologues soutiennent même qu'une collusion s'est formée entre l'État central, la Cour suprême et ces groupes «litigants» et que la Cour s'est montrée assez réceptive aux arguments de ces derniers, formant avec eux une convention constitutionnelle clandestine (13). Ce «parti de la Cour» semble préférer le lobby judiciaire au lobby parlementaire, s'épargnant ainsi la peine d'affronter l'électorat. Promouvoir ses intérêts par la plaidoirie dans des causes bien ciblées paraît une méthode d'autant plus efficace que les gains acquièrent une valeur supralégislative.
Le Dominion du Canada se distingue par la faiblesse de ses contre-pouvoirs; ce n'est pas le goulag, le summum de la démocratie non plus. Cet état de choses s'explique peut-être par le fait que la culture politique canadienne n'envisage guère la société comme un ordre polycentrique formé d'individus et de corps intermédiaires (14). Bien qu'elle ait uni d'innombrables principautés en une seule nation, la République allemande a conservé, malgré l'effondrement de la République de Weimar, une culture des corps intermédiaires, qui se traduit dans sa vie sociale, culturelle et politique. Au Canada, Pierre Elliott Trudeau lui-même, avant de se lancer dans l'arène politique, a compté parmi ceux qui ont dénoncé, certes non sans raison, l'emprise excessive des corps intermédiaires - c'est-à-dire de l'Église catholique sur la société et l'État au Québec. Une fois porté au pouvoir, par ses réformes, il a modelé le Canada à l'image d'une société formée d'un côté, d'individus libres de choisir leur culture et leur appartenance, et de l'autre, d'un État bienfaisant, libéral dans les moeurs, interventionniste pour le reste. À leur tour, les hommes politiques et les intellectuels qui ont délogé au Québec les curés, les cardinaux et les cloîtrés, au tournant de la décennie 1960 ont concouru à populariser ce schéma de la société, à la différence toutefois que l'État de leurs rêves s'incarnait par l'État du Québec, qui représente une nation distincte. Depuis, libérés des attaches de la religion et de la tradition, les intellectuels du Québec ne cessent de puiser au même fonds d'idées: le jacobinisme et le keynésianisme. (Plus cosmopolites dans leurs inspirations, leurs prédécesseurs empruntaient à l'humanisme et à la pensée juridique germaniques.) Dans ce contexte, on comprend mieux la popularité du contrôle judiciaire des lois au Canada et le conformisme politique qu'il a engendré. L'apparente popularité du recours au juge perpétue cette idée chère au régime, qui représente les rapports entre l'État et la société comme un conflit permanent entre, d'une part, un Léviathan menaçant de devenir la proie de majorités oppressives et, d'autre part, des individus isolés, néanmoins prêts à sortir de leur soumission par la protestation au juge, dont la parole rédemptrice répare la promesse brisée par le Léviathan et rétablit l'individu trahi dans ses droits originaux. Alors que le Dominion entre bientôt dans le XXIe siècle et se pavane, par ses ministres commis-voyageurs, en parangon d'État post-moderne, il vit encore à l'heure de Hobbes et de Locke.
Les diverses conceptions de l'interprétation constitutionnelle révèlent un autre grand paradoxe de la démocratie libérale: elle n'est pas le régime où tout est permis. Elle possède en fait un «noyau»d'absolus, de vérités instituées, sans lequel elle ne peut durer. Les Allemands l'ont d'ailleurs compris, et cruellement. Leur Loi fondamentale de 1949 habilita la Cour constitutionnelle fédérale à constater qu'un parti politique vise à renverser l'ordre constitutionnel de la République et à ordonner dans ce cas la dissolution du parti. Quand bien des esprits libres rêveraient d'anarchie et d'utopie sociale, la démocratie libérale n'en repose pas moins sur quelques fondements, dont les historiens de la mémoire collective, les docteurs de la loi et les philosophes de la Cité sont les conservateurs (15). Pour se conserver, la démocratie a donc besoin d'une certaine mesure de pensée dogmatique, qui passe par l'État de droit. Jusqu'où doit aller cependant cette mesure? La dogmatique juridique transforme vite les objets qu'elle touche en objets sacrés. À propos du modèle vieillissant de la démocratie représentative, qui pose une équivalence parfaite entre la volonté des élus et celle du souverain, Dominique Rousseau disait: «Le fétichisme juridique, qui transforme en objets sacrés les décisions des institutions du système politique, ne peut trouver place dans un modèle de démocratie qui cherche à écarter toute transcendance, même celle des produits de la délibération publique (16).» Sans doute, les régimes parlementaires qui s'appuient sur «l'identification des gouvernés aux gouvernants, sur la confusion entre le peuple et ses représentants» finissent-ils par entretenir le fétichisme de la loi. Mais le papisme légal n'entretient-il pas à son tour un fétichisme tout aussi insidieux, qui déresponsabilise en bout de ligne les pouvoirs législatif et exécutif de la garde de l'ordre constitutionnel et les dissuade de penser par eux-mêmes les compromis entre les exigences normatives de cet ordre et celles, plus concrètes, de la gouverne étatique?
Ne croyez pas que, par ma «protestation» contre le papisme légal, je désavoue le contrôle juridictionnel en soi, mû par une quelconque nostalgie de la bonne vieille démocratie représentative, dont les volontés proclamées lois ne souffraient aucune limite et qui réduisait somme toute le citoyen, entre les élections, à l'état de spectateur et de bénéficiaire de la chose publique. Je sais que ce modèle n'est plus le seul à incarner l'idéal démocratique; un nouveau modèle, celui de la démocratie fonctionnelle, se profile (17). Si les exigences d'une démocratie continue ne peuvent se suffire des seuls moments où le peuple, par élections ou par référendum, participe au débat, il peut être concevable de recourir au juge, qui porterait, selon Rousseau, «en continu dans le champ constitutionnel les interrogations de l'espace public». Le contrôle juridictionnel est une technique institutionnelle qui permet aux citoyens, lorsqu'ils ont le droit de saisine, de «questionner la loi votée par les élus du peuple à partir des principes sur lesquels»ils se «sont mis d'accord pour vivre ensemble». Le recours universel des citoyens au juge constitutionnel peut à bon droit être considéré, tel en Allemagne, comme «une formidable insertion directe du citoyen dans les pouvoirs qui donne à la démocratie une base et une expression directement vécue, parallèlement au droit de vote (18).»
Ne perdons pas de vue que le contrôle juridictionnel des lois demeure une simple technique institutionnelle, soumise elle-même à l'examen critique, en regard notamment des critères de la transparence, de l'efficacité et de la légitimité. Le recours à cette technique soulève plusieurs questions: 1) Le contrôle juridictionnel est-il le principal moyen par lequel les exigences de la démocratie continue s'exercent sur l'État ou devrait-il être plutôt envisagé comme un élément d'un ensemble de contre-pouvoirs et de foyers parallèles de discussion qui tous ensemble sont autant de points d'appui par lesquels l'ordre polycentrique de la société se manifeste et se maintient? 2) Le contrôle juridictionnel implique-t-il que les conflits moraux et les questions sociales ou nationales puissent tomber sous l'empire du droit et trouver par lui une solution définitive, s'appliquant péremptoirement à l'État tout entier? 3) Est-il nécessaire de confier aux juristes, du seul fait qu'ils sont habiles à manipuler des concepts de droit, l'exclusivité de l'interprétation de l'ordre constitutionnel et ne serait-il pas plus avisé de réunir dans l'instance de contrôle des lois des compétences diversifiées? (Songeons à une cour constitutionnelle composée pour moitié de juristes, et pour une autre moitié de non-juristes.) 4) Finalement, l'interprétation de l'ordre constitutionnel doit-elle être conçue comme la juridiction exclusive d'un tribunal ou comme une entreprise commune, à laquelle participent, chacun dans sa sphère légitime d'activités, tous les pouvoirs? En somme, mon interrogation peut se formuler ainsi: dans quelle mesure sommes-nous sûrs que la démocratie policée par les juristes est compatible avec l'esprit de liberté, der Geist der Freiheit? Les architectes de la réforme de 1982 au Canada ont évité de se poser de telles questions, comme aujourd'hui ces avocats d'une Europe fédérale qui, aspirant à une revanche du droit sur le politique, en confierait la construction à un gouvernement européen des juges (19). Le lecteur a sans doute deviné le sens de ma réponse à cette question. Je suis bien prêt en tant que citoyen à suivre les avis de la justice constitutionnelle, mais point parce que c'est un juge qui les prononce, revêtu de je ne sais quelle grandiose «auctoritas». Si le jugement, émanant d'une instance extérieure aux pouvoirs législatif et exécutif, donne des raisons convaincantes de penser que les principes sur lesquels les citoyens se sont mis d'accord pour vivre ensemble ont été enfreints au-delà de toute limite raisonnable, il mérite alors respect. Tout le reste autrement n'est qu'inventions verbales et mystique du droit.
Évidemment, avec de tels propos, je passerai pour un impie. L'hiver de mon exil républicain se chauffera des foudres que me vaudra mon hérésie. Insulterais-je au grand dessein de Pierre Elliott Trudeau et de ses coreligionnaires, bien plus préoccupés par la rénovation d'un Dominion qui préserve la monarchie élective héritée d'une forme usée de parlementarisme que par la poursuite des véritables idéaux libéraux? Mill, encore une fois, a su les énoncer, tel le suivant: «...it is as much and even more indispensable to enable average human beings to attain the mental stature which they are capable of.» C'est justement pour cette raison que le sacerdoce du droit doit être universel. Mais enfin, me dira-t-on, pourquoi se fatiguer de penser, de retourner en tous sens une question morale ou politique, quand le juge vient à la rescousse? Les conflits d'idées et de valeurs ne sont-ils pas simplifiés dès lors que le juge pontifie? De ces capitales où siègent des cours qui ne voient plus de limite à ce que le droit peut faire, on pourra dire, comme jadis de Rome: Pontificum veneranda sedes, sacrum solium (19). Non, vraiment, tant qu'à m'incliner devant un pape, je préfère encore la ville éternelle à ces nouveaux Avignon (20).
Notes
(1) John Stuart Mill. «On Liberty», dans Utilitarianism, Liberty, Representative Government, Londres, J.M. Dent & Sons, 1972, 438 p.
(2) Daniel-Rops, «Introduction», dans Luther tel qu'il fut. Textes choisis, traduits du latin et de l'allemand, et annotés par le chanoine Cristiani, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1955. Voir aussi Olivier Christin, Les réformes/Luther, Calvin et les protestants, Paris, Gallimard, Découvertes, 1995.
(3) Louis Fisher, Constitutional Dialogues: Interpretation as Political Process, Princeton University Press, 1988, 305 p., p. 23.
(4) Sanford Levinson, Constitutional Faith, Princeton University Press, Princeton, 1988, 250 p., p. 29.
(5) Pierre Elliott Trudeau, «Les droits de l'homme et la suprématie parlementaire», dans Allan Gotlieb (dir.), Les droits de l'homme le fédéralisme et les minorités, Toronto, Institut canadien des affaires internationales, 1970, p. 7.
(6) Christopher P. Manfredi, Canada and the Paradox of Liberal Constitutionalism, Judicial Power and the Charter. Toronto, The Canadian Publishers, 1993, p. 205.
(7) Jeffrey Simpson, «Court talks, legislatures listen», The Globe and Mail, 21 août 1998.
(8) Voir Denis Vaugeois, La fin des alliances franco-indiennes. Enquête sur un sauf-conduit de 1760 devenu un traité en 1990, Montréal, Boréal-Septentrion, 1995, 288 p.
(9) Voir Joseph Chitty, A treatise on the Law of the Prerogatives of the Crown, Joseph Butterworth and Son, London, 1820, p. 75-76.
(10) Ce concept a déjà été utilisé pour décrire l'évolution contemporaine du parlementarisme britannique. Voir F.W.G. Benemy, The elected monarch, George & Harrap & Co Ltd, Londres, 1965.
(11) Pierre Koenig, «Réflexions sur l'évolution des juridictions constitutionnelles en France et en Allemagne», Revue d'Allemagne et des Pays de langue allemande, 3, 1998, p. 311-322. Beau principe de la république allemande, la Cour constitutionnelle siège dans une ville autre que la capitale.
(12) Ainsi The Economist a prôné l'abolition de la monarchie et l'élection d'un président sur le modèle allemand. Voir «Le monarque bientôt soumis à référendum», Courrier International, no 415, 15 au 21 octobre 1998. En 1968, le gouvernement de Daniel Johnson a proposé le remplacement du gouverneur général, représentant de Sa Majesté et chef formel du Dominion, par un président élu, placé à la tête d'une «union canadienne», composée de dix États fédérés, dont la République du Québec. Plusieurs éléments de la proposition de Johnson se réclamaient du modèle allemand, telle la création d'une Cour constitutionnelle dont les juges seraient nommés par les deux paliers d'États.
(13) Entre autres F.L. Morton, «The Charter of Rights: Myth and Reality», dans William D. Gairdner (dir.), After Liberalism. Essays in Search of Freedom, Virtue, and Order, Toronto, Stoddart Publishing, 1988, p.33-61.
(14) Sur le polycentrisme, voir Jean Baechler, Démocraties, Paris, Calmann-Lévy, 1985, 730p. (15) Sur ce que conserver peut vouloir dire aujourd'hui, voir Alain Finkielkraut, «Le conservatisme à l'aube du XXIe siècle», conférence prononcée au Musée Redpath de l'université McGill le 26 mai 1998, Programme d'études sur le Québec de l'université McGill, 25 p.
(16) Dominique Rousseau, «La démocratie continue. Espace public et juge constitutionnel», Le débat, 96, 1997, p. 82.
(17) Voir Jean-François Thuot, La fin de la représentation et les formes contemporaines de la démocratie, Montréal, Éditions Nota bene, 1998, 205 p. (18) Joseph Rovan, «Un modèle institutionnel», Revue des questions allemandes, no.3, 1996, p. 59-64.
(19) Voir Farid Lekéal, «De la révolution du droit au gouvernement du droit», L'Europe en formation. Les Cahiers du fédéralisme, no 309, 1998, p. 144-177.
(20) Vieille phrase de la liturgie catholique citée par Chateaubriand dans ses Mémoires d'Outre-Tombe, qui désigne Rome comme le «siège vénérable des pontifes, trône sacré», Livre XXVIII, chapitre 16.