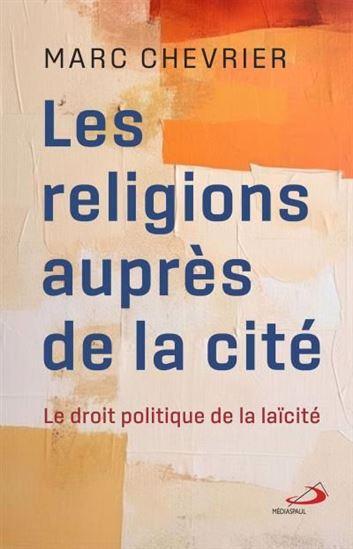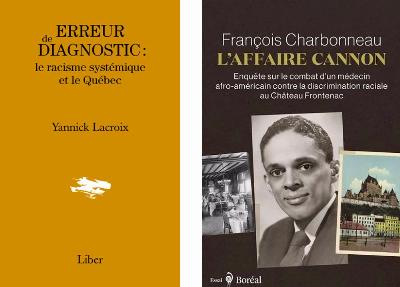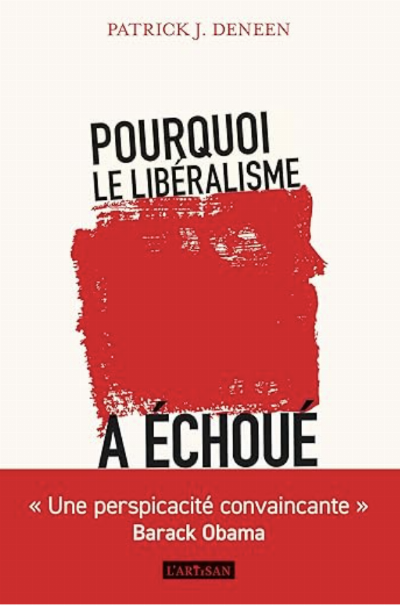Walter Bagehot, ou la monarchie britannique comme spectacle d’un pouvoir irréel
L’un des meilleurs analystes de la survivance et de la fonction de la monarchie au Royaume-Uni demeure Walter Bagehot, un journaliste britannique (1826-1877) connu pour son ouvrage sur la constitution britannique (The English Constitution), où il offre des vues pénétrantes sur les ressorts de la politique du royaume. Les analyses de Bagehot sont résumées dans ces extraits de mon ouvrage La république québécoise, Boréal, Montréal, 2012, p. 376-379, p. 380-383.
Pages 376-379.
 En fait, la grande ironie de l’aventure constitutionnelle canadienne de 1867, c’est qu’elle survint l’année même où l’un des plus brillants analystes de la Constitution anglaise constatait la disparition du gouvernement mixte britannique traditionnel, à la suite des métamorphoses engendrées par la loi électorale de 1832, qui élargit le suffrage aux classes moyennes. Il s’agit de Walter Bagehot, auteur de l’ouvrage The English Constitution, publié l’année même de la création du Dominion canadien et de l’adoption de la deuxième grande loi électorale à Westminster qui fit passer de 1,2 million à 2,2 millions le nombre de votants. Or, dès l’adoption de la loi de 1832, l’édifice du gouvernement mixte anglais classique avait été ébranlé. Avec l’accession de nouvelles classes moyennes au Parlement, suffrage jusqu’alors réservé à une petite oligarchie aristocratique, le lieu effectif du pouvoir s’est déplacé vers la Chambre des communes ; dès lors, c’est le cabinet dirigé par un premier ministre qui devient la partie agissante du pouvoir exécutif. Dès le début de son ouvrage, Bagehot fait référence à la théorie du vieux gouvernement mixte anglais :
En fait, la grande ironie de l’aventure constitutionnelle canadienne de 1867, c’est qu’elle survint l’année même où l’un des plus brillants analystes de la Constitution anglaise constatait la disparition du gouvernement mixte britannique traditionnel, à la suite des métamorphoses engendrées par la loi électorale de 1832, qui élargit le suffrage aux classes moyennes. Il s’agit de Walter Bagehot, auteur de l’ouvrage The English Constitution, publié l’année même de la création du Dominion canadien et de l’adoption de la deuxième grande loi électorale à Westminster qui fit passer de 1,2 million à 2,2 millions le nombre de votants. Or, dès l’adoption de la loi de 1832, l’édifice du gouvernement mixte anglais classique avait été ébranlé. Avec l’accession de nouvelles classes moyennes au Parlement, suffrage jusqu’alors réservé à une petite oligarchie aristocratique, le lieu effectif du pouvoir s’est déplacé vers la Chambre des communes ; dès lors, c’est le cabinet dirigé par un premier ministre qui devient la partie agissante du pouvoir exécutif. Dès le début de son ouvrage, Bagehot fait référence à la théorie du vieux gouvernement mixte anglais :
… on a insisté sur l’excellence particulière de la constitution britannique qui repose sur la combinaison équilibrée de trois pouvoirs. On a dit que les éléments monarchique, aristocratique et démocratique ont chacun une part dans la souveraineté suprême, et que l’accord des trois est nécessaire à la mise en œuvre de la souveraineté. Le roi, les lords et les communes sont supposés non seulement incarner la forme extérieure mais l’essence intime et motrice, la vitalité de la constitution. Une grande théorie nommée la théorie des « poids et contrepoids » imprègne une part considérable de la littérature politique et provient pour une bonne part de la littérature anglaise — ou y trouve appui[i].
Or, Bagehot mit en pièces cette « théorie ». Sa démonstration part de la distinction qu’il fait entre les parties « dignes » ou nobles (dignified, en anglais) et les parties effectives de la constitution. Il désigne par les premières les institutions de la monarchie et de l’aristocratie qui, malgré l’évolution de la vie politique depuis les révolutions du XVIIe siècle, ont continué d’exister, de participer au fonctionnement de l’État britannique, d’incarner le prestige associé au monarque et à la noblesse et de susciter la déférence et l’admiration du peuple. Cependant, ces parties « nobles » n’exercent plus la réalité du pouvoir, elles sont maintenues pour offrir au peuple ce que Bagehot appelle « the theatrical show of society », le spectacle théâtral de la haute société[ii]. Les parties effectives, qui échappent au regard du peuple, comme le cabinet, concentrent le pouvoir selon une logique qui n’est pas celle de la balance supposée entre trois ordres sociaux distincts. Bagehot va même jusqu’à imaginer un scénario politique radical : le président des Communes pourrait même désigner le premier ministre à la place du monarque sans que cela change quelque chose au fonctionnement effectif du parlementarisme anglais. C’est d’ailleurs ce que font aujourd’hui les Suédois, qui ont enlevé au roi le pouvoir de désigner le premier ministre ; ce dernier est nommé par le président de la chambre des députés. Quant à la Chambre des Lords, Bagehot soutient que la réforme de 1832 a entraîné son irrémédiable déclin : depuis cette réforme, elle a dû concéder à la première chambre la primauté de l’initiative législative et modérer ses oppositions. De plus, constate Bagehot, la culture aristocratique se meurt. Le respect dû au rang cède à l’attrait de l’argent. En somme, ce que dit Bagehot, c’est que les Britanniques, bien avant 1867, ont conservé l’ancien gouvernement mixte classique sous sa forme cérémonielle. Si les élites l’ont ainsi maintenu, c’est parce qu’elles y ont trouvé un avantage : ce spectacle du pouvoir entretient l’illusion d’une structure de gouvernement simplifiée, qui laisse croire que tout procède du roi ; et partant, ce décorum suscite l’adhésion des masses au pouvoir. Dans un langage qui frise le cynisme, Bagehot rappelle que l’une des conditions du gouvernement représentatif est l’existence d’un état d’esprit national serein, ce qui ne peut exister chez les classes incultes, à qui l’on pourrait difficilement confier le choix des gouvernants[iii]. Le maintien dans l’État d’institutions augustes sert à tranquilliser, selon lui, l’imagination des masses ignorantes. Si elles devaient être convaincues qu’elles ont le loisir de choisir tous leurs gouvernants, elles seraient alors en proie à toutes sortes de craintes qui fomenteraient émeutes et révolutions. Or, en laissant courir l’illusion qu’elles sont réellement gouvernées par un souverain héréditaire, le gouvernement mixte cérémoniel discipline l’horizon mental des masses et les tranquillise. La dignité ostentatoire (conspicuous dignity) éveille le sentiment de révérence chez les masses, qui se croient gouvernées par une reine ointe de « l’huile de Reims », alors qu’en fait, elles sont gouvernées par un cabinet et une chambre composée de gens comme eux, pas tous très dignes[iv]. C’est la dignité imaginaire de quelques êtres divins qui permet aux moins dignes de saisir le pouvoir, dit perfidement Bagehot. En somme, le gouvernement mixte cérémoniel est une mystification efficace, qu’il convient de conserver pour cultiver l’obéissance aux élites, et grâce à laquelle est assurée la stabilité du royaume et du gouvernement représentatif.
Pages 380-382
La perspective cynique que révèle la théorie de Bagehot tourne, en fait, autour d’une idée clé qui fonde la vision anglaise du gouvernement parlementaire : celle de déférence. On oublie souvent que la Grande-Bretagne, mère supposée de la démocratie parlementaire, a longtemps entretenu une réticence à élargir le suffrage au peuple tout entier. Le droit d’élire des députés était l’affaire d’une petite minorité profitant des injustices d’une carte électorale médiévale, qui excluait de la représentation des villes populeuses entières. En réalité, un cercle restreint de familles régnait sur le pays ; le fils parlementait aux Communes, le père trônait chez les Lords. L’oligarchie gouvernante desserra son emprise sur les Communes en 1832, et en 1867, un autre élargissement du corps électoral changea la dynamique de la politique anglaise. Les électeurs devinrent si nombreux, que les partis, qui ressemblaient plutôt à des clubs de gentlemans, durent se transformer en machines électorales disciplinées pour rejoindre ces masses nouvelles. À terme, les élites anglaises savaient que le suffrage finirait par s’universaliser. Or Bagehot ne voyait pas dans l’irréversible élargissement du corps électoral une menace à la nature oligarchique du parlementarisme britannique. Il se convainquait que la culture politique britannique modérerait, par de multiples freins mentaux, les ardeurs de ce peuple étendu, comprenant désormais ce que les aristocrates anglais nommaient jadis dédaigneusement la « multitude ». Ainsi, grâce à la confiance des électeurs, au calme de l’esprit national, allergique à l’action révolutionnaire, et à la rationalité des électeurs, les demandes populaires et leur conflit potentiel avec l’élite parlementaire seraient amenuisés. Ces ingrédients combinés se conjuguaient de telle sorte que le peuple verrait comme naturelle la délégation de son pouvoir en faveur d’une minorité éclairée, plus compétente, gouvernant en son nom. Telle serait la qualité d’une nation déférente, qui sait s’incliner devant les choix des élites qu’elle a portées au pouvoir, quitte à renvoyer dans l’opposition le gouvernement, quand il a fauté ou s’est épuisé. La déférence d’un peuple n’est certes pas quelque chose qui se commande, seulement, pour Bagehot, il était clair que la monarchie, sans réel pouvoir, détrônée par le cabinet, avait ce rôle essentiel à jouer : maintenir le peuple dans sa déférence à l’égard des élites parlementaires[v]. La monarchie sert à restreindre les appétits de souveraineté du peuple, à l’éblouir du spectacle d’un monde ancien où le droit de gouverner semblait tomber du ciel, par l’onction du temps qui sacrait un élu en qui le peuple se reconnaissait un père ou une mère.
Dans l’esprit de Bagehot et d’autres penseurs de la démocratie anglaise, outre la monarchie, d’autres éléments, tels le culte de la tradition et la religion, concourraient à nourrir cette déférence. Les Anglais n’ont jamais voulu vraiment séparer la religion de l’État. L’Église anglicane est un christianisme d’État établi sous Henri VIII qui a perduré, si bien que le Souverain est aussi chef officiel de cette Église et nomme les évêques — sur recommandation aujourd’hui du premier ministre. Cette église étant intimement enchâssée dans l’État, elle lui communique un peu de son aura sacré. Puis, autre ferment de déférence, le droit, — la fameuse Common Law (ou droit commun coutumier) dans laquelle les Anglais célèbrent à l'envi le précédent, l’ancienneté des coutumes, la prudence des juges et la méfiance à l’égard des inventions systématiques du législateur. Tous ces éléments réunis et le poids de l’habitude devaient, au bout du compte, contenir l’individualisme que le libéralisme et la révolution du XVIIe siècle avaient fait naître si vivace dans ce pays. La synthèse de cet individualisme libéral et de cette culture de la déférence a accouché du « whiggisme », l’idéologie dominante du pays, réfractaire à toute révolution et à tout nivellement égalitaire[vi].
[i] Walter Bagehot, The English Constitution, Londres, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1905, p. 2-3
[ii] Ibid., p. 267.
[iii] Ibid., p. 256-257.
[iv] Ibid., p. 257-258.
[v] Walter Bagehot, déjà cité, p. 265-271.
[vi] On lira sur le whiggisme le texte classique de Benjamin Disraeli, « The spirit of whiggism », dans The Runnymede Letters, Londres, Bentley and Sons limited, 1885.