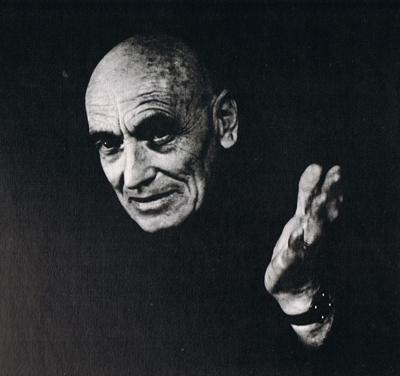L'inflation judiciaire
Voici une série de faits divers qui montre bien comment la régle de droit se substitue progressivement à règle sociale dans les familles, les écoles, les religions et jusqu'au seuil de la naissance et de la mort. Il s'ensuit une inflation judiciaire à laquelle le monde des affaires n'échappe pas et sans laquelle nous serions tous plus riches.
Le dernier procès dont j'ai entendu parler met un prêtre en cause. Appelé par un couple en difficulté, l'abbé X prodigua ses humbles conseils en toute confiance. Mal lui prit car, après avoir mis les conseils en pratique, le couple se trouva dans une situation plus difficile qu'avant d'avoir appelé la sainte Eglise à son secours. S'ensuivit une poursuite pour malpractice du sacerdoce.
Le droit pénétrant ainsi dans les confessionnaux, il ne faudra pas s'étonner si l'on découvre un jour qu'il est déjà bien implanté dans les écoles. Un directeur de collège de Montréal nous a raconté les prouesses judiciaires d'un adolescent de quinze ou seize ans ayant déjà été congédié de deux écoles privées et rendant la vie impossible à sa mère, qui en a seule la garde. Dans l'espoir d'aider ainsi son fils à se retrouver, cette dernière l'oblige à travailler un peu pour payer une partie des frais de scolarité à la dernière école qui a bien voulu l'accepter. Le garnement, qui ignorait tout sauf ses droits, est allé rencontrer un policier pour lui demander de l'aider à se prévaloir de la loi sur la protection de la jeunesse, contre sa mère, qu'il voulait obliger à payer la totalité de ses frais de scolarité; le policier l'ayant rabroué, il a par la suite invoqué un article de la Charte des droits de la personne contre ce dernier. C'est là hélas! un cas limite et non un cas d'exception, comme j'ai pu m'en rendre compte par la suite.
Dans de nombreux collèges publics aussi bien que privés du Québec, les enseignants doivent tous les jours affronter des élèves qui contestent leur autorité ou leur pédagogie de toute la force que leur confèrent les chartes de droits.
À l'université, cette étrange affirmation scolaire de soi prend d'autres formes. Il arrive de plus en plus fréquemment que des étudiants de maîtrise ou de doctorat se présentent avec leur avocat chez leur directeur de thèse. Le même avocat les accompagne parfois au service des bourses.
Le problème se pose dès la garderie. Même le vocabulaire des tout petits s'est transformé. Ils ne disent plus: je veux faire çà, j'ai le goût de jouer, mais j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de jouer. Faut-il s'en étonner? Dans le vocabulaire des parents, le langage du droit n'a-t-il pas remplacé aussi bien celui du désir que celui de la morale? Le bien et l'agréable n'existent plus, ils ont été remplacés par les droits de et les droits à. Droits du prisonnier, droit de fumer, droit à un environnement sain, droits des animaux, droits du foetus, droit à la vie, droit de la mère de disposer de son propre corps, droits de la victime, droits des enfants, droits des parents, droit au travail, droits des malades, droits des handicapés, droits des malades mentaux. La liste est illimitée.
À propos de garderie, une de nos correspondantes, Mme Olga Maksimova, dissidente russe établie au Québec au début des années quatre-vingt, nous a donné son interprétation de l'influence de la nouvelle mentalité chez les tout petits. Elle enseigne dans deux garderies, l'une située à Outremont et fréquentée par des enfants de la bourgeoisie francophone de Montréal, l'autre située sur le Plateau Mont-Royal et fréquentée surtout par des enfants d'immigrés asiatiques, vietnamiens et chinois notamment. Quand, dit-elle, je fais remarquer à un petit vietnamien que son dessin est beau, mais qu'il a tel ou tel défaut, il m'écoute avec une parfaite attention et s'incline ensuite en signe de reconnaissance pour la leçon qui vient de lui être faite. La semaine suivante, il revient avec un dessin qu'il a remis cent fois sur le métier avec l'encouragement de ses parents. À Outremont, si j'ai l'audace d'ébaucher une critique, je me heurte aux droits de l'enfant. Droit sacré à l'épanouissement et à la libre expression de soi! -Tu n'as pas le droit de dire du mal de mon dessin, m'a dit un jour textuellement un marmot de quatre ans.
Madame Maksimova n'est pas du tout étonnée que plus tard, au secondaire, les petits vietnamiens raflent toutes les premières places.
L'influence des parents épris des droits se fait aussi sentir au secondaire. Il y a quelques années les autorités de l'école secondaire Louis Riel de Montréal décidaient, pour des motifs liés aux règlements de l'institution, de garder un certain nombre d'élèves en retenue. Surgit un père de famille en colère: les motifs invoqués par les autorités n'étaient pas conformes à ses principes. Son fils avait bravé un interdit formel pour participer, à l'extérieur des murs de l'école, à une manifestation qui, de l'avis des autorités, présentait quelque danger, surtout pour les plus jeunes élèves, et qui, de toute manière, se tenait pendant les heures régulières de classe. Le père estimait qu'il y avait eu atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'association de son fils. Il n'acceptait pas non plus la nature même de la punition, laquelle consistait à copier x fois telle fable de La Fontaine.
Le litige fut porté devant les tribunaux. Le plaignant ne demandait pas d'argent pour le préjudice fait à son fils, il exigeait plutôt que l'école s'engage à distribuer la Charte des droits à tous les élèves et à en faire la promotion. L'affaire fut portée devant le juge Reeves, de la Cour d'Appel, lequel donna raison aux autorités de l'école, allant jusqu'à les féliciter d'avoir conservé au programme des oeuvres aussi formatrices que les fables de La Fontaine.
Un juge ayant, plus tôt dans sa carrière, contribué à la rédaction de la Charte des droits, aurait sans doute blâmé l'école au moins pour son refus d'admettre la dite Charte. L'école secondaire Louis Riel était à ce moment l'une des rares institutions scolaires du Québec à refuser de faire de la Charte québécoise un instrument de formation. Les autorités s'appuyaient d'ailleurs sur l'article 20 de la dite Charte pour justifier leur refus.
"Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire."
Dans une circulaire distribuée par la Commission scolaire de Coaticook en 1985, on pouvait lire ces lignes qui reflètent assez bien la façon étonnamment facile dont l'implantation de la Charte s'est faite dans la plupart des écoles:
"Le programme d'enseignement moral se réfère notamment aux orientations morales les plus généralement reconnues dans notre société, lesquelles s'expriment dans la Charte des droits et libertés de la personne au Québec et dans les Chartes canadiennes et universelles des droits."
L'omniprésence des chartes dans la vie des enfants et des adolescents est le signe le plus manifeste et le plus inquiétant de l'inflation juridique. Personne ne semble s'être sérieusement interrogé sur la valeur des chartes de droits comme fondement de l'enseignement moral laïc. Un tel enseignement peut être orienté vers l'éveil des mobiles généreux plutôt que vers l'apprentissage de la revendication, vers les obligations plutôt que vers les droits, il peut être fondé sur la philosophie de Platon, sur celle de Descartes, de Kant ou même sur celle de Confucius, plutôt que sur les chartes. Les chartes de droits, dont nous verrons que les fondements sont plus que fragiles, ont tout de même gagné la course contre tous les grands systèmes philosophiques.
Elles ont gagné sur deux plans simultanément: en tant qu'instruments d'apprentissage de la revendication pour les jeunes et en tant que constitution pédagogique pour les écoles. À l'ombre des chartes, les écoles risquent de perdre leur autonomie exactement comme les parlements d'Ottawa et de Québec ont dû céder aux juges une partie de la leur quand une charte de droits a été enchâssée dans la constitution ou dans ce qui en tient lieu.
Les autorités d'un collège ou d'une université pourraient très bien se doter d'une philosophie de l'éducation où serait donnée à la connaissance de soi-même, de ses possibilités et de ses limites, une importance telle que l'affichage des résultats deviendrait nécessaire. Une telle philosophie serait toutefois illégale au Québec, à moins que les juges n'interprètent l'article 20 de la Charte du Québec de façon à lui donner préséance sur les textes légaux qui interdisent actuellement l'affichage des résultats. On voit par là que même dans l'hypothèse la plus heureuse du point de vue de l'école, l'appareil judiciaire a préséance sur la tradition ou le Parlement. Une liberté que les écoles pouvaient prendre ou ne pas prendre devient un privilège qu'elles doivent conquérir de haute lutte judiciaire.
C'est délibérément que j'ai pris mes premiers exemples dans le dernier milieu où l'on devrait s'attendre à voir la règle de droit supplanter la règle de sociabilité: l'école, et hors des États-Unis, que l'on présente trop facilement comme le seul véritable enfer judiciaire de la planète.
(À propos des États-Unis, il faut d'abord préciser que si c'est l'endroit où les plus étranges poursuites fleurissent sur les sols les plus inattendus, c'est aussi celui où l'on a porté les diagnostics les plus sèvères sur le mal judiciaire. Les exemples accablants qui sont donnés font en général partie d'articles ou de livres destinés à fustiger les excès de la judiciarisation. L'Amérique des tribunaux a au moins le mérite de faire son propre procès.)
On ne s'étonne plus que le droit ait envahi l'école quand on sait la place qu'il occupe dans les familles. Les citoyens de St-Catherines en Ontario en savent quelque chose. Un millionnaire de l'endroit, Helmuth Buxbaum, âgé de 47 ans, était récemment condamné pour le meurtre de sa femme. Sa condamnation à vie ne fut toutefois que le premier de ses soucis juridiques. Son frère Isbrandt devait ensuite intenter une poursuite de 500,000$ contre lui. Motif: le préjudice psychologique subi par Roy Buxbaum (fils d'Isbrandt), qui avait été témoin du meurtre alors qu'il n'avait que seize ans. Dans la famille Buxbaum toutes les générations sont également éprises de justice. Pour ne pas être en reste par rapport à son oncle Isbrandt, et sans doute aussi pour empêcher que le dédommagement réclamé par celui-ci ne soit payé à même les propriétés de son père, le fils aîné d'Helmuth, Paul, âgé de 22 ans, poursuit son père pour lui enlever tout droit sur le domaine inscrit au nom de sa défunte épouse.
Devant le spectacle d'un tel esprit de famille, les assureurs n'allaient évidemment pas être enclins au pardon. Ils sont allés en cour à leur tour pour bien s'assurer qu'Helmuth Buxbaum avait perdu tous ses droits sur l'assurance de 1,000,000$ qu'il avait prise sur la vie de sa femme un mois avant sa fin tragique.
L'accusé allait-il supporter cette avalanche de procès avec une résignation toute chrétienne? Le pauvre homme avait eu recours à Edward Greenspan, l'un des avocats les plus réputés de Toronto. C'est ainsi qu'il lui en coûta plus d'un million pour être finalement condamné à vie. Il trouva évidemment l'addition amère et, aux dernières nouvelles, il avait retenu les services d'un rival de Greenspan, Clayton Ruby, pour porter sa cause en appel et harceler son ancien défenseur. [note: cf. The lawyers Weekly, 31 octobre 1986.]
Et ce n'est sans doute pas la fin de cette saga justicière. Compte tenu de la façon dont on le malmène de toutes parts, Helmuth pourra sans doute invoquer un jour une quelconque charte de droits. Ou peut-être pourra-t-il, grâce à la génétique, démontrer qu'il était nécessité à tuer comme une pierre est nécessitée à tomber, auquel cas il pourrait poursuivre ses parents, comme cet handicapé de Boston qui a poursuivi sa mère pour l'avoir laissé naître en le sachant voué au malheur. Ce sont là des procès assez fréquents pour qu'on éprouve le besoin de les ranger dans une catégorie spéciale, les poursuites pour mal de vivre ("wrong life actions".)
Omniprésent dans le malheur des familles, à l'occasion des divorces, des maladies, des crimes ou des accidents, le droit n'en est pas tout à fait absent dans les moments heureux, le mariage par exemple. Aux États-Unis du moins, les contrats de mariage ressemblent de plus en plus aux conventions collectives du secteur public québécois.
On ne comprendra vraiment ce que sont devenus les rapports entre le droit et la famille que lorsque les nouvelles techniques de reproduction se seront généralisées. Dès la phase embryonnaire, les liens affectifs et sociaux auront été remplacés d'une part par la technique biologique et d'autre part par la technique juridique. La naissance de chaque enfant supposera plusieurs autres contrats - selon les cas, avec la mère porteuse, avec le donneur, avec l'agence spécialisée, avec la banque de sperme, la clinique, etc. Chacun de ces contrats multipliera les occasions de litige.
La congélation des embryons a déjà suscité des procès rocambolesques. Il y a quelques années les propriétaires californiens d'embryons conservés en Australie sont morts dans un accident. À qui appartenaient les embryons, et surtout à qui appartenait la fortune des victimes? Aux héritiers potentiels que représentaient les embryons? Aux propriétaires de la banque d'embryons? On se souvient aussi de l'affaire Cotton en Angleterre. Le 7 janvier 1985, Mme Kim Cotton, la mère porteuse du premier bébé commercial britannique a supplié les services sociaux de permettre aux parents adoptifs, un couple américain, de prendre possession de la petite fille qu'ils avaient achetée. La légalité du contrat avait été contestée devant les tribunaux.
L'adoption internationale ne simplifie guère les choses sur ce plan. Les lois du pays des parents biologiques s'ajoutent dans ce cas à celles du pays des parents adoptifs. Il en résulte un imbroglio juridique se traduisant par des délais pouvant aller jusqu'à sept ans, pendant lesquels l'enfant déjà attribué risque de mourir faute d'attentions et de soins adéquats.
S'il est de plus en plus difficile de naître et de trouver une famille hors du légalisme, il n'est guère plus facile de mourir dans la simple convivialité. L'un de nos correspondants, monsieur Hubert Doucet, professeur de bioéthique à l'Université Saint-Paul d'Ottawa a bien voulu attirer notre attention sur un point crucial de l'interaction entre le droit, la médecine et l'éthique au moment de la mort.
"Je voudrais mentionner un autre exemple où le juridique risque de conduire à une mauvaise pratique médicale. L'établissement de politiques concernant la réanimation est, par certains aspects, intéressant. On reconnaît que la mort n'est pas le mal absolu q'il faut combattre à tout prix. Cette reconnaissance est un grand pas pour la médecine moderne: reconnaître sa limite. Le problème que pose la politique proposée, par exemple, dans la "Déclaration conjointe concernant les malades en phase terminale" (AIIC, AMC, et AHC) est que le médecin ne peut plus ne pas réanimer s'il ne l'a pas d'abord inscrit au dossier. Dans de nombreuses situations (vg. situations d'urgence), ne pas réanimer ne peut pas être inscrit au dossier. Le médecin doit donc réanimer, mais il ne sert pas alors le meilleur intérêt du patient."
Cet exemple montre que la relation patient-médecin se développe dans un contexte contractuel, beaucoup plus que dans un contexte d'alliance thérapeutique.
Après la religion, la famille et l'école, le secteur de la vie sociale qui devrait être le plus à l'abri du droit c'est celui de la santé. Nous venons de donner un exemple de la pénétration du droit dans les hôpitaux. On connaît depuis lontemps la phénomène de la médecine défensive. Quand les primes annuelles d'assurance dépassent 100,000$, comme c'est fréquemment le cas pour certaines spécialités aux États-Unis, il faut s'attendre à ce que les médecins cherchent à se protéger. Selon le président de l'Association médicale du comté de Los Angeles, un tiers des tests demandés par les médecins sont faits par crainte d'une poursuite. Cela représenterait un budget de plus de 20 milliards$ dépensés en pure perte pour Medicare seulement. Selon Jury Verdict Research Inc., dans les dossiers d'erreurs médicales, les victimes ont gagné 71 procès avec des indemnités de plus de 1 million$ et 285 de moins de 1 million$ en 1984. En 1980, il y a eu 20 procès avec indemnités de plus de 1 million$ et 126 avec des indemnités de moins de 1 million$. [note: Stephen Wermiel, "Courting Disaster; the Costs of Lawsuits, Growing Ever Larger, Disrupts the Economy", Wall Street Journal, 5 mai 1986, p. 14.]
Le Canada, de toute évidence, ne veut pas être en reste. Certaines statistiques extraites d'un article intitulé "Canadian Medical Malpractice Crisis" [note: Pierre Grégoire, Canadian Underwriters, mai 1984.] soulignent que le nombre de poursuites par médecin au Canada est passé de 1 pour 274 en 1970, à 1 pour 137 en 1975 et à 1 pour 76 en 1980. On estime que la fréquence de ces recours pourra s'établir à 1 pour 38 en 1987 et à 1 pour 20 en 1992. Si ces prédictions s'avèrent exactes, le nombre de recours dirigés contre des médecins aura plus que décuplé en 20 ans. On sait d'autre part que depuis le célèbre jugement prononcé par la Cour Suprême en 1978 dans une affaire appelée depuis la Trilogie, les indemnités offertes au Canada sont en hausse constante.
Et ce n'est là qu'un aspect de la question. L'une de nos correspondantes, Madame Francine Mckenzie, présidente du Conseil du Statut de la femme du Québec, semble persuadée que le taux anormalement élevé d'accouchements par césarienne est attribuable à la médecine défensive et donc aux poursuites contre les médecins. Comment, se demande-t-elle, expliquer qu'une femme sur cinq accouche par césarienne? (...) Il y a là de quoi reviser notre Physiologie. Selon une thèse avancée par des physiothérapeutes, la taille des femmes ne serait plus celle d'autrefois: le bassin serait devenu plus étroit (...) Pas très convaincant. La crainte des poursuites judiciaires chez les médecins me semble une meilleure hypothèse. Dans deux ou trois causes qui ont fait jurisprudence aux États-Unis, des accoucheurs ont effectivement été condamnés pour n'avoir pas eu la prudence de pratiquer une césarienne qui aurait sauvé la vie de leur patiente.
On peut raisonnablement présumer que plusieurs obstétriciens ont décidé de ne pas se laisser prendre au même jeu. Quand ils n'ont pas carrément cessé de faire des accouchements. Le American College of Obstetricians and Gynecologists soutient que l'augmentation des dépenses liées à la responsabilité civile a entraîné une augmentation de 70$ en moyenne pour un accouchement normal entre 1983 et 1985. Les primes des obstétriciens ont quant à elles doublé ou triplé; et en 1983, 2,230 des 24,500 membres du College avait cessé de mettre des enfants au monde par crainte d'une pousuite; en 1985, ils ont été imités par 784 collègues. [note: Stephen Wermiel, "Courting Disaster; the Costs of Lawsuits, Growing Ever Larger, Disrupts the Economy", Wall Street Journal, 5 mai 1986, p. 14.]
La méfiance -d'inspiration juridique - à l'égard du patient fait désormais partie des principes qu'on inculque aux médecins pendant leur formation.
En Ontario, précise Hubert Doucet (la situation est probablement la même au Québec) les internes et les résidents sont invités à se servir du dossier comme instrument de protection dans l'éventualité d'une poursuite plutôt que comme d'un instrument permettant une meilleure connaissance de l'évolution du patient. Ils sont de plus invités à informer leur malade des conséquences possibles d'une intervention, un patient bien informé n'ayant aucune raison d'intenter une poursuite. Comme le disait récemment le célèbre avocat torontois Edward Greenspan, dans Canadian Doctor de septembre 1986: "À l'instar des avocats, les médecins devraient raconter à leurs clients les pires histoires d'horreur (horror stories) imaginables. Les médecins, ajoutent-ils, doivent apprendre à se protéger eux-mêmes contre leurs patients. On suit ce conseil à la lettre dans les cours d'éthique et de droit."
Ayant si habilement et si énergiquement contribué à créer et à entretenir le climat de méfiance et de revendication, les avocats devaient fatalement en être victimes eux-mêmes un jour. C'est effectivement ce qui commence à se produire aux États-Unis. L'avocat qui ne gagne pas sa cause est poursuivi par son client pour malpractice juridique. Me Chantal Corriveau a évoqué cette délicate question lors du Colloque sur l'avenir de l'indemnisation du préjudice corporel tenu à l'Université d'Ottawa en octobre 1986. Voilà, a-t-elle dit, que la victime insatisfaite de son jugement se retourne contre le capitaine du navire qui a échoué.
Le monde des affaires
Le monde des affaires ne pouvait évidemment pas rester à l'écart. Le mal atteint aussi les petites entreprises. Un de nos correspondants l'a appris à ses dépens. Nous avions, mon collaborateur et moi, conclu une entente avec une corporation professionnelle au sujet d'un projet que nous devions réaliser conjointement. J'avais rencontré la présidente de cette corporation, le conseil d'administration avait donné son aval. Bref, je croyais la chose faite. L'administrateur de la corporation, un homme honnête et prudent, crut bon de consulter un avocat qui souleva toutes sortes d'objections. Il me fallait établir que je ne partirais pas en voyage avec l'argent investi, prendre une assurance-vie pour mon associé au cas où nous mourrions en même temps dans un accident etc. Notre correspondant a fini par renoncer au projet dans un mouvement de colère à propos duquel il n'avait pas consulté son avocat.
Un autre correspondant, européen, nous a appris que les hommes d'affaires américains sont les plus procéduriers du monde. Un contrat entre sociétés, qui ne dépassera pas quinze pages en Europe, s'étendra sur trois cents cinquante pages si l'un des signataires est américain. La méfiance est contagieuse. Attaquées fréquemment par les consommateurs, les entreprises américaines font de l'administration défensive, comme les médecins font de la médecine défensive.
Selon la Sporting Goods Manufacturers Association, sur les 100$ que coûte un casque protecteur de football, 25$ servent à payer la prime d'assurance responsabilité de la compagnie. Plusieurs entreprises ont fermé leurs portes, après avoir découvert qu'il en coûtait plus pour assurer les casques que pour les fabriquer. [note: "Courting Disaster; the Costs of Lawsuits, Growing Ever Larger, Disrupts the Economy", Wall Street Journal, 5 mai 1986, p. 14.]
Un fabricant d'échelles interviewé au cours de l'émission 60 Minutes, du réseau américain CBS, a raconté qu'il passait environ 20% de son temps de travail en cour pour défendre sa compagnie contre les poursuites. Un client a même intenté une action contre la compagnie sous prétexte que, dans la brochure accompagnant l'échelle qu'il utilisait, rien n'indiquait qu'elle pouvait glisser si elle était placée dans du fumier frais et mouillé. Les échelles vendues par cette compagnie sont maintenant couvertes de mises en garde. [note: Émission "60 Minutes", réseau CBS, 23/03/86.]
Le Southeastern Pennsylvania Transportation Authority, qui dessert l'agglomération de Philadelphie, pense augmenter les tarifs d'autobus de 25 cents pour compenser la hausse récente de ses primes d'assurance: 22 cents par voyage vont à la défense contre les poursuites et au paiement des primes d'assurance. De 1979 à 1985, alors qu'il y avait une baisse du nombre des accidents rapportés (de 11,103 à 9,556), le nombre de plaintes est passé de 5,529 à 8,500 et le nombre de poursuites a augmenté d'autant. Ce qui veut dire qu'en 1979, à peu près la moitié des victimes d'accidents portaient plainte auprès de cette commission de transport et que ce chiffre est passé à 89% en 1985: une augmentation de près de 40%. [note: Stephen Wermiel, "Courting Disaster; the Costs of Lawsuits, Growing Ever Larger, Disrupts the Economy", Wall Street Journal, 5 mai 1986, p. 14.]
C'est ainsi que se déclenchent les réactions en chaîne. L'ensemble de l'industrie du transport et du tourisme est touché. Un hôtel de l'Etat de New-York laisse sur la commode de ses chambres une note expliquant aux clients que la hausse des primes d'assurance responsabilité les force à augmenter le prixde 5.00$ par jour. Les autorités de l'hôtel soutiennent que c'est l'augmentation du nombre de poursuites et la hausse des indemnités qui expliquent cette situation. [note: Stephen Wermiel, "Courting Disaster; the Costs of Lawsuits, Growing Ever Larger, Disrupts the Economy", Wall Street Journal, 5 mai 1986, p. 1.]
On comprend qu'une nouvelle profession, le "risk manager," soit apparue dans ce contexte. Voici comment T. Bidger, un "risk manager" à l'emploi de Canada Packers parle de l'importance nouvelle des gens comme lui dans l'industrie: désormais les entreprises ne peuvent plus faire des acquisitions, lancer un produit ou signer un quelconque contrat sans prendre les problèmes de responsabilité en considération. En plus d'acheter les polices d'assurance pour son entreprise, le "risk manager" doit trouver des alternatives aux formes traditionnelles d'assurance, quand ces dernières sont dans l'impossibilité d'offrir la protection demandée à un prix raisonnable. L'Université de Toronto prépare actuellement un cours d'administration spécialisé en gestion de risque. [note: Tony Bridger, "Risk manager's job never been tougher", Financial Post, 30 août 1986, p. 11.]
Sans doute, pour justifier les hausses de leurs produits ou de leurs services, les entreprises ont-elles parfois tendance à exagérer l'importance de la crise de l'assurance responsabilité. Nul ne saurait toutefois nier la gravité de situation dans bien des cas. Cette année, la compagnie de transport par camions J.D. Smith de Toronto a vu sa prime passer de 100,000$ à 300,000$, ce qui l'a obligé à augmenter ses tarifs de 5%. Compte tenu de la concurrence, de nombreuses compagnies ne peuvent pas se permettre une telle hausse. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, au moins trois sociétés canadiennes de transport sont acculées à la faillite. [note: Small Business, Septembre 1986, p. 55]
Certaines compagnies n'ont même pas la chance de courir le risque de la faillite: on ne veut les assurer à aucun prix. C'est ainsi que la compagnie Brazeau International, filiale américaine d'une société québécoise, a dû récemment mettre fin à ses activités.
Les causes de cette crise sont évidemment complexes, mais voici une histoire qui jette la lumière du bon sens sur cette complexité. Il y a quelques années un camion appartenant à la compagnie Les Services du Cocher Inc. de Montréal (équivalent légal français de Coachmen), heurtait une voiture dont le conducteur est mort sur le coup. L'accident s'est produit sur une Interstate de l'Ohio. Des témoins ont pu affirmer aux policiers que le conducteur du camion n'était aucunement responsable, la voiture lui ayant carrément coupé la route. En voyant la plaque de la voiture, les policiers ont d'autre part constaté que le conducteur mort était recherché, deux plaintes pour inconduite en état d'ébriété ayant été portées contre lui par des hôteliers. Des analyses du sang ont enfin permis d'établir que le conducteur était complètement ivre.
Il importe de noter qu'on ne connaissait aucune famille au dit conducteur. Comme il n'avait pas d'assurance automobile, la compagnie de transport a dû payer elle-même les dommages du camion. Il n'empêche que, deux ans plus tard, au nom d'une vague parenté, un avocat travaillant au pourcentage a logé une plainte contre l'un des hôtels qui avaient laissé partir son client en état d'ébriété. L'hôtel à son tour a porté plainte contre le conducteur et le propriétaire du camion. Ce dernier, selon toute vraisemblance, tentera d'obtenir un dédommagement pour le camion si, à l'issu du procès contre l'hôtel, il découvre que la parenté est solvable.
Les histoires démentes de ce genre font partie de la vie quotidienne d'un nombre croissant d'entreprises. Au Canada, comme aux États-Unis, plusieurs d'entre elles, de même que de nombreuses institutions publiques sont maintenant incapables de trouver une compagnie d'assurance ou de payer les primes qui leur sont demandées, même si elles n'ont jamais été poursuivies. Un nombre grandissant d'États tentent de réduire les indemnités ou de réformer la loi sur la responsabilité civile. Un projet de loi allant dans ce sens est présentement à l'étude à la Maison Blanche.
Au Canada, de nombreuses associations d'entreprises multiplient les études sur la question et entreprennent des démarches auprès des pouvoirs publics. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes publiait une première analyse en octobre dernier. Il appert qu'au cours de l'année 1986, 14.6% des entreprises québécoises et 16% des entreprises canadiennes ont été dans l'impossibilité d'obtenir une assurance responsabilité civile quel qu'en soit le prix. Près du quart de ceux qui ont répondu à l'enquête (24.2%) ont vu leurs primes augmenter de plus de 50% et plus. Au Québec, 7.6% des entreprises et au Canada, 8.3% ont eu des augmentations de 200% et plus. Et plus du tiers des membres de la FCEI dont les primes ont été majorées ont dû faire face à une réduction de la garantie ou à une augmentation de la franchise. [note: Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Analyse nationale, partie 1, septembre 1986]. Les PME sont aussi touchées indirectement. Une excellente façon pour elles d'assurer leur développement est d'inviter des personnes compétentes de l'extérieur à faire partie de leur conseil d'administration; malheureusement, les assureurs se font de plus en plus rares dans ce marché et quand ils daignent offrir une protection, le coût en est exorbitant. M. Marc Ruel, homme d'affaires chevronné devenu consultant auprès des PME, nous a donné des précisions sur cette question: il ne reste que deux sociétés canadiennes qui acceptent d'assurer les administrateurs de l'extérieur: ENCON à Ottawa et Stewart Smith à Montréal. Ces grossistes spécialisés semblent inondés de demandes; ils refusent d'assurer les dirigeants de PME considérées "à risque"; et quand ils acceptent de le faire, les primes sont tellement élevées et les polices comportent tellement d'exclusions que ce sont les entreprises qui refusent le marché.
On comprend que même le Wall Street Journal ait tiré la sonnette d'alarme. En mai dernier y paraissait une série d'articles remarquables sur la question. Quelques-uns des exemples donnés précédemment ont été puisés dans cette série. Le titre et le sous-titre du premier article ne laissent aucun doute sur les raisons pour lesquelles ce journal de l'Establishment a décidé d'attaquer l'institution américaine par excellence: les tribunaux. Désastre en perspective; le coût des poursuites, qui ne cesse de s'accroître, ébranle l'économie.
Et c'est pourtant vers le droit qu'on se tourne pour régler les problèmes techniques qui ralentissent l'économie. Quand il y a quelques années l'industrie automobile américaine fut obligée par une loi à respecter des normes de sécurité plus sévères, telle grande compagnie de Détroit engagea deux cents avocats dans le but de faire abroger la loi ou de trouver des moyens de la contourner. Leurs concurrents japonais engagèrent deux cents ingénieurs pour mieux s'adapter à la nouvelle situation.
Les tableaux illustrant les tendances actuelles sont tout aussi éloquents. Un premier permet de visualiser le taux de croissance des indemnités dépassant 1,000,000$ depuis 1965. Un autre indique la croissance de la part du PNB américain consacrée au paiement des indemnités et des honoraires d'avocats. Il ne s'agit là, rappelons-le, que de la responsabilité civile. Les 66.5 milliards de dollars (ou 1.78% du PNB) ne sont qu'un des éléments de la note globale des services juridiques.
Pendant qu'augmentent les dédommagements pour préjudices corporels, les préjudices psychologiques ou affectifs, voire même moraux, sont progressivement admis par les tribunaux. Il en va de même pour les dommages dits punitifs. La compagnie Coleman fabri-quait jadis des voiliers équipés de mâts en aluminium. L'aluminium étant un bon conducteur de courant, il arriva qu'un marin amateur s'électrocuta quand le mât central de son catamaran heurta des fils électriques. En plus d'être condamnée à verser 500,000$ à la famille de la victime, la compagnie Coleman dut payer 1.4 millions$ en dommages punitifs. Motif: ce n'était pas la première fois qu'un mât d'aluminium provoquait un accident.