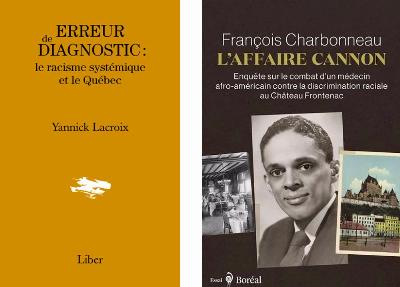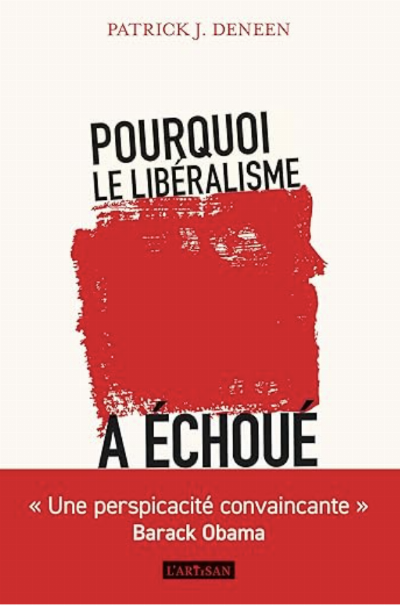Le mensonge, arme de déception massive - Vérité et politique selon Hannah Arendt
La philosophie nous permet de mieux comprendre le monde actuel : tel est un des arguments les plus souvent évoqués par les professeurs de philo pour justifier l’enseignement de leur matière au collégial. Le Devoir leur a lancé le défi, ainsi qu’à des essayistes, de décrypter une question d’actualité à partir des thèses d’un grand penseur enseigné au collégial. Toutes les deux semaines, nous publions Le Devoir de philo d’un professeur. À ses étudiants de l’évaluer...
La politique, aujourd’hui, serait un théâtre burlesque où des politiciens prompts au mensonge rient entre eux de leurs pantalonnades devant un public candide. D’un scandale à l’autre, les citoyens n’en finissent pas de se découvrir bernés par ceux en qui ils ont eu confiance. Le mensonge en politique, au contraire de la croissance en économie, ne connaîtrait ainsi pas de récession.
C’est du moins là un avis communément partagé, où point une amère désillusion devant le politique, que les récentes turpitudes révélées par la commission Gomery ou le mensonge de l’administration Bush au sujet de l’existence d’armes de destruction massive en Irak ont contribué à fortifier.
En 1997, le journaliste André Pratte avait mis toute la classe politique canadienne et québécoise sur la sellette. Son essai Le Syndrome de Pinocchio avait dépeint nos politiciens comme des menteurs invétérés, sur le postulat que le mensonge en politique n’est en aucune manière acceptable au nom du droit fondamental à la vérité. Interpellée, l’Assemblée nationale du Québec adressa quasi unanimement une motion de blâme à l’impertinent essayiste.
La tentation de l’angélisme
Vérité et politique ne font pas bon ménage, il est vrai, mais est-ce une raison de maintenir sans appel la sentence de réprobation si facilement jetée désormais sur la classe politique ? Parmi les penseurs contemporains qui se sont penchés sur cette question difficile, nous comptons Hannah Arendt, figure marquante de la philosophie politique au XXe siècle.
Dans un article publié en allemand en 1964 et intitulé Vérité et politique dans sa traduction française, Arendt nous met tout d’abord en garde contre la tentation de l’angélisme contempteur ou de la simplification devant le phénomène du mensonge en politique. C’est là une position qui en surprendra plusieurs. Mais étudions plus attentivement ce qu’Arendt a à nous dire.
Premièrement, il serait absurde, souligne-t-elle, de prétendre que la vérité doit prévaloir en toutes choses, dût la communauté en périr. L’action politique est ce par quoi nous cherchons « à établir ou à sauvegarder les conditions de la recherche de la vérité ». Comme substitut à des moyens plus violents, le mensonge peut s’avérer, à certaines occasions, le moyen le moins dévastateur de préserver les havres de paix nécessaires à la poursuite de la vérité. De plus, comme Chateaubriand l’avait fait dans son Génie du christianisme, Arendt constate qu’aucune des grandes religions, le zoroastrisme excepté, ne catalogue le mensonge parmi les péchés mortels.
Pendant longtemps, les philosophes ne s’occupaient guère des mensonges manipulateurs en politique mais plutôt de la difficile coexistence entre ceux qui consacrent leur vie à la vérité et à la sphère politique. Arendt va même jusqu’à soutenir que les mensonges ont commencé en fait à devenir scandaleux sous l’influence de la morale puritaine, dont l’apparition a coïncidé avec celle de la science qui suppose la confiance en « l’absolue sincérité de tous les savants ».
Mais Arendt n’est pas l’apologiste du mensonge en politique, loin s’en faut. Elle fait toutefois valoir que le fait de considérer la politique du point de vue de la vérité, c’est se placer en dehors du politique. Le détenteur d’une vérité est celui qui, après un long dialogue intérieur, arrive à une conclusion qui s’impose par la force du raisonnement. La vérité a un caractère despotique, dit Arendt, qui est à l’opposé de l’action politique pour laquelle tout est opinion, persuasion, consensus.
Lorsqu’ils proclamèrent leurs droits inaliénables, les rédacteurs de la Déclaration américaine d’indépendance de 1776 écrivirent : « Nous tenons ces vérités pour évidentes... » Jefferson savait qu’on n’entre pas en politique avec de grandes vérités sans devoir lui faire des concessions. Rien n’ébranle plus une communauté que l’irruption de porteurs de vérités absolues.
Selon Arendt, il importe d’établir une distinction entre vérité rationnelle et vérité de fait pour saisir l’impact du mensonge. La première, qui se rapporte aux vérités des sciences, de la philosophie et des mathématiques, survit plus aisément aux assauts du politique, qui les conteste rarement, alors que la deuxième, qui touche aux faits historiques et sociaux, est d’un statut plus précaire, sans cesse soumise aux manoeuvres du pouvoir. Si le camouflage ou le silence ne guettent la vérité de fait, c’est le bannissement par l’oubli qui l’emporte à jamais hors du monde.
La vérité de fait
La vérité de fait est politique par nature puisqu’elle naît du consensus, de la concordance des témoignages et affecte diverses personnes. Proclamer la vérité de tel ou tel fait, c’est donc risquer de heurter l’intérêt de quelque individu ou groupe social. La vérité de fait se distingue mal de l’opinion et sa chance de survie auprès de courants hostiles est bien mince, alors que la vérité rationnelle peut toujours s’en remettre au triomphe de la raison ou à la vie exemplaire de celui qui agit en conformité avec sa vérité.
L’argument le plus troublant qu’avance Arendt pour conclure à la permanence du mensonge en politique est qu’il « fait partie des quelques données manifestes et démontrables qui confirment l’existence de la liberté humaine ». Le menteur est celui qui estime qu’il n’a pas à déterminer sa conduite ou ses dires sur ce qui est ; il affirme, ce faisant, sa volonté de changer la réalité, d’aller au-delà. C’est donc un individu d’action, qui a toujours une avance sur le simple diseur de vérité qui, s’il se lance dans la mêlée, perd les seules qualités pouvant le rendre crédible, soit l’impartialité et l’indépendance.
Deux grands hommes d’État contemporains ont édifié leurs politiques sur des mensonges : de Gaulle et Adenauer. Le premier sur l’idée que la France fut l’une des puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale ; le deuxième sur celle que le national-socialisme fut le fait d’une minorité en Allemagne. Par le mensonge, l’homme politique tient un pari, qui tourne à la réussite ou à la catastrophe.
Notre époque a plus que jamais à craindre du mensonge politique, croit Arendt, pour la raison que les médias de masse et la propagande gouvernementale et privée ont atteint une capacité de manipulation des faits sans précédent. Jadis, les États pratiquaient le mensonge dans un cadre limité ; dans les chancelleries du monde, diplomates et émissaires habillaient les secrets d’État d’habiles tromperies. Au moins ces menteurs professionnels ne perdaient pas de vue la vérité qu’il fallait cacher à l’ennemi.
Le mensonge de masse moderne se pratique au vu de tous, et souvent à l’égard de faits connus de tous. Telle tragédie de l’histoire, tel événement encore récent peut subitement disparaître des registres officiels ou subir une réécriture. Ainsi, « la possibilité de mensonge complet et définitif [...] est le danger qui naît de la manipulation moderne des faits », écrit Arendt. Ce danger s’accroît avec le recours généralisé à l’image dans la propagande de masse.
À l’instar de l’historien américain Daniel Boorstin, qui s’alarmait dès le début des années 60 de l’omniprésence de l’image dans la culture américaine, Arendt voit dans l’image un mécanisme de pensée qui atténue nos facultés critiques. Une image, affirme Arendt, « n’est pas censée flatter la réalité mais offrir d’elle un substitut complet ». Elle est transitoire et roule d’autant plus vite que surviennent des faits qui la démentent.
Le principal ressort du mensonge de masse est ce qu’Arendt appelle la tromperie de soi. La propagande n’a prise sur les consciences que si de vastes pans de la population s’y laissent adhérer. La manipulation grossière et délibérée des menteurs d’appareil a donc pour corollaire l’auto-aveuglement des foules. La propagande atteint son effet quand trompeurs et trompés unissent leurs efforts pour défendre la « vérité de l’image » contre ceux qui l’attaquent.
Souvent, remarque Arendt, aux yeux des groupes subjugués par la propagande, les diseurs de vérité de fait ont passé pour plus menaçants que les opposants réels. Que si tel dictateur a expédié des dissidents au fond des mers, ses partisans, ligués contre le péril communiste, étoufferont la voix des familles éplorées. Que si tel président a menti sur le prétexte factuel d’une invasion armée, le journaliste qui met en doute les déclarations présidentielles sera accusé d’être un mauvais patriote... Bref, comme le dit Arendt, « l’art moderne de la tromperie de soi-même est susceptible de transformer un problème extérieur en question intérieure ».
Le signe que le mensonge de masse a fait des ravages sérieux est qu’il engendre un cynisme aigu — « le refus absolu de croire en la vérité d’aucune chose, dit Arendt, si bien établie puisse être cette vérité ». La substitution cohérente de mensonges à la vérité de fait endommage jusqu’à la capacité même de croire en la distinction entre le vrai et le faux. Ce cynisme a frappé les régimes totalitaires, les jeunes nations nées dans la propagande, et tout indique que les démocraties, qui jouissent pourtant des libertés de presse et d’opinion, peuvent y succomber à leur tour.
Même si Arendt a principalement en tête le mensonge gouvernemental, elle n’oublie pas que celui-ci a emprunté ses techniques à la publicité commerciale qui diffuse de jolis mensonges dans l’espoir d’imposer un produit à tous. La démocratie peut donc s’endormir sur les propos lénifiants aussi bien du commerce que du politique.
Le mensonge est donc une donnée incontournable de la vie politique. De même qu’il est illusoire de penser que les politiciens vont gouverner d’après les seuls faits, de même est-il indispensable de restreindre la tendance de tout pouvoir à manipuler les faits à son avantage. À cette fin, les régimes libéraux réfrènent les excès du pouvoir par une constitution et des freins et contrepoids qui divisent la puissance publique.
Toutefois, Arendt doute que la limitation constitutionnelle du pouvoir soit un rempart suffisant contre le mensonge politique. Puisque la vérité loge hors du politique, il importe alors de préserver dans la société « l’existence d’hommes et d’institutions » sur lesquels le domaine politique n’a pas de pouvoir pour trancher des questions de vérité. Déjà, au sein même de l’État, le juge établit des faits allégués relativement à des particuliers. Dans les universités, les sciences historiques et les humanités sont les gardiennes et les interprètes de vérités de fait. Au juge et à l’Académie s’ajoute la presse.
Arendt attache une telle importance au travail des journalistes qu’elle estime que si la presse devenait jamais réellement un quatrième pouvoir, « elle devrait être protégée contre le pouvoir du gouvernement et la pression sociale encore plus soigneusement que ne l’est le pouvoir judiciaire ».
Les dirigeants ont besoin des médias pour propager leurs mensonges édifiants ; nous devons compter sur une presse vraiment indépendante pour rétablir la vérité des faits occultés par les images gouvernementales ou d’entreprise. La concentration actuelle de la presse est un problème dont on n’a pas encore saisi toutes les graves conséquences pour la démocratie.
Arendt a tiré de l’image désormais envahissante des conclusions inquiétantes. Dans la foulée de cette réflexion, nous pouvons constater comment l’ère de l’image s’accompagne de l’obsession du réalisme, aujourd’hui si manifeste à la télévision, dans les arts, à l’école, etc. C’est comme si l’homme démocratique, qui voue un culte à la transparence, avait abandonné tout idéal contraignant, toute référence extérieure à lui, pour se replier sur un monde familier, peuplé de représentations qui collent au plus près sa réalité immédiate.
Ce resserrement des horizons, c’est ce que j’ai appelé le temps de l’homme fini. En 1889, dans un petit essai décapant, l’écrivain Oscar Wilde se désolait du déclin du mensonge dans les arts et la littérature. Le but de l’art, estime Wilde, n’est pas de reproduire notre monde en répliques conformes mais plutôt de l’enchanter par de beaux mensonges riches de nouvelles significations. Notre époque est étrange : le mensonge a gagné en puissance là où il ne faudrait pas et a perdu en envoûtement là où il nous faudrait être trompés.