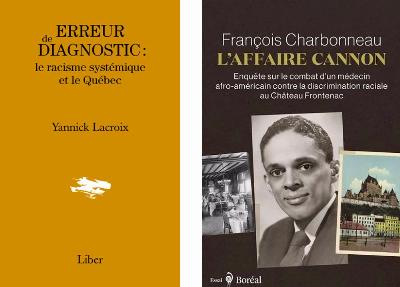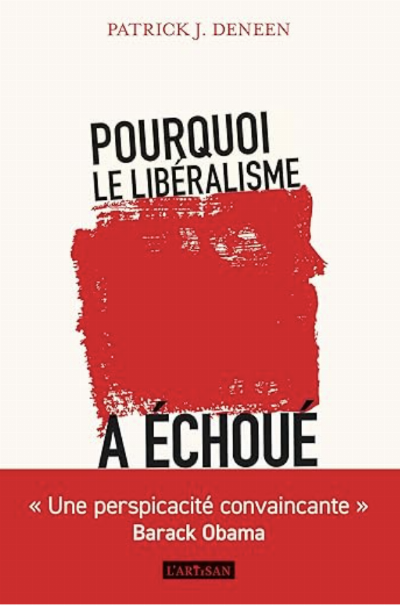L’anglais, langue nationale du Québec et de la …France
Il arrive parfois que le très estimable représentant de sa Majesté la Reine du Canada, le gouverneur général, fasse des déclarations qui plongent la classe politique dans l’embarras. Ainsi en est-il de David Johnston qui, lors du discours du Trône du 16 octobre 2013, a avancé que le Canada est « une fédération où nos deux langues nationales nous confèrent un avantage inégalable dans le monde1. » Peu de temps  après, devant un comité de la chambre des Communes, le parti conservateur s’est enquis auprès du Commissaire aux langues officielles de la portée de l’expression « langue nationale », peu usitée au Canada, à laquelle on a préféré depuis la fin des années 1960 l’expression « langue officielle ». En mars 2014, la même question était posée devant divers comités du parlement. Bref, une curieuse créature refaisait surface. Une étude publiée par la bibliothèque du parlement fédéral en février 2015 et remarquée de personne a tenté de faire le point sur la question. Son titre annonce tout un programme : « Langues officielles et langues nationales? Le choix du Canada »2. On y apprend que le choix du concept de « langue officielle » n’est ni anodin ni irréfléchi. Divers experts, politologues, juristes, sociolinguistes, ainsi que la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, ou communément la Commission Gendron instaurée par le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand en octobre 1969, ont réfléchi sur la distinction entre ces deux concepts d’aménagement linguistique. Selon cette étude de février 2015, ce genre de réflexion aurait même nourri les travaux de la Commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme dès 1963, commission à l'origine des lois linguistiques fédérales. En fait, parmi les experts et les commissaires qui officiaient à Ottawa et à Québec, on observe un certain tiraillement : d’entre le concept de langue officielle et celui de langue nationale, on ne sait lequel appliquer au français et à l’anglais. Finalement, les commissaires fédéraux empruntèrent en 1967 une voie différente de celle que les commissaires québécois ont privilégiée dans leur rapport final de 1972 : alors que les premiers écartent l’idée de désigner le français et l’anglais comme langues nationales au profit de leur reconnaissance comme langues officielles, les deuxièmes recommandent à l’état québécois « de proclamer immédiatement le français langue officielle du Québec, et le français et l’anglais langues nationales du Québec »3.
après, devant un comité de la chambre des Communes, le parti conservateur s’est enquis auprès du Commissaire aux langues officielles de la portée de l’expression « langue nationale », peu usitée au Canada, à laquelle on a préféré depuis la fin des années 1960 l’expression « langue officielle ». En mars 2014, la même question était posée devant divers comités du parlement. Bref, une curieuse créature refaisait surface. Une étude publiée par la bibliothèque du parlement fédéral en février 2015 et remarquée de personne a tenté de faire le point sur la question. Son titre annonce tout un programme : « Langues officielles et langues nationales? Le choix du Canada »2. On y apprend que le choix du concept de « langue officielle » n’est ni anodin ni irréfléchi. Divers experts, politologues, juristes, sociolinguistes, ainsi que la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, ou communément la Commission Gendron instaurée par le gouvernement unioniste de Jean-Jacques Bertrand en octobre 1969, ont réfléchi sur la distinction entre ces deux concepts d’aménagement linguistique. Selon cette étude de février 2015, ce genre de réflexion aurait même nourri les travaux de la Commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme dès 1963, commission à l'origine des lois linguistiques fédérales. En fait, parmi les experts et les commissaires qui officiaient à Ottawa et à Québec, on observe un certain tiraillement : d’entre le concept de langue officielle et celui de langue nationale, on ne sait lequel appliquer au français et à l’anglais. Finalement, les commissaires fédéraux empruntèrent en 1967 une voie différente de celle que les commissaires québécois ont privilégiée dans leur rapport final de 1972 : alors que les premiers écartent l’idée de désigner le français et l’anglais comme langues nationales au profit de leur reconnaissance comme langues officielles, les deuxièmes recommandent à l’état québécois « de proclamer immédiatement le français langue officielle du Québec, et le français et l’anglais langues nationales du Québec »3.
La distinction entre langue officielle et langue nationale
Mais pourquoi cette distinction? Le rapport final de la commission Gendron s’en explique : « Le terme langue officielle désigne tout simplement la langue que l’État a estimé à-propos d’appuyer de sa puissance pour l’usage public, soit par une loi constitutionnelle, soit le plus souvent, par une loi ordinaire. Il peut y avoir plus d’une langue officielle. Le domaine d’application de la ou des langues officielles est parfois stipulé, ou encore simplement limité par inférence4. » Selon la commission, l’article de la constitution canadienne qui oblige le Québec à légiférer dans les deux langues et à autoriser leur usage devant les tribunaux (l’article 133) traite d’une « réalité équivalente » à la reconnaissance d’une langue officielle. Par ailleurs, écrit la commission,
« la langue nationale peut être considérée comme appartenant à une catégorie un peu moins élevée que la langue officielle. Désigner une langue ou des langues comme nationales par une loi constitutionnelle ou ordinaire, c’est simplement attacher à ces langues certains privilèges juridiques au profit de l’usager. Elles se trouvent à recevoir l’appui de ses ressources et de ses deniers. Par exemple, qualifier des langues de nationales pour une ou des régions pourrait signifier qu’un privilège constitutionnel s’attache à leur utilisation comme véhicule principal ou exclusif de l’enseignement dans ces régions, sans que soit enfreinte la règle constitutionnelle d’un enseignement dispensé uniquement dans la ou les langues officielles5. »
La distinction ainsi faite n’est toutefois pas tout à fait claire. Si une langue est officielle par inférence, c’est-à-dire en raison de son usage obligatoire prévu dans la constitution, on ne voit pas pourquoi l’anglais ne pourrait pas être déclaré langue officielle du Québec. Par ailleurs, la commission Gendron semble accorder à la langue nationale un statut inférieur à celui de langue officielle : la langue reconnue nationale n’obligerait pas l’État à quoi que ce soit, et n’aurait qu’une portée régionale. On voit dès lors mal pourquoi il faudrait reconnaître le français et l’anglais langues nationales, après avoir érigé le premier en langue officielle, d’autant plus que ni l’un ni l’autre n’avaient à l’époque de simple extension régionale. Mais cette double proclamation devait dans l’esprit de la commission avoir une « valeur symbolique et de prestige qui faciliterait la mise en oeuvre – par l’incitation psychologique, notamment, plutôt que l’institution de sanctions pénales – des diverses mesures en faveur du ˊfaitˋ français dans le commerce, l’industrie et les domaines connexes6. » Si la commission veut généraliser l’emploi du français dans le monde du travail et mieux informer les immigrants – qui alors envoyaient massivement leurs enfants à l’école anglaise – de la réalité française du Québec, elle répugne à l’emploi de toute coercition pour ce faire, au nom d’un philosophie juridique qui invite le législateur à intervenir le moins possible dans le champ linguistique gouverné encore par les moeurs et la coutume. D’où l’ambivalence et le caractère étrange de cette double proclamation qu’elle recommande. De plus, à lire les opinions juridiques préparées par les juristes Jean-Charles Bonenfant et François Chevrette pour la commission, on voit que celle-ci a emprunté la distinction entre langue nationale et langue officielle au droit suisse7. En effet, la constitution suisse reconnaissait depuis 1874 l’allemand, le français et l’italien comme langue nationales. Dans une modification constitutionnelle faite en 1938, on reconnut le romanche, langue régionale parlée par une petite minorité, langue nationale, après avoir déclaré officielles les trois autres langues, plus répandues.
Le concept de « langue nationale » porté par la commission Gendron n’a jamais réussi à dépasser le stade des recommandations. Les lois linguistiques qui ont suivi le rapport, la Loi sur la langue officielle de 1974 du gouvernement Bourassa, puis la Charte de la langue française du gouvernement Lévesque de 1977, ne font aucune référence à une ou deux langues nationales. Seul le français est reconnu comme langue officielle8, mais l’anglais reçoit des statuts divers. Dans la loi de 1974, l’anglais devient une « loi de communication interne des organismes municipaux et scolaires dont les administrés sont en majorité de langue anglaise9. » Ce principe fut repris implicitement par la Charte de la langue française qui autorise les municipalités dont la majorité de la population est de langue anglaise à utiliser dans leurs communications l’anglais avec le français. Si l’on regarde l’ensemble de la législation québécoise et des normes constitutionnelles applicables à l’état québécois, on s’aperçoit que l’anglais est à la fois une langue de l’état, une langue d’enseignement et de services publics. Ainsi :
1- L’anglais est la langue première dans laquelle l’état du Québec a été créé sous le titre « province of Quebec », en vertu des lois constitutionnelles britanniques, dont seule la dernière, la Loi constitutionnelle de 1982, possède une version française officielle égale à l’anglaise.
2- En vertu de la constitution, l’anglais est langue obligatoire de la législation et de la réglementation québécoises, en concurrence avec le français, et langue protégée des débats parlementaires et des tribunaux, dont l’emploi est laissé au choix des parlementaires, des juges et des plaideurs; de plus, la communauté anglophone du Québec est réputée, aux termes toujours de la constitution, minorité de « langue officielle » en matière d’éducation primaire et secondaire.
3- L’anglais est langue de fonctionnement interne d’une partie appréciable des municipalités ainsi que de nombre d’organismes de santé et de services sociaux10;
4- L’anglais est langue de services publics dans ces mêmes organismes et même dans plusieurs autres organismes d’état qui ont tendance à bilinguiser l’accès aux services.
5- L’anglais est langue d’enseignement dans tout le réseau des commissions scolaires anglophones, qui sont financées par l’état québécois, au même titre que les commissions francophones; il est enseigné comme langue seconde dans tout le système scolaire francophone, alors que l’enseignement d’une troisième langue est peu répandu et optionnel; elle est aussi langue de l’enseignement post-secondaire dans les cégeps et universités anglophones, et langue de la recherche, et ce même dans les établissements réputés francophones.
6- De plus, la législation québécoise a reconnu en 2000 « les droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise11. »
Cette simple énumération suffit à établir qu’en réalité, l’état du Québec traite l’anglais comme une langue nationale et non comme une simple langue minoritaire ou régionale. Mais que voulons-nous dire exactement?
L’anglais, langue nationale de l’éducation supérieure au Québec?
Regardons par exemple une situation paradoxale, peu étudiée, le régime linguistique des universités au Québec. La majorité des établissements universitaires au Québec ont été institués par la Couronne britannique ou par l’Église. Ayant créé directement une université catholique à Sherbrooke au milieu des années 1950, l’état québécois se mettra à partir des années 1960 à laïciser certaines des universités existantes (Laval, Montréal), et à créer de nouveaux établissements (Concordia, réseau de l’université du Québec). Mais il n’a jamais entrepris de donner un statut unifié à l’organisation universitaire ni au corps professoral, tant et si bien que nous arrivons à une situation paradoxale qui divise le système éducatif québécois en deux mondes. Alors que l’accès à l’école anglaise publique est restreint aux cycles primaire et secondaire, il devient un droit universel au niveau post-secondaire, de telle sorte que n’importe quel étudiant qui a complété ses études secondaires peut se former par la suite dans un établissement anglophone financé par l’état. L’enseignement postsecondaire au Québec suit le régime du bilinguisme concurrentiel, c’est-à-dire un système d’enseignement qui offre simultanément deux langues de scolarisation laissées au choix des parents ou des étudiants. Avant 1977, le bilinguisme concurrentiel formait la base de tout le système scolaire québécois, de l’école primaire à l’université. Même si la portée de ce bilinguisme a été réduite par la suite, celui-ci garde une valeur principielle, d’autant plus que la restriction de l’accès à l’école anglaise ne vaut essentiellement, dans l’esprit de la législation québécoise, que pour les mineurs, les étudiants des cycles primaire et secondaire. C’est implicitement dire que le français est une langue de scolarisation infantile dont le caractère obligatoire s’efface à l’âge adulte
Par ailleurs, les universités au Québec n’ont pas d’identité linguistique définie par la loi ou les règlements. On cherchera en vain dans les lois, les règlements de l’état, et même dans les statuts des universités une quelconque disposition sur leur régime linguistique, dont la définition a été longtemps abandonnée aux us et coutumes. Une modification apportée à la Charte de la langue française en 2002 s’est finalement résolue à exiger des établissements universitaires à adopter une politique linguistique relative « à l’emploi et à la qualité de la langue française »12. L’amendement distingue les universités dont la majorité des élèves sont de langue française de ceux dont la majorité est de langue anglaise. Ce critère de majorité est purement factuel; il n’oblige pas les universités à majorité francophone à maintenir cette majorité, ni à privilégier le français dans l’enseignement et la recherche. La seule obligation qui est faite aux universités à majorité francophone est d’adopter une politique qui « traite » de la langue de l’enseignement, des communications internes et du travail – sans aucune mention de la recherche du reste. Autrement dit, une université à majorité francophone pourrait du jour au lendemain décider de devenir bilingue ou anglaise tout en se conformant à la Charte de la langue française, en continuant d`indiquer dans sa politique linguistique les éléments requis par cette charte. On le voit, le concept d’université de langue française est totalement absent de la législation québécoise. Ce qui explique que la commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec ait recommandé dans son rapport de 2001 d’assujettir les universités à la Charte de la langue française, mesure qui est restée en substance lettre morte13. Mais cette situation révèle que la recommandation de la Commission Gendron de proclamer à égalité le français et l’anglais langues nationales s’est matérialisée pleinement dans l’éducation postsecondaire, dans le sens précis que la Commission a donné au concept de langue nationale. Ainsi l’anglais et le français sont des langues optionnelles d’éducation universitaire, que l’état québécois généralise sur l’ensemble du territoire et pour toute la population et qu’il finance en fonction des inscriptions dans les établissements universitaires comptabilisées selon un système de calcul semblable à celui d’un marché public aux étudiants.
La langue nationale à travers le monde
Cela dit, le sens que la commission a prêté au concept de langue nationale est très particulier au regard des sens possibles que les États lui ont conférés en pratique et en droit à travers le monde. Plusieurs reconnaissent dans leur constitution ou leur législation une ou plusieurs langues nationales, en concurrence souvent avec une ou plusieurs langues officielles. On peut distinguer différents cas de figure :
1- La langue nationale correspond à une langue minoritaire à laquelle l’État veut accorder une protection particulière, pour protéger « un groupe dont la langue fait partie du patrimoine culturel de la nation »14; c’est le cas du romanche en Suisse ou du celtique irlandais en Irlande. Elle peut même devenir une langue de l’État, comme en Irlande, même si elle très peu parlée, où cette langue est également langue officielle avec l’anglais15. En ce sens, le cri et l’inuktitut16, auxquels les lois québécoises réservent un traitement particulier, sont des langues nationales, elles font partie du patrimoine linguistique que l’état québécois veut protéger.
2- Dans la foulée de la décolonisation, plusieurs États africains ont conservé la langue du colonisateur comme langue officielle, le français, l’anglais, le portugais, et reconnu comme nationales les langues africaines de leur population dont l’emploi par les instances de l’État demeure toutefois souvent réduit. De même en Amérique latine, des langues amérindiennes se sont hissées au rang de langue nationale ou officielle avec le castillan.
3- De manière plus politique encore, la langue nationale est la langue principale autour de laquelle un État-nation a fait son unité en la généralisant sur son territoire, dans toutes les missions de l’État, y compris l’éducation, et dans la vie civile, au risque toutefois de vouer à la marginalité ou à l’extinction des langues minoritaires. Elle est donc plus qu’un simple instrument de communication. Porteuse d’une identité et d’une culture communes, elle acquiert une puissante dimension symbolique. Bien qu’elle ait tardé à reconnaître que le français est la langue de la République dans sa constitution, la France offre l’exemple par excellence d’un pays qui s’est construit autour d’une langue nationale. Comme l’indique la circulaire adoptée par le premier ministre français en 1994 : « la langue française est un élément constitutif de l’identité, de l’histoire et de la culture nationales […] elle est un élément important de la souveraineté nationale et un facteur de cohésion nationale17 ».
La langue nationale, à la lumière de Gandhi et Renan
Dans d’autres pays, la langue nationale est celle que les élites entendent promouvoir pour opérer une certaine unification linguistique à des fins politiques, sans pour autant réduire la diversité des autres langues, vernaculaires et véhiculaires, encore nombreuses et parlées par un grand nombre de locuteurs. C’est le cas de l’hindi en Inde, qui est la langue indienne la plus parlée sur le sous-continent, qui a acquis le statut de langue « officielle » dans la constitution du pays. Cependant, l’artisan de l’indépendance indienne, le Mahatma Gandhi, avait vu clairement en elle une langue nationale, dont le rayonnement irait au-delà des rouages de l’État. Il avait défini ainsi en ces termes les critères d’une langue nationale (traduction) :
Regardons les exigences auxquelles devrait satisfaire une langue nationale :
1. Les représentants de l’État doivent pouvoir l’apprendre facilement.
2. Elle sert de moyen de communication dans les échanges en matière de religion, d’économie et de politique.
3. La majorité des habitants de l’Inde doit la parler.
4. L’ensemble du pays doit pouvoir aisément l’apprendre.
5. En choisissant cette langue, nous devons écarter les considérations d’ordre temporel ou d’un intérêt passager18.
La définition que retient Gandhi d’une langue nationale a cela d’intéressant qu’elle met l’accent sur sa diffusion dans les sphères matérielle, politique et spirituelle et sur la facilité avec laquelle les élites politiques et la population l’apprennent. Rappelons-nous aussi la célèbre définition qu’Ernest Renan a forgée en 1882 de la nation : « Elle suppose un passé; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est […] est un plébiscite de tous les jours19. » En mettant ensemble Gandhi et Renan, nous pourrions affirmer que la langue nationale est celle que les élites dirigeantes et la population plébiscitent dans la vie de « tous les jours », dans les activités productives, intellectuelles ou spirituelles au sens large – arts, culture, religion. Il est clair qu’indépendamment du statut juridique dont jouit l’anglais au Québec, il y est une langue largement plébiscitée comme langue première ou langue seconde. Mais dire que l’anglais est une langue seconde décrit mal ce qu’elle est devenue pour nombre de Québécois francophones qui la côtoient quotidiennement dans la rue, au travail, dans les commerces, l’entendent sur tous les canaux et réseaux de communications que la technologie invasive de notre époque a inventés et qui la laissent rythmer leurs plaisirs, leurs divertissements, les écouteurs aux oreilles. Elle s’est même insinuée dans leur langue maternelle, pour la « métisser » pour les uns, ou l’abâtardir pour les autres, et une grande partie de leur progéniture porte des prénoms anglais20. Et dépit de tous les efforts déployés pour faire du français la langue normale dans toutes les sphères de l’existence, l’anglais est toujours, et peut-être plus que jamais, langue de prestige, de l’avancement professionnel, du rayonnement à l’étranger, de la célébrité et de la richesse, voire de la reconnaissance par les siens. L’anglais n’est certes pas une langue facile à apprendre, contrairement aux préjugés à ce sujet21, mais la propagande sociologique que diffusent aujourd’hui les médias qui martèlent cette langue partout et à toute occasion fabrique l’impression qu’elle s’assimile aussi facilement qu’on respire de l’oxygène.
Bref, avec le recul, on s’étonne que le Québec ait oublié si vite les recommandations de la commission Gendron. Non qu’il eût fallu les adopter telles quelles, mais elles avaient le mérite de poser des questions fondamentales. Le grand défaut des lois linguistiques adoptées par le Québec est peut-être qu’elles ont entrepris de déclarer le français langue officielle sans aussi affirmer clairement son statut de langue nationale. Le préambule de la Charte de la langue française indique certes que le français exprime l’identité du « peuple québécois » et qu’il a vocation à devenir la « langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires ». Quelques jours avant sa défaite aux élections du 7 avril 2014, la première ministre Pauline Marois avait exprimé le voeu que « le français reprenne toute sa place comme langue nationale du Québec22. » Mais cette déclaration d’intention, implicite dans la charte de 1977, a buté sur la coexistence d’une autre langue, que le régime constitutionnel, les élites politiques et la population traitent à la fois comme langue officielle – qui remplit des « offices » en matière de législation, de justice et de services au public – et comme une langue nationale, largement plébiscitée. Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que les représentants de communautés issues de l’immigration au Québec ont estimé que « le français n’apparaît pas comme la langue nationale. Il est tout au plus la langue de la majorité qu’on peut respecter certes ou celle d’une société distincte, mais non une langue favorisant l’intégration de citoyens de toutes origines23. »
On comprend aisément que les concepteurs de la politique linguistique fédérale au Canada se soient gardés de recourir au concept de langue nationale; c’eût été lancer un débat sur un projet national qu’ils ont préféré esquiver au profit des concepts de bilinguisme et de multiculturalisme. Il leur fallait par-dessous tout ne pas accréditer l’idée qu’il y eût au Canada deux nations possédant chacune leur langue24. Par mimétisme avec la politique fédérale, le Québec a érigé sa politique linguistique sur la base du concept d’officialité ; cependant, son véritable projet, faire du français une langue nationale, vagissant encore dans un certain état d’indéfinition, a reçu des moyens et des attentions somme toute limités.
Et la France à l’ère du globalais?
De prime abord, la France semble encore loin du jour où l’anglais y deviendra langue officielle, puisque dans ses missions régaliennes et ordinaires, l’État français s’exprime essentiellement dans la langue de la république, le français. Si la République a une politique linguistique depuis l’amendement constitutionnel de 1992 et l’adoption en 1994 de la loi relative à la langue française (loi dite Toubon), elle n’a pas senti le besoin de préciser si elle est « officielle » ou « nationale ». Au vrai, le français y est les deux à la fois25. Cependant, on ne peut s’empêcher de se poser la question suivante : l’anglais est-il en train d’y devenir une langue nationale concurrente du français? Au vu des mutations linguistiques qui se manifestent en France, on ne peut exclure une telle possibilité. La France connaît un double processus d’anglicisation : par le haut - c’est-à-dire par l’intégration européenne, relayée par l’État français qui généralise l’apprentissage de l’anglais sur son territoire, dans son système éducatif notamment, et par le bas, grâce au plébiscite spontané de l’anglais comme langue de l’industrie, du commerce, des relations de travail, des communications, du divertissement, de la science, des arts, etc. En peu d’années, de langue étrangère qu’elle était, la langue anglaise est devenue en France une langue seconde universelle, que les élites, et de plus en plus les jeunes générations, se font fort d’apprendre et d’exhiber comme un trophée pour se distinguer et gravir les échelons de l’avancement social.
Un fait important témoigne de l’accélération de ces mutations : la volonté du gouvernement Valls-Hollande, par la voix de sa ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, d’abolir l’enseignement actuel du grec et du latin dans les collèges français – soit les écoles du niveau secondaire – pour les remplacer par des cours allégés de culture de l’antiquité laissés à la discrétion des établissements. La France a longtemps voué un culte aux langues anciennes, ses meilleurs esprits littéraires et scientifiques se sont formés par la voie des humanités gréco-romaines, au sujet desquelles plusieurs de ses savants ont accumulé des trésors d’érudition. Cette fascination française pour les langues anciennes n’obéissait pas uniquement à la soif de connaissance et à l’admiration pour les monuments antiques. C’est au contact intime avec ces langues que la langue française s’est enrichie, s’est redressée en quelque sorte, parce que ses ouvriers la considéraient comme une langue universelle apte à recevoir tous les trésors anciens pour les retraduire, voire les renouveler, dans son génie propre. Dans La défense et illustration de la langue française, Joachin du Bellay, admiratif de la manière dont les Romains avaient jadis cultivé la connaissance du grec pour enrichir le latin, se désolait de voir ses contemporains négliger la culture du français, laissée en friche, « comme une plante sauvage ». Il formula ce voeu, que le français, qui n’avait pas porté encore tous ses fruits, devînt congénial au grec et au latin :
La réforme Vallaud-Belkacem montre qu’une partie déterminante des élites politiques et intellectuelles françaises a cessé de croire dans la capacité universelle d’absorption et d’invention de la langue française, devenue à leurs propres yeux une langue provinciale, ou pour reprendre l’expression de Jürgen Trabant, une « petite langue » prise dans les rets du globalais27. Un peu comme si dans l’espace mental de cette élite, encombré désormais par une nouvelle langue universelle par rapport à laquelle il est intimé à la langue nationale de se définir, il n’y avait plus de place pour ces langues de l’esprit auxquelles naguère le français s’était mesuré pour grandir. En cela, la France deviendra encore plus pareille au Québec, où une belle tradition d’enseignement de ces langues a été liquidée en l’espace d’une génération.
Marc Chevrier
Notes
1 Gouverneur général du Canada, Saisir le moment pour le Canada : Prospérité et opportunité dans un monde incertain, [Notez le gros anglicisme dans le titre], discours du trône, 2e session, 41 législature, Dominion du Canada, 16 octobre 2013, p. 23. Voir : http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/gg/SO1-1-2013-fra.pdf .
2 Lucie Lecomte, « Langues officielles ou langues nationales? Le choix du Canada », Service d’informations et de recherches parlementaires, Bibliothèque du Parlement, Publication No 2014-81-f, 6 février 2015.
3 Rapport de la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques, Livre II, Les droits linguistiques, état du Québec, 1972, p. 78.
4 Ibid., p. 22.
5 Ibid., p. 23.
6 Ibid., p. 70.
7 Opinion de Jean-Charles Bonenfant, « La compétence constitutionnelle et juridique pour instituer une langue ou de langues officielles au Québec », dans le Rapport de la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques, 1972, p. 257-291; opinion de François Chevrette, « La compétence constitutionnelle et juridique pour instituer une langue ou de langues officielles au Québec, p. 293-315. Se fiant à l’exemple du droit suisse, Chevrette écrit dans une note : « Signalons le caractère primordialement symbolique de la notion de langue nationale, qui, à la différence de la notion de langue officielle, ne crée pas de droits linguistiques proprement dits au plan de l’administration publique », p. 314.
8 Cette officialité de la langue française a été réitérée à l’article 8 de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, L.R.Q., chapitre E-20.2, état du Québec.
9 Article 13, Loi sur la langue officielle, 1974, L.Q. chapitre 6, état du Québec.
10 Voir articles 15 et 348 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chapitre S-4.2, état du Québec.
11 Article 8, Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, L.R.Q., chapitre E-20.2, état du Québec.
12 Article 88.1, Charte de la langue française, L.R.Q., chapitre C-11, état du Québec.
13 La commission proposa ce qui suit : « Que les universités soient intégrées à l’Administration, telle que définie à l’annexe de la Charte de la langue française, et qu’ainsi les universités s’approprient d’une manière exemplaire le mandat fondamental de contribuer à la production, à la diffusion et au rayonnement des connaissances en français. » Voir Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, Le français, une langue pour tout le monde, 2001, État du Québec, p. 68.
14 Opinion juridique de Louis M. Bloomfield, « La compétence constitutionnelle et juridique pour instituer une langue ou de langues officielles au Québec », dans le Rapport de la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques, Livre II, Les droits linguistiques, état du Québec, 1972, p. 228.
15 Article 8, constitution de l’Eire, (version française), disponible dans le site de la digithèque MJP : http://mjp.univ-perp.fr/constit/ie1937.htm .
16 Voir article 88, Charte de la langue française, L.R.Q., chapitre c-11, état du Québec, ainsi que la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis, L.R.Q., chapitre 1-14.
17 Circulaire du 12 avril 1994 relative à l'emploi de la langue française par les agents publics, voir le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000363736&categorieLien=cid .
18 Cité par Jean-Charles Bonenfant, « La compétence constitutionnelle et juridique pour instituer une langue ou de langues officielles au Québec », dans le Rapport de la Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques, déjà cité, p. 259. La version originale anglaise de la citation est également disponible dans ce site consacré aux langues en Inde : http://www.languageinindia.com/april2005/earlygandhi1.html .
19 Ernest Renan, Ernest Renan et l’Allemagne, Textes recueillis et commentés par Émile Buré, New York, Brentano's Inc., 1945. p. 195.
20 Sur le franglais parlé au Québec, voir Marc Chevrier, « Les français imaginaires (et le réel anglais) », L’Agora, 10 juin 2010,
http://agora-2.org/francophonie.nsf/Documents/Anglicisme--Les_francais_imaginaires_et_le_reel_franglais_par_Marc_Chevrier, ainsi que le dossier de la revue Argument, Notre avenir sera-t-il franglais ? Revue Argument, vol. 17, no 2, printemps-été 2015, Liber, Montréal, 2015, 216 p.
21 Claude Hagège, Contre la pensée unique, Paris, Odile Jacob, p. 141 et ss.
22 Pauline Marois, « Pour que le français reprenne toute sa place comme langue nationale du Québec », site du Parti québécois, 28 mars 2014, voir : http://pq.org/blogue/pour-que-le-francais-reprenne-toute-sa-place-comme/ .
23 Voir Micheline Labelle, « Pluralisme, intégration et citoyenneté, enjeux sociaux et politique à propos du Québec », In Katia Haddad et Sélim Abou (dir.), Diversité linguistique et culturelle et enjeux du développement. Montréal, Éd. AUPELF-UREF; Beyrouth, Université Saint-Joseph, 1997, p. 21.
24 Des professeurs de droit estiment néanmoins que la distinction langue nationale/langue officielle s’applique bien à la situation canadienne. Voir Norbert Rouland, Stéphane Pierré-Caps et Jacques Poumarède, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 295.
25 Stéphane Pierre-Caps, « Le statut constitutionnel de la langue nationale et/ou officielle : étude de droit comparé », in Anne-Marie Le Pourhiert (dir.), Langue(s) et Constitution(s), Paris, Economica – Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 93-102.
26 Joachim Du Bellay, Les regrets, Gallimard, 1967, p. 208.
27 Jürgen Trabant, « L’antinomie linguistique », dans Michael Werner (dir.), Politiques et usages de la langue en Europe, Édition de la Maison des sciences de l’homme, 2007, p. 69.