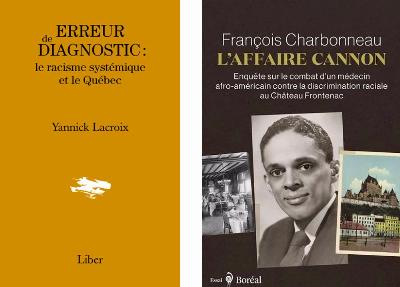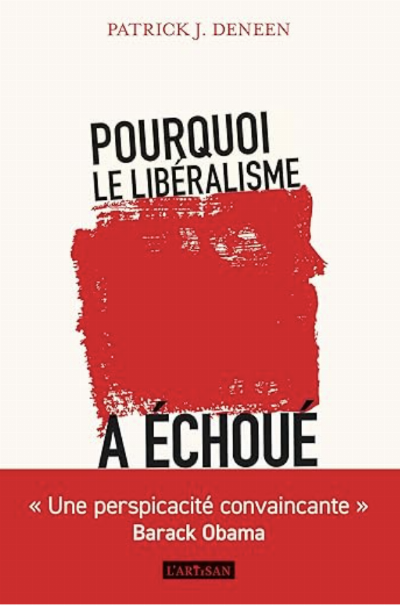Justin Trudeau ou le petit Alcibiade canadien
Il est jeune, il est beau; il a fière allure; par sa prestance fougueuse, où qu’il entre, il ne passe pas inaperçu. Conscient de son pouvoir de séduction, il est l’ami, le gendre, l’amant, le fils idéal des femmes, et le fils, le neveu, le confrère rêvé des hommes, petits et vieux. Il sait se faire remarquer et impressionner le tout-venant par ses extravagances. Il vient d’une noble famille au nom prestigieux, d’où qu’il ait déjà frayé avec les puissants de la cité. Sa bravoure, qui frise l’inconscience, paraît un gage de réussite pour toute nouvelle entreprise. Il ne dédaigne pas les plaisirs de la vie et tendre l’image de l’éternelle jeunesse, à l’ardente spontanéité. Malgré les défauts de son élocution et ses maladresses de langage, il parvient par ses discours et gestes à enthousiasmer les foules. Et surtout, il nourrit de grandes ambitions. Fort de sa parenté avec le plus fameux législateur et stratège de la cité, il compte sur l’aura de son ascendance pour conquérir le pouvoir. Quel est son but ?: convaincre le peuple de lui remettre la suprême magistrature pour remédier aux maux de son temps.
Qui est cet homme?
 Vous avez cru peut-être entrapercevoir le portrait de Justin Trudeau, nouveau premier ministre du Dominion canadien, porté au pouvoir le 19 octobre 2015 après une campagne qui à ses débuts ne laissait guère présager une victoire aussi décisive et dont l’issue a soudain affirmé le caractère dynastique du pouvoir au pays. Mais si nous reculons dans le temps, le type même de cet homme a un illustre prédécesseur, un personnage scandaleux qui intrigua Platon, Xénophon, Plutarque et Andocide, et qui fascine encore, au point qu’on lui consacre toujours essais et romans : Alcibiade, cet enfant terrible des plus nobles familles d’Athènes, ce neveu adoptif célèbre de Périclès, qui fut tout à la fois un aventurier habile, un « dandy flamboyant »1, un hâbleur au patriotisme fluctuant, un général ayant fait faux bond à la cité qui lui avait fait confiance et qui sut néanmoins conserver les faveurs du peuple. Dans Le Banquet, Platon dépeint Alcibiade comme un joyeux noceur, portant une ivresse jubilatoire. Le rhéteur Athénée, dans Les Deipnosophistes, écrit ceci à son propos :
Vous avez cru peut-être entrapercevoir le portrait de Justin Trudeau, nouveau premier ministre du Dominion canadien, porté au pouvoir le 19 octobre 2015 après une campagne qui à ses débuts ne laissait guère présager une victoire aussi décisive et dont l’issue a soudain affirmé le caractère dynastique du pouvoir au pays. Mais si nous reculons dans le temps, le type même de cet homme a un illustre prédécesseur, un personnage scandaleux qui intrigua Platon, Xénophon, Plutarque et Andocide, et qui fascine encore, au point qu’on lui consacre toujours essais et romans : Alcibiade, cet enfant terrible des plus nobles familles d’Athènes, ce neveu adoptif célèbre de Périclès, qui fut tout à la fois un aventurier habile, un « dandy flamboyant »1, un hâbleur au patriotisme fluctuant, un général ayant fait faux bond à la cité qui lui avait fait confiance et qui sut néanmoins conserver les faveurs du peuple. Dans Le Banquet, Platon dépeint Alcibiade comme un joyeux noceur, portant une ivresse jubilatoire. Le rhéteur Athénée, dans Les Deipnosophistes, écrit ceci à son propos :
Dans son Alcibiade, Plutarque note que le jeune homme cultive un grand souci de sa notoriété, qui s’est étendue dans toute la Grèce grâce à ses victoires olympiques aux courses de chars. Pour sa part, Isocrate observe que le courageux jeune homme « ne chercha pas à vivre dans la mollesse tout en s’enorgueillissant des mérites de ses ancêtres : au contraire il fut immédiatement assez ambitieux pour vouloir que ses actions même fissent rappeler les leurs. » Un manuel scolaire français publié en 1914 résume d’un seul trait ce personnage : « Les Athéniens s’engouèrent alors d’un neveu de Périclès, ALCIBIADE, le plus riche et le plus beau des Grecs, que ses excentricités, plus encore que ses qualités, rendirent populaire dans ce peuple de badauds. »2
Mais outre le fait qu’Alcibiade jouait de sa beauté et de ses prouesses physiques pour se mettre en avant et conquérir l’attention du public avec un sens prononcé du théâtre, il incarnait aussi un principe de légitimité étranger à la logique de la démocratie, du moins à la bonne gouverne de la cité. Le pouvoir doit-il nécessairement échoir aux biens nés, héritiers du prestige d’un législateur illustre? D’ailleurs, dans son premier grand dialogue, portant justement le nom de cet être dont l’ambition dévorante semble perturber l’ordre même de la cité – Le Premier Alcibiade –, Platon fit un portrait saisissant de ce descendant des nobles familles des Eupatrides et des Alcméonides. Ainsi Socrate reproche à Alcibiade son indépendance et sa suffisance, comme s’il n’avait besoin du conseil de personne pour réaliser ses ambitions politiques :
En remplaçant dans ce passage le nom de Périclès par celui de Pierre Elliott Trudeau, qui fut au Canada, du moins dans l’imagination de plusieurs, ce que Solon et Périclès furent à Athènes, on obtient un texte qui s’applique assez bien à Justin Trudeau qui, longtemps moqué comme piètre héritier de son père, retourna les avis en sa faveur après avoir remporté un combat de boxe contre un sénateur conservateur disputé à Ottawa en 2012 et dont on tira le documentaire God Save Justin Trudeau. Et même, dans le secourisme planétaire qui semble définir la politique internationale du nouveau premier ministre, prompt notamment à ouvrir les portes du pays aux réfugiés du monde, on croit entendre l’éloge du devoir d’assistance qu’Alcibiade rappela au peuple d’Athènes et dont la cité avait tiré sa force et sa gloire : « Comment donc nous sommes-nous constitué un empire, nous et tous les peuples qui en ont dominé d’autres? N’est-ce pas en nous portant avec empressement au secours de tous ceux, Barbares ou Grecs, qui, successivement, réclamaient notre assistance? »4
Du monarque au dynaste élu
 On ne sait, pour l’heure, si les politiques de Justin Trudeau conduiront le pays au même désastre auquel les expéditions militaires lancées par Alcibiade en Sicile aboutirent au grand dam d’Athènes pendant la guerre du Péloponnèse. Mais le dauphin Trudeau a réussi au moins une première grande entreprise, conquérir le pouvoir, sans s’encombrer du conseil de quelque Socrate, bien que de toute évidence, il ait su s’entourer d’experts de sa génération et de vieux routiers de la politique. Une des premières décisions que le gouvernement de Trudeau fils a prises a été de faire enlever le portrait de la Reine du Canada, Élizabeth II, que le gouvernement précédent avait fait poser au foyer d’entrée de l’édifice du ministère des Affaires étrangères en y délogeant deux tableaux d’Alfred Pellan. On se tromperait à y voir un quelconque signe de républicanisme. En réalité, l’élection d’un des fils de Pierre Elliott Trudeau au poste de premier ministre, coiffé au surplus d’une belle majorité au parlement obtenue du premier coup, revivifie de manière spectaculaire le principe monarchique que les pères fondateurs du Dominion en 1867 avaient érigé en rempart contre les faiblesses supposées de la démocratie et contre l’attraction du modèle américain. Malgré l’intention de ces fondateurs de singer en tout la monarchie britannique dans les institutions canadiennes, un élément essentiel a toujours manqué au rouage monarchique canadien : l’existence d’une véritable dynastie canadienne. Dans un discours prononcé à Halifax en 1864, le baronnet Georges-Étienne Cartier [nous rajoutons un « s » à son prénom qu’il avait voulu angliciser] avait exprimé ce voeu : « Nous croyons que lorsque la confédération sera faite, elle deviendra une vice-royauté, gouvernée, nous avons le droit de l’espérer, par un membre de la famille royale. » Or, comme on le sait, aucun membre de la famille royale britannique ne daigna s’installer à demeure dans les froides étendues de son fidèle Dominion, et pour tout représentant de sa Majesté, le Canada a dû se contenter depuis quelques décennies de roturiers canadiens recrutés parmi les notables et les personnalités médiatiques du pays, telles Adrienne Clarkson et Jean-Louis Roux. L’élection de Justin Trudeau va au-delà des espérances exprimées par Cartier : elle offre sur un plateau d’or la royauté d’un dynaste couronné par le suffrage populaire. Hérédité et démocratie sont réunies d’une certaine façon dans un seul homme, alors que d’ordinaire, les deux sont distinguées par deux personnes différentes dans une monarchie constitutionnelle : un prince règne aux côtés d’un premier ministre élu qui gouverne. D’ailleurs, fait révélateur de la nouvelle ère justinienne, sitôt élu le nouveau premier ministre s’empressa d’aller rendre hommage, flanqué de sa famille au complet, à sa Majesté Élizabeth II à Buckingham, tandis que de l’autre côté de la Manche, la France pleurait les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Un peu comme s’il importait plus que tout au premier ministre fraîchement élu de faire confirmer sa victoire et son ascension dans la cour des grands auprès de la source originelle du principe monarchique et de la faire rejaillir sur ses enfants, pour les ennoblir au contact de Sa Majesté, comme lui-même fut naguère adoubé, en accompagnant son papa Pierre Elliott dans les mêmes salles richement lambrissées.
On ne sait, pour l’heure, si les politiques de Justin Trudeau conduiront le pays au même désastre auquel les expéditions militaires lancées par Alcibiade en Sicile aboutirent au grand dam d’Athènes pendant la guerre du Péloponnèse. Mais le dauphin Trudeau a réussi au moins une première grande entreprise, conquérir le pouvoir, sans s’encombrer du conseil de quelque Socrate, bien que de toute évidence, il ait su s’entourer d’experts de sa génération et de vieux routiers de la politique. Une des premières décisions que le gouvernement de Trudeau fils a prises a été de faire enlever le portrait de la Reine du Canada, Élizabeth II, que le gouvernement précédent avait fait poser au foyer d’entrée de l’édifice du ministère des Affaires étrangères en y délogeant deux tableaux d’Alfred Pellan. On se tromperait à y voir un quelconque signe de républicanisme. En réalité, l’élection d’un des fils de Pierre Elliott Trudeau au poste de premier ministre, coiffé au surplus d’une belle majorité au parlement obtenue du premier coup, revivifie de manière spectaculaire le principe monarchique que les pères fondateurs du Dominion en 1867 avaient érigé en rempart contre les faiblesses supposées de la démocratie et contre l’attraction du modèle américain. Malgré l’intention de ces fondateurs de singer en tout la monarchie britannique dans les institutions canadiennes, un élément essentiel a toujours manqué au rouage monarchique canadien : l’existence d’une véritable dynastie canadienne. Dans un discours prononcé à Halifax en 1864, le baronnet Georges-Étienne Cartier [nous rajoutons un « s » à son prénom qu’il avait voulu angliciser] avait exprimé ce voeu : « Nous croyons que lorsque la confédération sera faite, elle deviendra une vice-royauté, gouvernée, nous avons le droit de l’espérer, par un membre de la famille royale. » Or, comme on le sait, aucun membre de la famille royale britannique ne daigna s’installer à demeure dans les froides étendues de son fidèle Dominion, et pour tout représentant de sa Majesté, le Canada a dû se contenter depuis quelques décennies de roturiers canadiens recrutés parmi les notables et les personnalités médiatiques du pays, telles Adrienne Clarkson et Jean-Louis Roux. L’élection de Justin Trudeau va au-delà des espérances exprimées par Cartier : elle offre sur un plateau d’or la royauté d’un dynaste couronné par le suffrage populaire. Hérédité et démocratie sont réunies d’une certaine façon dans un seul homme, alors que d’ordinaire, les deux sont distinguées par deux personnes différentes dans une monarchie constitutionnelle : un prince règne aux côtés d’un premier ministre élu qui gouverne. D’ailleurs, fait révélateur de la nouvelle ère justinienne, sitôt élu le nouveau premier ministre s’empressa d’aller rendre hommage, flanqué de sa famille au complet, à sa Majesté Élizabeth II à Buckingham, tandis que de l’autre côté de la Manche, la France pleurait les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Un peu comme s’il importait plus que tout au premier ministre fraîchement élu de faire confirmer sa victoire et son ascension dans la cour des grands auprès de la source originelle du principe monarchique et de la faire rejaillir sur ses enfants, pour les ennoblir au contact de Sa Majesté, comme lui-même fut naguère adoubé, en accompagnant son papa Pierre Elliott dans les mêmes salles richement lambrissées.
Or la dimension dynastique de cette élection n’échappa guère aux médias du monde entier, qui virent aussitôt des parallèles avec les Kennedy, Clinton et Bush aux États-Unis, les Nehru-Gandhi en Inde, les Bhutto au Pakistan, et même… les Kim en Corée du Nord5. Le chroniqueur du journal britannique The Guardian, Jonathan Friedland, a su cerner ce qu’il y a de particulier dans cette tendance observable dans plusieurs démocraties à laisser le pouvoir aux mains des membres d’un même clan familial. Toute dynastie au pouvoir est ainsi la promesse d’un « film à succès », si bien que la vie des dynastes les rend comparables à des acteurs d’un film d’Hollywood ou d’un téléroman. Constatant que Justin Trudeau pourrait facilement jouer le rôle de James Bond, il écrit [traduction]: « Là où Bond, Superman et les Transformers sont les titans du cinéma, les Clinton, les Gandhi, les Kenyatta [qui gouvernent au Kenya] et maintenant les Trudeau dominent l’échiquier politique à travers le monde. »6 Mais plus significatif encore, selon Jonathan, les dynasties politiques prospèrent aussi dans les pays dont le principe fondateur a été de rejeter l’hérédité comme principe de qualification au pouvoir, tels les États-Unis dont la constitution rédigée en 1787 interdit au pays de créer tout titre de noblesse. Pour comprendre ce paradoxe, il faut d’abord observer que le phénomène des dynasties politiques ne se limite pas à la tête de l’État, aux postes prestigieux de premier ministre ou de président. Le Royaume-Uni, par exemple, peut donner l’impression d’avoir été épargné par le phénomène, puisqu’aucune dynastie familiale ne semble avoir monopolisé le poste de premier ministre depuis Robert Walpole, ce qui n’a pas empêché plusieurs fils ou frères de premiers ministres d’accéder au cabinet. Ce fut longtemps un trait de la vie parlementaire anglaise que le père qui siégeait à Westminster à titre de Lord voyait son fils remporter un siège aux Communes; tandis que grondait la révolution de 1789 en France, 216 des 658 députés de la Chambre des communes anglaise étaient des fils de Lords héréditaires de la deuxième chambre7. Aujourd’hui encore se distinguent aux Communes britanniques des lignées de députés provenant d’une même famille; dans le parlement actuel, sur les 650 députés de la Chambre des communes, 57 ont un lien de parenté avec un député actuel ou ancien8. Le même phénomène existe dans un pays parlementaire comme la Belgique, qui s’est d’ailleurs accentué au cours des dernières années; ainsi dans la première chambre actuelle du parlement belge, 17% des députés ont un lien de parenté avec un ancien parlementaire9. De ce point de vue, l’élection de Justin Trudeau est doublement dynastique, car il est aussi le petit-fils, par le côté maternel, d’un député fédéral et ministre des pêches, James Sinclair.
La politique dynastique a toujours été un des traits de l’élection des membres du Congrès américain; entre 1789 et 1859, en moyenne 12% d’entre eux possédaient un lien de parenté avec un ancien congressiste; même si cette proportion a baissé à 6% après 1966, il demeure que plus un membre du Congrès se maintient longtemps au pouvoir, plus il y a probabilité qu’un de ses enfants lui succède10. Un économiste américain a même calculé que le fils d’un sénateur a 8500 fois plus de chances d’accéder au poste de son père que tout autre Américain11. Outre l’aspect statistique du phénomène des dynasties politiques, certains théoriciens du pouvoir ont postulé une « loi » des sociétés et des organisations, qui tendraient toutes à l’oligarchie, le pouvoir, même en démocratie, finissant toujours par tomber dans les mains d’une petite élite. Ainsi pour le sociologue Gaetano Mosca,[traduction] « toutes les classes politiques ont tendance à devenir, en fait, sinon en droit, héréditaires12. »
La dimension dynastique du pouvoir qui semble ainsi s’incruster dans plusieurs démocraties contemporaines s’ajoute aux nombreux autres facteurs connus qui favorisent certaines classes de la société aux postes de pouvoir, tels la fortune, l’éducation et le titre professionnel. Pour le théoricien de la démocratie représentative Bernard Manin, la procédure du vote est intrinsèquement aristocratique, ce qu’avaient parfaitement compris Aristote et Montesquieu, en ce qu’elle suppose une dynamique de choix par laquelle l’électeur doit accorder son suffrage à la personne qui lui semble être le meilleur candidat, en se déterminant sur des critères et des préférences subjectifs13. Sont ainsi favorisés dans la course électorale les candidats qui réussissent, par la notoriété qui les précède et par certains traits saillants de leur personnalité, de leur apparence physique ou de leur histoire familiale, à capter l’attention des électeurs. Qui plus est, en prolongeant les observations de Manin, on pourrait soutenir que la démocratie élective entretient un paradoxe permanent : elle repose sur la liberté accordée à tout électeur de se déterminer dans son choix sur des critères non-démocratiques, de telle sorte qu’il lui est toujours loisible de préférer aux postes névralgiques du pouvoir les descendants de familles gouvernantes, d’accorder en somme, un prix plus grand à l’hérédité qu’à la stricte égalité démocratique. En ce sens, il est sans doute vrai que les monarchies de droit divin ont vécu en Occident et ne fournissent plus de titre de légitimité crédible aux yeux des Modernes14; mais l’hérédité continue, sous des formes renaissantes, à concurrencer le principe démocratique comme principe de légitimité.
Aristote était particulièrement sensible au fait que l’irruption d’une dynamique dynastique dans une démocratie est la marque d’une évolution vers l’oligarchie. Dans ses Politiques, on trouve plusieurs passages où le remplacement du père par le fils au pouvoir définit l’une des formes possibles de l’oligarchie. La succession de père à fils est même pour lui une forme aggravée d’oligarchie15. Il écrit notamment : « Quand aussi ceux qui délibèrent souverainement se choisissent eux-mêmes entre eux, que le fils succède à son père et qu’ils sont souverains sur les lois, une telle organisation est nécessairement oligarchique. »16 Fort de sa majorité au parlement fédéral, Justin Trudeau, qui n’a certes pas succédé immédiatement à son père, mais en différé, se trouve néanmoins à prendre le contrôle de l’agenda législatif du parlement, c’est lui qui, de facto, exerce la souveraineté législative. Dans La Rhétorique, Aristote écrit que l’oligarchie est le régime « où l’autorité dépend de la fortune »17; or, chez lui, la « bonne fortune » inclut tous les biens qui ont une cause fortuite, qui ne résultent pas de l’art humain, comme la beauté physique18. On comprend dès lors, suivant Aristote, que Justin Trudeau cumule deux « biens » de nature oligarchique, la renommée familiale et un physique avantageux.
En cela, le fils Trudeau n’est pas très différent du père, qui avait remporté les élections fédérales de 1968 après avoir suscité autour de sa personne une « trudeaumanie », qui attestait sa capacité à fasciner les médias et à hystériser les foules par ses excentricités, sa désinvolture et sa relative jeunesse. Bref, le père aussi a joué l’Alcibiade. À cela s’ajoute le fait plus significatif encore que la pensée de Pierre Elliott Trudeau s’est nourrie d’un défenseur déclaré de la supériorité des aristocraties sur les démocraties, c’est-à-dire Lord Acton, ce penseur libéral anglais qui vécut pendant les deux derniers tiers du XIXe siècle. Un fin interprète de Lord Acton, le sociologue Hubert Guindon, nous éclaire sur l’engouement d’Acton pour l’aristocratie : « il acquiesçait à la théorie à la mode dans les rangs de l’aristocratie française, qui se prétendait issue d’une race supérieure d’origine étrangère, dont la légitimité se fondait sur la conquête et dont le droit de gouverner se fondait sur la descendance. »19 Il serait sans doute abusif de croire que Pierre Elliott Trudeau eût pu adhérer aux idées du comte de Boulainvilliers, qui professa au XVIIIe siècle une telle théorie, mais il y avait indéniablement dans la vision trudeauiste de la démocratie représentative et du fédéralisme des éléments de parenté avec les écrits d’Acton d’où il a puisé plusieurs de ses arguments contre le nationalisme québécois20.
Par-delà les inclinations aristocratiques du père Trudeau, on peut se demander si l’élection de son fils n’est pas symptomatique d’une mutation sociologique qui affecte les deux nations du Dominion. Dans un texte incisif publié en 2009 dans La Presse, le sociologue Stéphane Kelly se demandait si l’élite québécoise n’était pas en train de se réconcilier « avec un vieux principe réactionnaire : l’hérédité. » Accréditait à ses yeux cet engouement pour l’hérédité le fait que les médias s’émerveillaient des prouesses artistiques ou sportives des rejetons de vedettes déjà connues. Il écrit : « Une petite coterie de soixante-huitards québécois, puissante dans les médias de masse, s'entiche des enfants de l'élite. Les critères d'excellence sont jugés dépassés. Qu'importe le talent, ce qu'il faut c'est un nom, un patronyme célèbre. Les productions québécoises sont ainsi encombrées de fils et filles de vedettes ou de semi-vedettes, bref de gens qui ont un nom. Avec les années, le cercle des élus devient de plus en plus fermé. »21 Il soutient que dans son passé, le Québec, gouverné de facto par quelques grandes familles (jadis les Taschereau, aujourd’hui les Bombardier, Desmarais, Johnson et Péladeau), adhérait plutôt à un éthos aristocratique, plus enclin à vénérer les privilèges des héritiers qu’à suivre les exigences de la méritocratie. Mais au vu du tournant dynastique qu’a pris depuis octobre 2015 la politique canadienne, on ne peut exclure la résurgence d’un tel ethos aristocratique dans l’ensemble du Canada. Par ailleurs, les analyses de l’économiste Thomas Piketty sur le capitalisme suggèrent qu’en renouant avec les niveaux de concentration du capital qui ont existé à la belle époque en Europe, l’Occident risque de voir renaître une mentalité d’héritiers qui, ainsi que Balzac et Jane Austen les avaient portraiturés dans leurs romans, préfèrent au mérite personnel l’espérance d’un bel héritage ou d’un bon mariage pour se faire une situation.
De la noblesse à la tyrannie du beau
La beauté, comme l’hérédité familiale, sont des éléments de la « fortune » qui peuvent tracer la voie vers le pouvoir. La correspondante de Libération à Montréal, Anabelle Nicoud, présenta en ces termes la victoire électorale de Justin Trudeau : « Il est beau, il est jeune, et il vient de remporter une victoire historique aux élections législatives canadiennes. »22 L’enthousiasme que la presse a manifesté à l’égard du physique avantageux du gagnant des élections n’est pas fortuit, puisque Justin Trudeau doit sa victoire en partie au style de sa communication politique, consistant à mettre en évidence son rapport décomplexé vis-à-vis son propre corps et l’expression de ses émotions, en exploitant tour à tour plusieurs registres, celui du boxeur courageux qui bombe son torse nu devant les caméras, celui du comédien provocateur qui enlève sa chemise et roule ses muscles sur la scène, celui de la vedette qui pose, avec sa femme, dans une magazine de mode qui le sacre homme « le plus sexy » pour le public américain. L’usage frénétique que Trudeau a fait du telego – une meilleure traduction du terme « selfie » que le terme « egoportrait » – pour mousser sa candidature est en cela révélateur. Distribuer son visage en grand seigneur, telle une profusion de petits pains, dénote à la fois une absence de pudeur prononcée vis-à-vis soi et la volonté de séduire autrui par un face à face imaginaire faisant illusion auprès du récepteur de l’image. C’est jouer le « miracle » du corps instantané, immédiatement préhensible et disponible à autrui, par l’illusion de la présence du corps du chef politique disséminé dans les réseaux sociaux ardents où les frontières entre le public et le privé sont abolies.
Justin Trudeau n’est certes pas le seul homme politique à miser sur son apparence physique pour flatter l’électorat. En décembre 2008, le président Barack Obama, s’est fait prendre en photo torse nu sur une plage hawaïenne, comme s’il fallait rassurer les Américains sur la stature athlétique de leur président. En Espagne, on a vu un jeune politicien, Albert Rivera, créer à partir de rien un nouveau parti politique, Ciudadanos, en misant notamment sur son physique de gendre idéal; en 2006, il osa même poser nu sur une affiche portant le slogan « Sòlo nos importan las personas » – seules nous importent les personnes. Le président Poutine s’est également livré en 2010 au jeu de la séduction par une propagande soigneusement conçue, qui le montre torse nu sur son cheval en Sibérie ou brandissant une canne à pêche ou un fusil de chasse. L’époque où seules les femmes semblaient avoir le privilège – ou le fardeau – d’user de leurs attraits physiques pour se tailler une situation en société semble bien révolue.
Or, faire le beau, quand on y songe, est une vieille stratégie virile de conquête du pouvoir. Les Grecs en avaient une vive conscience. L’art grec a fixé un idéal de la beauté masculine, s’exprimant dans la nudité d’un corps jeune et athlétique, qui convient à la représentation, dans la sculpture et la peinture, d’aussi bien les dieux que les hommes mortels, mis sur un pied d’égalité sous leur rapport de leur incarnation charnelle. Mais le culte de la beauté masculine ne servait pas que l’esthétisme. Celle-ci recelait aussi une dimension sociale et morale, puisque « les Grecs voient volontiers un rapport entre beauté physique et qualités morales, entre éducation et beauté. »23 Dans la poésie grecque, la beauté, avec la force et la maîtrise de soi, est souvent un signe de noblesse et la marque de la supériorité d’un futur dynaste.24 La beauté est l’un des éléments constitutifs de la noblesse écrit Aristote dans la Rhétorique25. Dans Le Banquet, Xénophon écrit : « la beauté est par essence quelque chose de royal, surtout quand elle est jointe à la pudeur et à la continence. »26 C’est d’ailleurs dans Le Banquet du même auteur que s’ouvre une discussion intéressante pour notre propos. Réunis par le riche Callias dans sa somptueuse demeure, des convives, dont Socrate, se mettent à deviser sur la qualité personnelle dont chacun est le plus fier. Mais la discussion tourne vite en dialogue entre Socrate et les autres convives sur les qualités d’un bon citoyen. L’un des convives, Critobule, particulièrement imbu de son physique, déclare sans ambages que ce dont il est le plus fier est sa beauté. Il déclare : « En tout cas, je jure par tous les dieux que je n’échangerais pas ma beauté contre le pouvoir du Grand Roi. Celui qui est fort doit se procurer des biens en peinant, celui qui est courageux en prenant des risques, celui qui est intelligent en faisant des discours, mais celui qui est beau peut obtenir tout cela en ne faisant rien. »27 Bien que cette déclaration surprenante puisse être interprétée comme une provocation ou une blague, Xénophon révèle la nature problématique, sinon profondément injuste, du primat accordé à la beauté, quand par celle-ci on finit par obtenir des faveurs, des biens, voire du pouvoir en écartant tous les autres critères d’excellence humaine. Succomber à la beauté d’un être, dès que l’on sort du jardin de l’amour et des sentiers de l’art, c’est renoncer à l’usage de la raison. La royauté du beau peut ainsi dégénérer en tyrannie. Quelques siècles plus tard, cette même critique de la beauté s’exprime dans les Pensées de Pascal : « La tyrannie consiste au désir de domination, universelle et hors de son ordre. Diverses chambres, de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux, dont chacun règne chez soi, non ailleurs… La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu’on ne peut avoir que par une autre. »28 Pascal visait sans doute dans cette pensée les fiers et les beaux de l’aristocratie et du clergé de son époque qui se pavanaient emperruqués et dans leurs somptueux accoutrements. Pour Pascal les « beautés » qu’on établit dans les moeurs et les usages ont pour cause la faiblesse humaine.29
L’adoubement politique par le tournoi sportif
Outre son apparence de vedette de cinéma, Justin Trudeau a joué une autre carte du répertoire viril : la force et la bravoure. Le combat qu’il a livré en 2012, officiellement à des fins caritatives, contre un jeune sénateur conservateur, réputé connaître les arts martiaux, tenait de la gageure et a donné à sa campagne au sein du parti libéral pour en gagner la direction un élan décisif. Symboliquement, ce combat confrontait le patricien débonnaire descendu dans l’arène au roturier algonquin au parcours difficile élevé à la fonction législative. L’événement a régalé les médias de tous genres et contribué à donner à la candidature de Trudeau un tour chevaleresque, comme s’il avait remporté un tournoi devant public et arbitre. Or, il est intéressant que Trudeau ait recouru à un tel stratagème, qui était certes risqué pour sa carrière future. Ce combat nous rappelle l’intimité originelle du politique et du sport, que nous avons oubliée. Cet aspect occulté de l’histoire du sport est rappelé et documenté dans une belle étude d’un historien médiéviste, Sébastien Nadot, qui soutient une thèse contraire à l’avis dominant des savants qui situent la naissance du sport, « codifié et réglementé » comme il se pratique aujourd’hui dans l’Angleterre du XIXe siècle, non sans quelque emprunt à l’Antiquité30. Or, selon l’historien, le sport moderne entretiendrait une étroite filiation avec les pratiques physiques de la fin du moyen âge, courses, tournois, jeux d’exercices, et autres types de pas d’armes. Loin de constituer de simples divertissements, ces pratiques nécessitaient un entraînement physique exigeant, une grande maîtrise du maniement des armes, et obéissaient à des règles codifiées appliquées par des arbitres. Longtemps annoncées à l’avance, ces joutes offraient de véritables spectacles, fort courus, auxquels prenaient part eux-mêmes les princes et les seigneurs, comme les chevaliers de plus modeste naissance qui n’étaient insensibles ni à la gloire, ni à l’appât du gain. L’habilité aux jeux était un signe de noblesse que petits et grands seigneurs s’employaient à montrer avec zèle. Une joute médiévale pouvait décider de l’ascension sociale d’un prétendant, dénouer un conflit politique entre deux grands seigneurs, comme grandir le prestige de ses commanditaires. Et parmi les jouteurs se distinguaient les amateurs des professionnels. On comprend dès lors que le détour que Justin Trudeau emprunta par un combat de boxe pour mousser ses ambitions politiques s’accordait parfaitement avec cet esprit féodal de la joute qui mêlait spectacle, mise en jeu physique de soi-même et conquête du pouvoir. D’autres leaders que Justin Trudeau ont mélangé sport et politique à leur manière, tels Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi, qui aimaient bien comparer leur art de gouverner à la compétition sportive, mettre en scène leur propre capacité sportive et cultiver leurs liens avec le sport professionnel31. Et bien avant Poutine et Sarkozy, Pierre Elliott Trudeau lui-même sut donner en spectacle son propre corps de sportif polyvalent au grand plaisir de la presse : skieur, nageur, plongeur acrobatique, coureur automobile et judoka.
La propagande à l’âge des médias de masse réticulaires.
Faire parler de soi par les médias sociaux est devenu semble-t-il la priorité des hommes et femmes politiques d’aujourd’hui, puisque la nouvelle n’est plus le monopole des médias de masse classiques, tels la télévision, la radio et la presse écrite. Les premiers auraient des vertus que les deuxièmes n’auraient pas, et seraient plus propices, selon une opinion répandue, à la diffusion décentralisée de l’information. Mais quoi qu’on pense de ces vertus, les réseaux sociaux demeurent pour l’essentiel des médias de masse, qui rejoignent aussi de vastes publics et ne sont pas moins susceptibles de véhiculer toutes les formes imaginables de propagande, et souvent sans les sauvegardes que procurent les médias traditionnels.
Pour comprendre les formes nouvelles de propagande, il est utile de revenir à un classique sur la question, l’ouvrage de Serge Tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique, paru pour la première fois en 1939 et que l’auteur dédie à I.P. Pavlov et H.G. Wells. L’auteur y consacre l’essentiel de ses analyses à l’étude de la propagande à travers l’histoire, jusqu’aux régimes autoritaires du XXe siècle. Dans son chapitre final, intitulé « La construction de l’avenir », Tchakhotine esquisse ce qui devrait être la propagande des régimes démocratiques au lendemain des désastres de la Deuxième Guerre mondiale, au nom d’un optimisme actif dont l’ambition est de faire advenir un Homme nouveau qui aurait dompté ses passions destructrices et qui serait exempt des « viols psychiques » qu’avaient perpétrés les régimes autoritaires. Voyant déjà se dessiner les promesses et les dangers de « machinocratie » que la cybernétique contient, Tchakhotine croit néanmoins nécessaire que les régimes démocratiques entreprennent d’éduquer leurs populations par le recours généralisé à ce qu’il appelle la « propagande progressiste » ou « antiguerrière », qui prendrait en charge les « magasins cérébraux » afin d’inculquer à l’ensemble des individus une morale pacifiste et conforme à l’éthique des droits de l’Homme. Cette propagande s’appuierait sur la promotion d’une pédagogie nouvelle inspirée de Rousseau, Montaigne, Montessori et Ferrière, qu’il dénomme la pédagogie active, « qui préserve et cherche à faire épanouir l’individualité de l’enfant, à la différence de l’école traditionnelle qui tend à l’étouffer, à conformiser les jeunes et à en faire, à l’état adulte, des « robots », qui subissent avec facilité le viol psychique. »32
Selon l’auteur, il existe deux types de propagande, par persuasion ou par suggestion. Mais écrit-il, « ce qui est d’importance très grande et qui manque presque totalement dans tous les pays démocratiques, c’est la propagande massive du type suggestif émotionnel, s’adressant aux grandes masses. »33 Une telle propagande émotive ne peut atteindre à l’efficacité selon l’auteur que par la création de mythes. Deux mythes s’imposent à la doctrine progressiste : « le mythe de la liberté, associée au progrès », puis le « mythe du Monde Uni, le mythe supranational. » Cette nouvelle propagande progressiste et émotionnelle ne doit pas se contenter de viser les lieux politiques par des moyens classiques. Pour répondre au désir pressant de la population de participer plus activement à la démocratie, il faut inventer de nouveaux rites démocratiques. Ainsi, écrit l’auteur : « [r]éunion de masses, fêtes et jeux, tendent à constituer une sorte de liturgie, dont les jeunes sentent l’exigence. »34 L’organisation de la « propagande émotive populaire » doit prendre garde à modérer la satire et l’ironie, de même qu’à susciter l’enthousiasme. Mais au contraire de la propagande classique, qui assène des slogans uniformes à de vastes publics, cette nouvelle propagande adapte son message à des auditoires plus restreints, et mieux ciblés à l’aide des sondages. Il écrit :
Tchakhotine écrivait ces lignes à une époque où la science informatique en était encore à ses balbutiements. Or, les réseaux sociaux remplissent parfaitement les fonctions qu’il assignait à la « propagande progressiste ». Les partisans de ces réseaux y reconnaissent le nouveau Temple de la liberté où l’individu trouve refuge contre les dominations et les censures de la société, selon une loi inexorable du progrès qui suivrait les avancées techniques de l’informatique et de l’ingénierie. De plus, ces réseaux réaliseraient le rêve d’une humanité délivrée des frontières nationales et politiques, car enfin, par des communions spontanées en ligne, les hommes pourront communiquer entre eux sans filtre, sans égard aux barrières spatio-temporelles ou culturelles, grâce à un réseau planétaire où tout le savoir du monde devient à portée de clic sous le magistère d’une langue, l’anglais, qui devient la lingua franca naturelle de l’humanité, comme par enchantement. De plus, en pénétrant les cercles restreints de la société avec une finessemicro-sociologique, ils satisfont ce besoin de fêtes, de jeux et de rites de participation qu’a évoqué Tchakhotine et qui trouve dans les télégos, les vidéos versés sur Youtube, les achats, les conversations, les sondages, les dragues et les jeux en ligne un exutoire renouvelé jour après jour, minute après minute.
En ce sens, on voit également que Justin Trudeau est passé maître dans l’art de cette propagande émotive, qui exige de l’homme politique qu’il sache profiter de la moindre occasion pour se mettre en scène en entretenant l’illusion d’une proximité spontanée et désinhibée avec ses électeurs et électrices. De plus, cette propagande réticulaire épouse merveilleusement bien les mythes à la base du Canada que son père a voulu édifier, celui de la Liberté, dont le pays par sa Charte constitutionnalisée en 1982 serait devenu la plus parfaite expression, et celui du Suprational, puisqu’ayant neutralisé les tendances mortifères du nationalisme – imputables selon Trudeau père essentiellement au Canada français incivique et immoral et non à l’impérialisme britannique –, le Canada promet de dépasser la Nation par son multiculturalisme devant réconcilier toutes les différences dans une grande harmonie sociale ouverte généreusement sur un Monde unifié. Il est significatif de constater que peu après son élection, le nouveau premier ministre ait senti le besoin de poser avec des enfants malades pour assister à la première canadienne de la dernière édition de Star Wars dont il se passionne lui-même depuis son enfance. C’est, de la part d’un premier ministre, une belle façon implicite de dire, avec un sourire juvénile, que branché au cinéma hollywoodien, le Canada n’a pas de culture propre. Justin Trudeau sera-t-il indifférent à cette culture comme Alcibiade fut jadis le « beau fossoyeur d’Athènes »36?
Si nous retournons au dialogue Alcibiade de Platon, qui fut en quelque sorte fondateur de la philosophie, nous sommes à même de mieux cerner la tâche première qui lui incombe, soit, selon un interprète de ce dialogue, « la lutte contre l’idole de la toute-puissance »37. Au fond, l’enjeu de ce dialogue est de savoir comment la philosophie peut arraisonner le désir de puissance d’un jeune patricien fantasque. Savoir résister à la séduction des beaux est peut-être l’antique projet de la philosophie.
Annexe
Alcibiade, un personnage historique d'une brûlante actualité
« On peut même dire que la vie d’Alcibiade a ouvert, dès le Ve siècle, deux problèmes de politique, qui sont encore d’actualité aujourd’hui.
D’abord, il a incarné l’impérialisme athénien, dans sa forme extrême et conquérante, et dans les imprudences qui menèrent à sa ruine. Toute réflexion sur l’esprit de conquête gagne donc à méditer sur son exemple, qu’éclairent, à cet égard, les analyses de Thucydide.
D’autre part, il a incarné, et poussé à l’extrême, l’image des ambitions personnelles prenant le pas sur l’intérêt commun. Il a, en cela, illustré l’analyse de Thucydide, montrant comment les successeurs de Périclès, faute de s’imposer par leurs mérites comme il l’avait fait, furent amenés à flatter le peuple et à recourir aux intrigues personnelles, néfastes pour la collectivité. Toute réflexion sur les problèmes de la démocratie en général gagne donc à se pencher sur les rocambolesques aventures d’Alcibiade, éclairées, ici encore, par les analyses de Thucydide ou des philosophes du IVe siècle.
Alcibiade est un cas unique et qui sort de l’ordinaire : il est aussi un exemple type, qui peut servir, à chaque instant, de vivante leçon.
Sans doute est-ce pour cela que l’on rencontre si souvent des ressemblances de détail avec l’actualité de notre temps. Dans la vie d’Alcibiade, on rencontre l’ambition, les luttes pour le pouvoir; on rencontre les victoires sportives contribuant à la popularité des chefs, mais entraînant des procès d’ordre financier. On rencontre des « affaires », où tous les grands semblent soudain compromis. On rencontre des revirements populaires, d’un sens dans l’autre. À certains moments, on a presque l’impression que le texte célèbre dans lequel Thucydide oppose Périclès à ses successeurs pourrait s’appliquer aux successeurs du général de Gaulle, opposés à lui.
Certes, il faut se garder des identifications, toujours fausses. Mais on sent un intérêt accru à cette vie d’Alcibiade quand on mesure qu’elle correspond à une crise qui nous la rend par moments très proche. »
Jacqueline de Romilly, Alcibiade, Paris, Éditions Tallandier, 2008, extrait tiré de la préface, pages 10 et 11.
Notes
1 Claude Dupont, La véritable histoire d’Alcibiade, Paris, Les belles lettres, 2009, p. 7. Les citations d’Athénée, de Plutarque et d’Isocrate qui suivent sont extraites de cet ouvrage.
2 Cité dans Antonin Fabre, Alcibiade, cousin de Périclès, Paris, Éditions Magnard, 1967, p. 6.
3 Platon, Second Alcibiade, Hippias Mineur, Premier Alcibiade, etc., traduction d’Émile Chambry, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, p. 101-102.
4 Thucydide, La guerre du Péloponnèse, traduit par Denis Roussel, tome 2, coll. « Le livre de poche », Paris, Gallimard, 1964, Livre VI, 18, p. 153.
5 Voir Laurent Telo, « Quand la politique devient une histoire de famille », Le Monde, 30 octobre 2015, http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2015/10/30/quand-la-politique-devient-une-histoire-de-famille_4800223_4497271.html .
12
6 Jonathan Friedland, « Trudeau, Clinton, Bush…dynasties are the blockbuster movies of politics », The Guardian, 23 octobre 2015, http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/23/trudeau-clinton-bush-dynasties-blockbuster-movies-politics .
7 Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, Presses universitaires de France, 2004, p. 457.
8 “The Power of families”, The Economist, 18 avril 2015, http://www.economist.com/news/leaders/21648639-enduring-power-families-business-and-politics-should-trouble-believers . Pour une analyse plus savante du phénomène au Royaume-Uni et en Belgique, voir Brenda Von Coppenolle, Political Dynasties and Elections, Thèse, département de méthodologie, London School of Economics, janvier 2014, 114 p., http://etheses.lse.ac.uk/883/1/__lse.ac.uk_storage_library_secondary_libfile_shared_repository_etheses_content_theses%20submitted%20by%20students%20%26%20alumni_live%20theses_van%20coppenolle_political%20dynasties_2014.pdf .
9 Jeroen Zuallaert, “Dynastie politique : un phénomène qui touche surtout la Belgique », Le Vif, 21 août 2015, http://www.levif.be/actualite/belgique/dynastie-politique-un-phenomene-qui-touche-surtout-la-belgique/article-opinion-411725.html .
10 Voir Ernesto Dal Bò, Pedro Dal Bò, Jason Snyder, “Political Dynasties”, Working paper 13122, National Bureau of Economic Research, mai 2007, http://www.nber.org/papers/w13122.pdf ; voir aussi Leonid Bershidky,”What’s wrong with political dynasties”, Bloombergview, 16 juin 2015, http://www.bloombergview.com/articles/2015-06-16/what-s-wrong-with-political-dynasties .
11 Seth Stephen-Dadowitz, « Just how despotic are we? », The New York Times, 21 mars 2015, http://www.nytimes.com/2015/03/22/opinion/sunday/seth-stephens-davidowitz-just-how-nepotistic-are-we.html .
12 Gaetano Mosca, Elementi de scienza politica, édition électronique, p. 109, http://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/mosca/elementi_di_scienza_politica/pdf/mosca_elementi_di_scienza_politica.pdf .
13 Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
14 Sur la délégitimation des monarchies de droit divin, Mattei Dogani, « La Légitimité politique : nouveauté des critères, anachronisme des théories classiques », Revue internationale des sciences sociales, 2010 /2, no 196, 21-39.
15 Aristote, Les Politiques, Paris, Garnier-Flammarion, 1990, IV, 6, 1293-a, p. 300. Voir aussi IV, 5, 1292-a « une autre espèce d’oligarchie fait qu’un enfant remplace son père ».
16 Ibid., IV, 14, 1298-b.
17 Aristote, Rhétorique, Paris, Le livre de Poche, 1991. 1, VIII, IV, 1365b, p. 126.
18 Ibid., V, XVII, 1362a.
19 Hubert Guindon, « Nationalisme et totalitarisme : un réexamen », dans Daniel Dagenais (dir.), Hannah Arendt, Le totalitarisme et le monde contemporain, Québec, Presses universitaires Laval, 2003, p. 123.
20 Voir, outre l’ouvrage de Stéphane Kelly, Les fins du Canada, Montréal, Boréal, p. 198-202, 2001, Simon Couillard « Lord Acton et le nationalisme impérial du ROC », Le Devoir, 26 septembre 2015.
21 Stéphane Kelly, « L’invasion des héritiers », La Presse, 23 mai 2009, http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/200905/23/01-859246-linvasion-des-heritiers.php .
22 Anabelle Nicoud, « Canada : Comment Justin Trudeau s’est fait un prénom », Libération, 20 octobre 2015, http://www.liberation.fr/planete/2015/10/20/avec-justin-trudeau-une-touche-de-glamour-a-la-tete-du-canada_1407588 .
23 Maurice Sartre, Virilités grecques, dans Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire de la virilité, tome 1, Paris, Seuil, 2011, p. 40.
24 Ivana Savali, « L’idéologie dynastique des poèmes grecs de Xanthos », L’antiquité classique, 1988. Vol. 57, no 1, p. 102-123. http://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1988_num_57_1_2230 .
25 Rhétorique, 1, V, IV, 1360 b.
26 Xénophon, L’Anabase, Le Banquet, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, chapitre 1, 8.
27 Cité dans Jean-Pierre Guglielmi, Le Grec Ancien, coll. Sans Peine, Chennevières-Sur-Marne, Assimil, 2003, p. 94.
28 Pascal, Pensées, Paris, Le livre de poche, 1972, no 332.
29 Ibid., pensée 329.
13
30 Sébastien Nadot, Le Spectacle des joutes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.
31 Pierre Musso, Sarkoberlusconisme la crise finale?, Paris, Éditions de l’Aube, 2001, p. 87-90.
32 Serge Tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique, Paris, Gallimard, 1952, p. 526.
33 Ibid., p. 541.
34 Ibid., p. 543.
35 Ibid., p. 547.
36 Antoine Robitaille, « Alcibiade ou le beau fossoyeur d’Athènes », Compte rendu de: «Alcibiade ou les dangers de l'ambition», Jacqueline de Romilly, Éditions de Fallois, Paris, 1995, 282 pages, publié dans Le Devoir, 16 février 1996.
37 Gilles Hanus, « Préface », dans Benny Levy, L’Alcibiade. Introduction à la lecture de Platon, Paris, Verdier, 2013, p. 10.