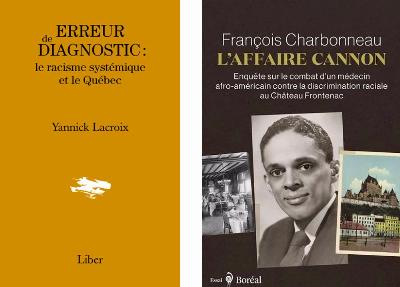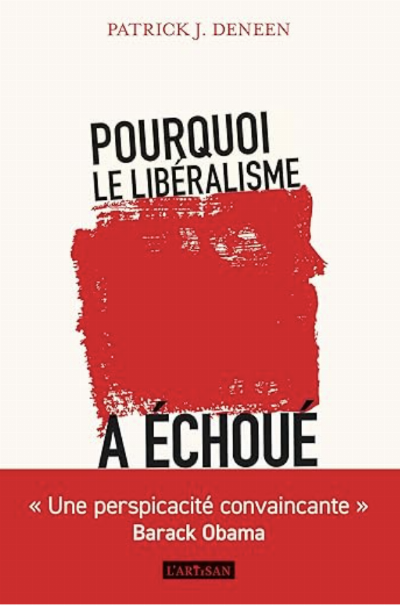La santé du système
Le dernier film du réalisateur français Michel Deville, Les confessions du docteur Sachs, brosse un portrait sans complaisance de la médecine telle qu'elle se pratique en France hors des grands centres. Conçu d'après le roman de Martin Winckler La maladie de Sachs (1), ce film décrit la vie d'un jeune généraliste célibataire fraîchement installé dans une petite ville de province qui, sans être déserte, demeure peuplée de solitude. Défilent dans le cabinet du docteur Sachs des patients qui lui confient leurs souffrances – souffrances réelles, somatiques ou parfois feintes. Au beau milieu de la nuit, Sachs roule vers une lointaine maison où l’on réclame son aide. Sachs accorde à chacun de ses patients une attention qui confine à la compassion. Un homme est affligé de la perte de sa femme morte du cancer, et Sachs sait écouter le récit des derniers moments de la défunte; contre la volonté de sa mère, une femme veut faire interner son frère handicapé, et Sachs lui tient tête; une autre entre dans son cabinet pour lui dire la difficulté d’aimer un homme marié, et le docteur lui prête une oreille intelligente. Le soir, le docteur Sachs reprend ses esprits par l’écriture. Plus un écrivant qu’un écrivain, le docteur Sachs consigne sur papier tout ce dont il a été le témoin et qui trouble sa conscience. À ce rythme, en recueillant la souffrance d’autrui, Sachs s’est créé sa propre maladie, qu’exacerbent sa révolte contre l’arrogance du savoir médical et le sentiment de son insuffisance. Bref, le docteur Sachs est tout le contraire du médecin dont l’humanité s’est blindée d’une carapace de science exacte.
Sans être un chef-d’œuvre, le film de Deville, qui a ses longueurs et qui s’encombre d’une musique baroque comme trame sonore, a néanmoins le mérite de soulever, ne serait-ce qu’en filigrane, la problématique du bien. Comme l’écrivait récemment Pierre Vadeboncoeur dans son admirable essai L’humanité improvisée (2): «Il y a une problématique du bien. Il n’y a pas de problématique du mal ». Quiconque travaille dans un système peut oublier qu’il est un agent libre capable de conscience et d’action volontaire et se persuader que son pouvoir se réduit à ce que les routines, les règles et la pesanteur des relations interpersonnelles ont défini pour lui. Dans ce contexte, le mal se fait tout seul, prenant souvent le masque de la banalité et de la normalité. Rien n’est plus difficile pour un médecin que de sortir de son rôle de pourvoyeur de services qu’exigent de lui, d’un côté la bureaucratie de l’État et de l’autre des patients qui voient en lui un guérisseur de l’âme, un confesseur ou un complice de petites combines. Faire le bien dans l’exercice de son métier, c’est une entreprise périlleuse, surtout quand c’est sa réputation que l’on risque et qu’on doit affronter sur son chemin des arrogants, des cupides et des sans-cœur qui se contentent d’appliquer les procédures établies. Le docteur Sachs est au fond un homme hanté par le bien qui ne veut pas se contenter d’administrer des soins. Par pure compassion à l’égard des femmes qu’il venait d’avorter, Sachs dit: «Vous avez droit de pleurer». Au droit abstrait et légal que l’État français octroie aux femmes d’avorter, Sachs ajoute, par une simple marque d’attention, la reconnaissance de la douleur de la mère qui pleure la perte d’un être qu’elle n’a pu porter jusqu’à la vie.
Le film de Deville ne révèle pas d’où Sachs tire la force et l’inspiration nécessaires à son travail. Il nous montre un forçat de l’écriture tout occupé à recoudre les mailles brisées de son moi. En cela, ce film est bien post-moderne: par peur d’imposer quelque jugement sur son personnage, le cinéaste en donne une psychologie mal définie, plus proche du vide que du mystère.
Les réformateurs de la santé ont généralement de vastes ambitions. Ils cherchent à réformer tout ensemble des institutions, des procédures, des règles, des pratiques, des attitudes et des valeurs. Ils ne distinguent pas toujours ce qui relève du système – soumis aux contraintes de l’efficacité – de ce qui appartient à l’ordre moral. Sous l’influence de la psychologie moderne qui a détrôné la morale traditionnelle, les vieilles vertus ont cessé de guider l’action des hommes. Il n’y a plus que des comportements, des attitudes, des manières de penser et d’agir posés, au nom du refus de tout jugement, comme équivalents, quitte à recourir au juge ou au comité d’éthique pour délimiter la frontière de la normalité. Dans un tel contexte, comment inculquer aux jeunes médecins un sens moral qui les rend sensibles à la souffrance sans les désarmer et leur donner l’indépendance d’esprit qui les fera résister aux errements du système médical et aux demandes irraisonnées de leurs patients? Des cours d’éthique appliquée et de déontologie, assaisonnés de pédagogie, parviendront-ils à enseigner aux professions de la santé ce que sont le courage, la droiture, la compassion et l’honneur?
Il reste heureusement le roman, le cinéma, voire la télévision. Il n’est pas étonnant que les séries télévisées, américaines pour la plupart, qui mettent en scène les haut et les bas de la vie de médecins, connaissent une grande popularité. Elles satisfont le désir d’admiration, celui de pouvoir reconnaître chez autrui des qualités exceptionnelles qui rendent sa vie exemplaire. Quelle confiance la population peut-elle accorder aux professions médicales si elle est convaincue que le système de santé étouffe les actes de dévouement et d’héroïsme et si elle a elle-même abandonné tout sens moral? Dans L’humanité improvisée, Vadeboncoeur déplorait que nous vivions dans une civilisation où les figures sont absentes. «Les grandes évocations, autrement dit les dieux, les saints et les héros – les figures, en somme –, ne règnent plus sur la cité, dans la culture». Vadeboncoeur aurait pu citer Montesquieu: «On ne saurait croire jusques où a été, dans ce dernier siècle, la décadence de l’admiration». Dans le monde de la santé, les figures n’ont peut-être pas entièrement disparu. Tombées dans la pénombre d’un système lourd comme un paquebot dont les réformateurs se disputent le gouvernail, elles sont seulement effacées, perdues dans les ronronnements des machines.
Notes
(1) Martin Winckler, La maladie de Sachs, Paris, éditions P.O.L., 1998.
(2) Pierre Vadeboncoeur, L’humanité improvisée, Montréal, Bellarmin, 2000