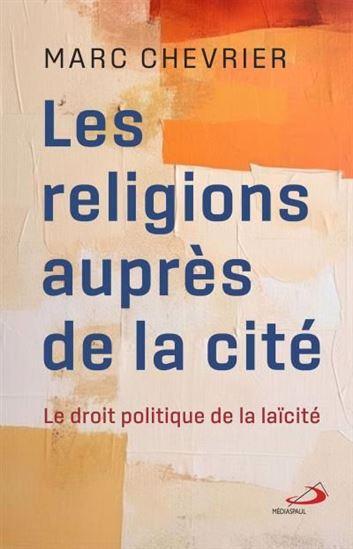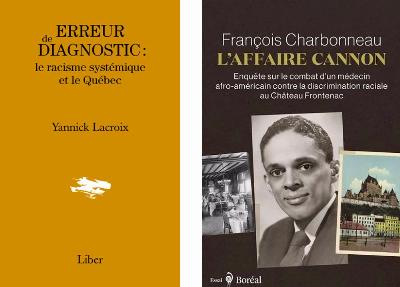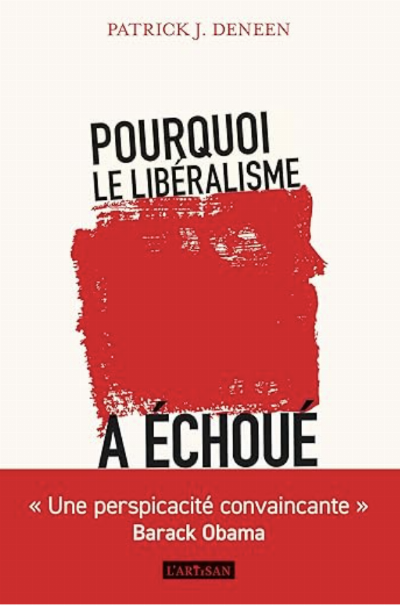Le Brexit ou l’Empire britannique 2.0
Dans un ouvrage publié peu avant les élections générales qui ont eu lieu au Royaume-Uni le 12 décembre dernier, le juriste Marc Chevrier s’est penché sur l’idée d’empire et sur la résurgence de cette forme politique en Occident. Il rappelle que le Royaume-Uni, malgré la perte de ses nombreuses colonies, est demeuré essentiellement un empire, sans jamais devenir à proprement dit un État-nation. Ce fait fondamental, quoique souvent incompris, éclaire le sens du Brexit, choisi par une courte majorité des électeurs britanniques lors du référendum de juin 2016, qui a profondément divisé la classe politique et paralysé le par-lement de Westminster. Cette impasse traduisait au vrai un conflit d’allégeance chez les Britanniques eux-mêmes, les uns voulant renouer avec l’indépendance de leur empire his-torique, les autres s’amarrer au projet de l’Empire européen. Mais finalement, après la vic-toire décisive des conservateurs de Boris Johnson aux élections du 12 décembre 2019, le Royaume-Uni se retirera de l’Union européenne pour s’assumer comme empire indépen-dant et libre, sous une nouvelle forme qui restera certes à définir et que les velléités d’indépendance de l’Écosse et de réunification de l’Irlande du Nord pourraient toutefois menacer de rompre.
Les extraits sont tirés de l’ouvrage de Marc Chevrier, L’Empire en marche. Des peuples sans qualités, de Vienne à Ottawa, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 117-128. Pour alléger la lecture du texte, les notes de bas de page qui l’accompagnent ont été sup-primées.
Le référendum du 26 juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni hors de l’Union européenne a surpris le monde, y compris les Britanniques eux-mêmes, dont beaucoup parmi les partisans du « Brexit » et leurs opposants ne s’attendaient guère à une victoire de l’option du retrait. S’il est vrai que l’Union européenne est un empire en construction, le béton de l’édifice n’a pas encore tout à fait pris, au point qu’on ne puisse envisager d’en sortir, encore que les négociations entre ce pays qui a su toujours réclamer et obtenir pour lui-même des régimes ogatoires et les instances bruxelloises de l’union se sont avérées longues et ardues. Mais ce retrait pose aussi une question fondamentale : quelle est la nature de ce pays, en tant que corps politique, qui le premier, une fois admis dans le concert européen, décide de lui tourner le dos pour tenter de reconquérir son indépendance ? C’est une vue de l’esprit séduisante que de penser que l’Union européenne a regroupé des corps politiques similaires, c’est-à-dire uniquement des États-nations, qui ne différeraient que par leur régime de gouvernement – parlementaire, semi-présidentiel ou par le degré de centralisation, unitaire ou fédéral. […]
Dès 1533, en s’attribuant par une loi la juridiction ultime sur les affaires ecclésiastiques, Henri VIII proclama que « le Royaume d’Angleterre est un empire », soit « un corps politique, composé d’un rassemblement de gens de toutes sortes et de tous degrés, divisé en appellations, et par les noms de spiritualité et de temporalité ». Henri VIII n’en était pas à sa première proclamation d’empire ; il en avait déjà martelé l’idée lors de la prise de la ville de Tournai en 1513. Outre l’ambition d’affirmer la supériorité du roi anglais vis-à-vis de la papauté, cette proclamation d’empire remplissait une fonction politique déterminante, consistant à unifier sous une même couronne toutes les possessions que l’Angleterre avait annexées ou érigées en dominions distincts. Tel que le souligna un historien britannique : « [p]olitiquement, la Couronne impériale désignait un processus d’union, et non pas juste un état d’unité. » Sous le règne des Tudors, la Couronne impériale anglaise devint « en droit une chose infinie et immortelle et, en politique, une force d’unification ». C’est grâce au patronage juridique de ce concept « totalitaire » qu’on a pu « souder le pays de Galles, l’Angleterre et l’Écosse en un seul corps politique », et au XIXe siècle « tisser et annexer un empire colonial et un Commonwealth ».
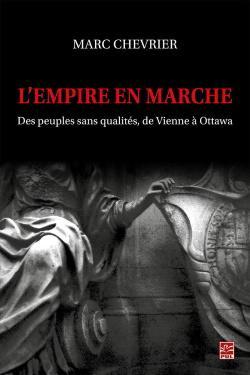 Il est vrai que ni le Parlement de Westminster ni les rois anglais n’ont systématiquement invoqué le concept de couronne impériale pour consolider le corps politique britannique ; celui-ci apparut toutefois dans la loi de 1707 scellant l’union de l’Écosse et de l’Angleterre en ce qui touche la succession au trône, ainsi que dans la loi de 1801 imposant l’union de l’Irlande et de la Grande-Bretagne. Mais, dès les premiers rois Stuart, la notion d’empire avait connu une mutation significative ; elle désignait non plus seulement la souveraineté du monarque sur son royaume, mais une union « incorporative » fusionnant plusieurs royaumes en un nouveau. De plus, « [l]’idée impériale, écrit le juriste Thibault Guilly, devient désormais un moyen de penser le gouvernement d’un territoire vaste et composite, elle devient un mode d’organisation territoriale du pouvoir visant à réconcilier l’unité politique et la diversité territoriale ». Et par la suite, grâce à sa flotte contrôlant les voies maritimes, l’empire en vint à désigner l’ensemble composé du Royaume-Uni, de ses colonies et de ses dépendances outre-mer.
Il est vrai que ni le Parlement de Westminster ni les rois anglais n’ont systématiquement invoqué le concept de couronne impériale pour consolider le corps politique britannique ; celui-ci apparut toutefois dans la loi de 1707 scellant l’union de l’Écosse et de l’Angleterre en ce qui touche la succession au trône, ainsi que dans la loi de 1801 imposant l’union de l’Irlande et de la Grande-Bretagne. Mais, dès les premiers rois Stuart, la notion d’empire avait connu une mutation significative ; elle désignait non plus seulement la souveraineté du monarque sur son royaume, mais une union « incorporative » fusionnant plusieurs royaumes en un nouveau. De plus, « [l]’idée impériale, écrit le juriste Thibault Guilly, devient désormais un moyen de penser le gouvernement d’un territoire vaste et composite, elle devient un mode d’organisation territoriale du pouvoir visant à réconcilier l’unité politique et la diversité territoriale ». Et par la suite, grâce à sa flotte contrôlant les voies maritimes, l’empire en vint à désigner l’ensemble composé du Royaume-Uni, de ses colonies et de ses dépendances outre-mer.
C’est pourquoi penser que ce corps politique devenu au temps de la reine Victoria le plus grand empire de l’histoire de l’humanité ne soit aujourd’hui qu’un État-nation au sens européen du terme tient de la berlue. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont d’ailleurs cela en commun que leur nom officiel ne renvoie à une aucune nation particulière qui prétendrait totaliser l’ensemble politique ; tous les deux se signalent par ce qu’ils unissent, des États, ou les composantes géographiques d’un royaume, et tous les deux ont connu au cours de leur histoire une expansion impériale, à la fois interne et externe.
Sans ambages, le juriste français Denis Baranger a défendu la thèse que le Royaume-Uni est demeuré, encore aujourd’hui, un empire, même débarrassé de son vaste domaine colonial, excepté quelques restes épars dans le monde. Mettant de côté les concepts d’État fédéral et d’État unitaire, l’auteur donne de l’empire une définition de départ simple :
Par là, j’entends un corps politique constitué par un processus conduisant une entité « centrale » à étendre son pouvoir sur des territoires toujours plus larges (en vérité, sans limites) par voie de contrainte.
Dans cette définition, Baranger insiste sur le rôle de la conquête dans l’établissement de l’empire, qui peut prendre des formes diverses d’« emprises » du pouvoir central sur une nation périphérique, de l’annexion d’une petite nation par ordonnance du roi, comme le pays de Galles à l’époque des rois Tudor, à l’invasion armée. Mais, si brutale et unilatérale qu’elle soit, la conquête ne vise pas nécessairement l’exclusion du dominé dans le corps politique, où il peut progressivement acquérir les droits déjà exercés par la nation dominante. Fondé sur la conquête, pas à pas construit par l’ajout plus ou moins forcé de nouvelles composantes, l’empire fait nécessairement face à la question du consentement à leur statut, accordé le plus souvent sous forme de privilège, pour reprendre le verbe choisi par Edmund Burke pour qualifier la nature des droits des peuples et des nations que l’Empire britannique a cueillis dans son escarcelle. Qu’il s’agisse de l’Écosse dans le Royaume-Uni actuel ou des colonies américaines sous le long règne de George III, le consentement des composantes périphériques à l’empire a toujours été un enjeu, non sans entraîner, en cas de refus de Londres de reconnaître la réalité des réclamations venues de la périphérie, de lourdes conséquences sur la cohésion de l’ensemble impérial. Ce qui conduit Baranger à penser que « la contrainte est un aspect de la formation de l’empire, pas nécessairement le trait dominant de son fonctionnement ».
Plus déterminant que la conquête dans la dynamique de l’empire est le rapport à la frontière, ou plutôt la capacité du pouvoir à se restreindre dans l’espace et le temps. Selon Baranger, à la différence de l’État-nation, qui lui se déploie à l’intérieur d’un territoire précis et trouve même son identité et sa consistance dans ce qui le borne, l’empire ne voit ni de limite spatiale ni de terme à l’exercice de son pouvoir et de son influence. En ce sens, par sa limitation même, l’État ne fonde pas sa souveraineté, note Baranger, « sur une prétention à l’universalité », car, s’étant longtemps défini par opposition à l’empire universel de la papauté en Europe, il « est une résistance de ce qui est situé, localisé, inscrit dans la temporalité, à ce qui se veut universel, au sens de non local, et de non temporel ». L’État a une part liée avec une frange de l’humanité, il a donc un caractère fini, sur le plan humain comme géophysique. Ce qui ne veut pas dire que l’État-nation renonce à toute prétention à l’universel ; il peut, comme la France, revendiquer pour lui-même une universalité de type spirituel, tirée d’ailleurs de la doctrine révolutionnaire des droits de l’homme. L’universalité qui, selon Baranger, caractérise l’empire est plutôt de nature spatiale. Les rois de France et d’Angleterre ont certes tous les deux déclaré qu’ils étaient « empereurs en leur royaume » pour signifier leur indépendance vis-à-vis du pape, mais dans le cas du roi anglais, note Baranger, au regard du libellé des vieilles lois constitutionnelles anglaises, sa souveraineté s’est doublée de la prétention à connaître « une extension territoriale illimitée ». L’empire, c’est le pouvoir sans frontières, c’est la puissance qui repousse sans cesse les bornes de son domaine, en déplaçant, sur la ligne de son périmètre, le curseur qui sépare l’intérieur de l’extérieur. De cette manière, Baranger dégage en quelque sorte deux types de puissances, l’une qui aspire à l’unité spirituelle, en créant un corps homogène, et l’autre, d’extension maximale, en gardant en elle, dans une certaine mesure, son hétérogénéité. Ainsi :
Le Roi d’Angleterre […] a signalé en même temps qu’il envisageait sa propre puissance comme susceptible d’une extension territoriale illimitée. Dans ses profondeurs idéologiques, l’État français réclame l’autorité spirituelle sur l’âme du monde (il est l’État des droits de l’homme), tandis que l’Angleterre aspire à le dominer matériellement sans toutefois se fondre avec lui dans un tout uniforme. Cette particularité du projet politique de longue durée de l’Angleterre est reflétée de manière appropriée par le terme « empire ».
Mieux que l’opposition entre intérieur et extérieur, sur laquelle se construit l’État, le rapport entre centre et périphérie est fondamental pour l’empire. Ce qui ne veut pas dire que celui-ci se dispense de frontières, tant s’en faut. Cependant, la puissance dans l’empire ne cherche pas à tout ranger, territoires, populations, sous son parapluie et à clore ainsi son espace, protégé de l’étranger. L’empire est capable de porosité, de gradation dans les espaces exposés à sa souveraineté, de se retirer de quelques-uns, puis de les investir de nouveau. Comme le souligne Baranger, l’empire balance entre, d’une part, sa tendance à vouloir préserver son centre, donc à ne point se confondre avec la périphérie, en multipliant les démarcations et, d’autre part, sa propension à vouloir intégrer ce qui lui échappe, maintenu en « réserve », en candidat à une absorption future. Ainsi, écrit Baranger, « la frontière de l’empire est translucide : elle est une fenêtre sur un espace qui possède une vocation naturelle à être intégré ». En somme, l’empire préfère l’ouverture, la disponibilité, l’indéfini et l’inclusion progressive à la clôture, à la délimitation et à l’étanchéité. Il ajoute :
Dans l’empire, tout espace extérieur – terre dominée pour le moment par un autre Prince, mer environnante et bientôt l’ensemble des océans – est un « intérieur » potentiel. Mais le sort réservé à cet « intérieur » est d’une autre nature que ce qui arrive dans les limites de l’État. Il n’est pas question d’uniformiser ce qui est enserré dans les liens de la puissance impériale. Les démarcations anciennes, les lois et coutumes propres à chaque entité, et même les cultures, les sentiments nationaux, etc., ne sont pas abolis. Dans l’État, la frontière est aussi le critère du rapport ami (à l’intérieur) / ennemi (à l’extérieur). Tel n’est pas le cas dans l’empire, même si celui-ci lutte sans fin pour la pacification de ses possessions. Mais, n’étant pas appelé à devenir un autre soi-même (à être uniformisé, à devenir homogène), celui qui est intégré dans l’empire peut rester hostile, aussi longtemps qu’il demeure soumis.[…]
En réalité, l’empire profite de l’existence en son sein d’un « ennemi intérieur », soit une population qui résiste à l’incorporation au centre et qui le pousse paradoxalement à renforcer sa volonté d’emprise par de nouveaux moyens, quitte à tolérer l’ennemi dans les marges, en dehors du système officiel du pouvoir. Celui-ci se nourrit ainsi du rapport dialectique de déférence envers le centre et de défiance envers lui. « L’Irlande est restée, pour l’Angleterre, note Baranger, le modèle de cette sorte d’ennemi de l’intérieur, résistant à l’incorporation et affirmant sans relâche sa particularité. » (On pense d’emblée au fait national français au Canada.) Baranger donne en exemple de la dynamique impériale entre le centre anglais et l’Irlande périphérique le statut de dominion – pareil à celui du Canada – que celle-ci s’est acquis en 1922, qui maintenait néanmoins dans l’Irlande devenue souveraine la couronne britannique et des bases militaires. Même séparée d’Albion, longtemps maîtresse tyrannique de sa destinée, l’Irlande a continué d’avoir un lien, dont la nature oscille entre la sujétion et la liberté, avec le pouvoir anglais. Même aujourd’hui, pourrions-nous ajouter, en dépit du fait que le Parlement de Westminster n’exerce plus sa souveraineté de naguère sur ses anciennes colonies, le monarque britannique demeure le chef d’État d’une quinzaine d’entre elles – ce qui donne à Westminster la compétence résiduelle de définir les règles de succession pour tous ces pays ; qui plus est, la vague confédération qu’est le Commonwealth unit encore l’ancienne métropole et ses possessions par des liens diplomatiques et culturels. L’empire pratique donc l’art de l’entre-deux, c’est-à-dire savoir intégrer un corps nouveau sans l’absorber tout à fait, et continuer de le mettre à part, en conservant sur lui quelques prises encore, même quand l’élément extérieur semble s’être émancipé. Face à l’ennemi intérieur, il recherche des formules de pouvoir qui sont situées, d’après Burke que cite Baranger, « quelque part entre l’hostilité et le gouvernement ».
[…]Il va sans dire que l’empire à la britannique révèle d’extraordinaires capacités de souplesse, d’adaptation, d’« accommodement » envers ses nations minorisées, pour reprendre un terme qu’affectionnent les théoriciens de la diversité et du fédéralisme. Le processus historique de sujétion de nations à un centre, à une nation dominante, ne débouche pas nécessairement sur leur disparition ou leur absorption totale. L’empire les intègre tout en préservant une part, disons résiduelle, de leur l’identité, quitte à leur accorder, de préférence sans devoir consigner tout cela dans un texte solennel, la jouissance de leurs lois, de leurs coutumes et de leurs institutions civiles. La souveraineté juridique doit connaître un seul détenteur – le Parlement de Westminster –, à cela près qu’il n’est pas requis que les statuts de ces nations ou leurs systèmes juridiques soient uniformes. En droit britannique, le pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord demeurent des possessions de la Couronne impériale anglaise où les lois du royaume, qui doivent garantir l’égalité des sujets britanniques, sont appliquées en fait par plusieurs appareils judiciaires et systèmes de droit – l’Irlande du Nord a son système judiciaire, et l’Écosse son propre droit privé et même criminel. L’empire peut donc fort bien se satisfaire d’une unification inachevée du territoire.
Chacune d’elles s’est vu intégrer à l’empire à sa façon ; l’Irlande et le pays de Galles, par conquêtes et annexions périphériques ; l’Écosse, par une union des couronnes et des Parlements avec l’Angleterre, qui fit disparaître la terre de Marie Stuart comme pays indépendant en 1707. En fait, l’idée d’union est le concept dont les juristes et les politiciens britanniques encore aujourd’hui se servent pour désigner le rattachement des nations annexées au royaume. Ce langage entretient l’idée, qui a inspiré le romantisme historique de nombre d’Écossais et de Gallois nostalgiques de leur défunte liberté, que les rapports entre l’Angleterre et ses nations périphériques sont comparables à la négociation interétatique d’ententes entre deux souverainetés ou nations originellement libres. Ainsi l’Union anglo-écossaise s’est-elle conclue par voie d’un traité, ratifié ensuite par une loi de Westminster et une autre du Parlement d’Édimbourg, l’Angleterre et l’Écosse demeurant certes des entités de droit distinctes. Cependant, cette union, inégalitaire, consacra la perte irréversible de souveraineté pour l’Écosse. […] Le même langage de l’union prévalut pour l’Irlande en 1801, de manière plus brutale que pour l’Écosse toutefois, puisque Dublin perdit son vieux Parlement sans aucune contrepartie, après la révolution avortée des patriotes irlandais de 1798.
[…]
Somme toute, il est loisible de penser que l’Empire britannique n’a jamais pris fin, puisqu’aucun bouleversement institutionnel ni aucune révolution des mentalités n’ont désamorcé véritablement les principes structurants du corps politique britannique, en dépit de la décolonisation et de la dévolution de 1999, qui a vu le Parlement de Westminster accorder à ses nations périphériques leur propre assemblée nantie de compétences soumises à la loi britannique. On pourrait aussi estimer que même la participation du Royaume-Uni à l’Union européenne ne lui a pas fait perdre sa qualité d’empire, ce qu’a suggéré Baranger. Cependant, l’entrée du pays dans le système européen et son intégration à l’économie continentale, sans entamer l’édifice de l’union « incorporative », ont certes diminué l’indépendance britannique vis-à-vis de l’Europe, ce qui a motivé bon nombre de brexiters à voter la sortie du Royaume-Uni hors de l’Union européenne. Chez les avocats du Brexit, il en est qui ont tenté de réactiver les prestiges de l’ancien empire, en envisageant que le pays, délié de ses attaches européennes, renoue avec ses anciennes colonies et intensifie avec elles ses liens économiques, non sans indisposer ses nations périphériques qui voyaient dans l’Union européenne un moyen d’affaiblir Londres et de se relier au continent. Dans la haute administration britannique – Whitehall –, d’aucuns ont nommé « Empire 2.0 » la volonté du Royaume-Uni de resserrer ses relations économiques avec les membres du Commonwealth, en particulier avec l’Afrique après le Brexit. Mais l’inextricable imbroglio juridique et parlementaire dans lequel le pays s’est enfoncé après le référendum de juin 2016 a montré que l’irrésolution des élites britanniques, incapables de donner suite à ce vote, reflétait celle, plus large et peut-être plus profonde, de la population, elle-même divisée entre deux camps. L’un a pris pour un Empire britannique renouvelé, devant gagner son indépendance non par la conquête, mais par le commerce et des alliances stratégiques, et l’autre, pour l’Empire européen, associé pour plusieurs au primat de la langue anglaise sur le continent, à la modernité libérale, au multiculturalisme et à la construction d’une nouvelle puissance concurrente des États-Unis, de la Russie et de la Chine. C’est un peu comme si l’ancien débat entre le parti du Pays – ou de la Campagne dirait Chateaubriand – et celui de la Cour refaisait surface, en mettant en scène, d’un côté, la préservation jalouse de l’indépendance du Parlement ainsi que les mœurs saines et rustaudes du royaume, et de l’autre, un Parlement acquis aux intérêts de la finance et de la bourgeoisie montante et une civilisation réceptive aux sophistications européennes.
Au fond, le Brexit a soulevé une question à laquelle les Britanniques ont peiné à trouver une réponse : comment un vieil empire historique peut-il se résoudre lui-même à s’effacer pour embrasser le projet plus vaste et plus « éthique » d’un empire européen en formation ? Comme l’explique Robert Tombs, au Royaume-Uni « le “super-État” européen est moins perçu comme une garantie de paix et de liberté que comme le dernier en date des hégémons continentaux en puissance qui se sont succédé depuis cinq siècles ». Et si l’on remonte plus loin dans le temps, on s’aperçoit que l’Angleterre a toujours balancé entre l’appel de l’outre-mer et celui de l’outre-Manche. […]
Après le vote sur le Brexit, ces deux appels se sont affrontés comme deux Goliath tirant à forces à peu près égales leur bout à la souque à la corde.
While globalization seems to weaken the nation, we are nevertheless losing sight of its competitor, the empire, which, emerging from ancient times, is renewing itself in modernity. Far from being a single great power - the United States - it is multiple and diversely populated: the European Union, the United Kingdom and even... Switzerland. In a liberal democracy, empire often takes the form of a federation, which we continue to idealize without grasping its imperial dynamic and foundations. Canada is a prime example of empire in action, which claims to synthesize a post-national microcosm in which cultures, peoples and beliefs would coexist harmoniously, thanks to a multicultural right and a special art of governing.
Navigating through history, law and ideas, between Europe and America, the author follows the fertile intuitions of the writer Robert Musil, a privileged witness of the late Austro-Hungarian Empire, where many men and peoples ended up "without qualities".