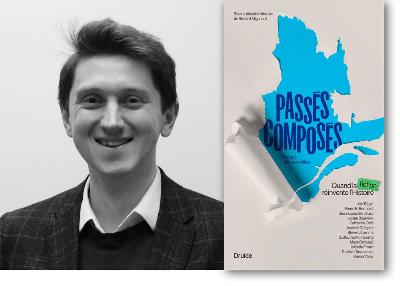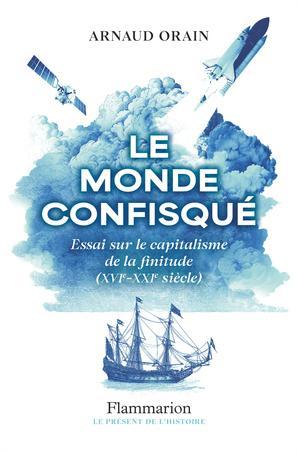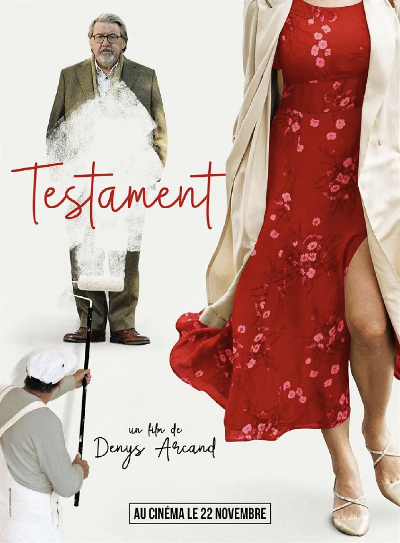Penser les algorithmes dans un cadre complexe avec G.F.R. Ellis
«Bientôt, l’intelligence artificielle nous fera passer pour des singes», déclarait récemment le milliardaire gourou des nouvelles technologies Elon Musk à Shangaï, lors d’une conférence donnée en compagnie de Jack Ma, fondateur d’Alibaba. Pour bien comprendre les algorithmes, il convient toutefois d’éviter de céder à ce genre de scénarios de science-fiction, et de faire preuve d’un solide réalisme critique. En ce sens, la pensée de la complexité de George Francis Rayner Ellis nous invite à remettre la notion d’algorithme dans son contexte. Ellis place l’être humain dans une hiérarchie des niveaux de réalité, hiérarchie qui montre que l’humain est le maître des algorithmes, non l'inverse.
La hiérarchie du réel
 Nous avons aujourd’hui l’impression de vivre dans un monde entièrement contrôlé par des algorithmes. Le monde du travail et de la consommation, nos divertissements, nos communications privées et publiques sont de plus en plus épiées, encodées et formatées par les algorithmes des géants du numérique. Pour tenter de nous y retrouver dans ce monde de science-fiction et de techno-réalité, il faut une vision d’ensemble du réel. Le physicien sud-africain G. F. R. Ellis est un théoricien de la complexité qui peut nous aider en cela. Il est aussi mathématicien et cosmologue. Il promeut une éthique de la non- violence. La pensée qu’il présente comme «science de la complexité» repose sur une ontologie qui hiérarchise les niveaux de réalité. Ellis est un des rares penseurs contemporains à proposer un tableau synthétique complet des sciences exactes et humaines, et à situer ce tableau dans le cadre d’une métaphysique classique d’inspiration aristotélico-platonicienne. Cette ontologie a beaucoup à nous dire sur les algorithmes, en les replaçant à leur juste place dans l’ordre du réel.
Nous avons aujourd’hui l’impression de vivre dans un monde entièrement contrôlé par des algorithmes. Le monde du travail et de la consommation, nos divertissements, nos communications privées et publiques sont de plus en plus épiées, encodées et formatées par les algorithmes des géants du numérique. Pour tenter de nous y retrouver dans ce monde de science-fiction et de techno-réalité, il faut une vision d’ensemble du réel. Le physicien sud-africain G. F. R. Ellis est un théoricien de la complexité qui peut nous aider en cela. Il est aussi mathématicien et cosmologue. Il promeut une éthique de la non- violence. La pensée qu’il présente comme «science de la complexité» repose sur une ontologie qui hiérarchise les niveaux de réalité. Ellis est un des rares penseurs contemporains à proposer un tableau synthétique complet des sciences exactes et humaines, et à situer ce tableau dans le cadre d’une métaphysique classique d’inspiration aristotélico-platonicienne. Cette ontologie a beaucoup à nous dire sur les algorithmes, en les replaçant à leur juste place dans l’ordre du réel.
Un algorithme, nous dit Ellis, est une «recette précise», qui spécifie le nombre exact, fini, d’étapes pour résoudre un problème. Toute série de commandes peut à la rigueur être considérée comme un algorithme. L’algorithme informatique qui nous intéresse ici, est une série de commandes, organisée selon un ordre précis, de façon à réaliser un objectif, un but quelconque. La logique des algorithmes dérive de ce qui est possible en termes logiques. «L’espace logique des algorithmes possibles» est un espace platonicien abstrait qui existe objectivement et qui a une influence causale sur le monde physique par l’entremise des machines informatiques opérées par les humains.
L’algorithme d’un ordinateur procède selon une causalité descendante («top-down»), allant du plus complexe au moins complexe. Le code informatique dirige une machine constituée de circuits physiques. C’est là l’aspect purement objectif des algorithmes. Leur aspect subjectif est le but poursuivi, l’objectif qui précise la tâche à réaliser. Cet objectif relève de l’arbitraire de celui ou ceux qui conçoivent exécutent l’algorithme. Ce peut être n’importe quelle tâche réalisable par un ordinateur, ou par un objet dirigé par ordinateur.
Le fonctionnement d’un algorithme implique une interaction entre plusieurs domaines ontologiques bien distincts. Il y a selon Ellis quatre domaines ontologiques, qu’il nomme simplement «mondes». Le premier est le monde physique, celui de l’énergie et de la matière, objets de disciplines allant de la physique, à la chimie, à la biologie, jusqu’à la neurologie. L’ordinateur, en tant que machine physique («hardware») fait partie de ce monde. Toutefois, n’oublions pas que le cerveau humain est de loin l’entité la plus complexe de monde-là.
Le deuxième monde est celui de la conscience, le monde de la subjectivité et de l’intersubjectivité, tel qu’étudié par la psychologie et les différentes sciences sociales, tel que décrit par les arts et la littérature, et tel que vécu dans la vie quotidienne. Il est constitué de vécus que l’on peut conceptualiser qualitativement, mais non mesurer quantitativement. Le monde 2 est irréductible au monde 1. Ni l’ordinateur, ni l’algorithme n’en font partie. En font partie les personnes qui les conçoivent et celles qui en subissent l’action.
Le troisième monde est celui des «possibilités aristotéliciennes», c’est-à-dire de «l’être en puissance» physique et biologique. Il est l’être toujours ouvert de l’avenir du monde physique, par opposition son à son être actuel, celui du monde 1. Le monde 3 est irréductible aux deux premiers, ce qui confère à l’avenir un caractère en partie indéterminé: le «possible» est un cadre qui pose des limites déterminées, à l’intérieur desquelles un espace indéterminé est préservé. Les êtres physiques soumis aux algorithmes conservent donc une part d’indétermination.
Le quatrième monde est le monde des «abstractions platoniciennes», le monde des lois mathématiques et des formes esthétiques idéales qui gouvernent l’univers. Ellis considère qu’un idéal abstrait est objectivement réel quand on peut le formaliser par la raison, et quand il peut être identifié comme la cause d’effets empiriquement repérables. C’est ce quatrième monde qui définit l’objectivité idéale des algorithmes.
Contrairement aux constantes mathématiques idéales qui gouvernent naturellement le monde 1, les algorithmes sont en eux-mêmes de purs êtres logiques, qui ne se concrétiseraient jamais sans l’intervention de l’humain. Il appartient aux êtres humains (monde 2) de les mettre en oeuvre ou non. Les algorithmes ont beau être en eux-mêmes mécaniques, «robotiques», ils répondent à des finalités humaines, à des désirs et des souhaits. De plus, à l’autre bout de leur causalité, ils ont aujourd’hui de plus en plus d’effets sur la psychologie humaine, à cause de leur utilisation massive dans les communications numériques, à cause aussi de l’immersion de plus en plus grande des individus dans celles-ci.
Irréductibilité de l’esprit humain aux algorithmes
Le monde humain, en tant que système de subjectivités qui interagissent selon un ensemble de finalités idéales est le plus haut niveau de complexité qui existe en ce bas monde. Les strates supérieures de la réalité humaine ont la propriété d’être en interaction avec des types de réalité irréductibles à la matière: les lois de l’univers, et les idéaux esthétiques. Ellis ne précise pas dans quel monde se trouvent les idéaux éthiques. Sont-ils des conventions subjectives? Sont-ils des idéaux objectifs? Ellis affirme l’irréductibilité des valeurs et idéaux éthiques à tout algorithme. Les valeurs ne sont pas formalisables. On ne peut définir a priori une série finie d’étapes logiques qui réalisent une valeur. Il n’y a pas d‘action bonne sans une attention bienveillante aux événements imprévisibles, et surtout aux réactions personnelles imprévisibles, qui peuvent toujours modifier une situation éthique. Une valeur ne peut être comprise que par une intelligence capable d’une intuition du bien, et d’un jugement prudent, au sens de la phronésis d’Aristote.Pour autant, l’éthique n’est pas un domaine arbitraire ou relatif à de pures conventions, mais bien, selon Ellis, un domaine de réflexion philosophique. Les idéaux politiques et philosophiques des humains sont à comprendre comme une interaction entre notre vie subjective (monde 2) et les monde 3 et 4. Nous concevons intersubjectivement des valeurs et des buts supérieurs à la lumière de ce que nous connaissons objectivement de la réalité actuelle, possible et idéale. Ellis ne le dit pas, mais il semble ici rejoindre Platon en plaçant le Bien «au-delà de l’être».Le Bien absolu est ainsi une asymptote que la raison humaine ne saisira jamais, mais dont elle peut se rapprocher indéfiniment.
L’algorithme lui-même est ainsi l’une des preuves les plus concrètes de la capacité de l’esprit humain de dépasser l’ordre de la matière. Il est aussi une preuve tangible de la réalité du monde idéal. La puissance des algorithmes n’est donc pas celle des machines sur l’homme, de la matière sur l’esprit, mais au contraire celle d’esprits humains armés de connaissances objectives, celle d’une caste éclairée qui maintient dans l’ombre ceux qu’elle considère comme un troupeau à exploiter. Le «troupeau humain» n’est précisément pas un troupeau, mais plutôt une communauté de personnes libres et rationnelles. La conscience humaine est réelle, elle n’est pas un épiphénomène. Son autonomie, sa rationalité, son intériorité sont en vérité telles que nous les vivons, telles que nous les éprouvons dans notre «sens interne cartésien» et dans le «dialogue socratique». La réalité de la conscience est même éprouvée empiriquement par les conséquences engendrées par les décisions que nous prenons et devons assumer.
L’intersubjectivité humaine est en elle même trop complexe pour être réductible à un algorithme ou contrôlable par l’un ou l’autre. Un algorithme présuppose une finalité humaine. La conscience humaine est surtout trop vivante, trop spontanée, trop libre pour être formalisée par un algorithme. La conscience n’est pas réductible à des déterminismes, elle n’est pas «prévisible». En même temps, sa réflexivité lui permet de se déterminer elle-même dans une certaine mesure, et de donner un sens à sa libre spontanéité. La seule chose qui puisse vraiment l’asservir, c’est donc elle même. La raison de l’humain, consubstantielle à sa liberté, lui donne la capacité d’actions libres mais ordonnées. La seule causalité descendante, «de haut en bas» (top down), qui puisse orienter l'action humaine est celle du pouvoir politique. On se souviendra que le pouvoir authentiquement politique est un pouvoir qui s’adresse à des citoyens libres, un pouvoir auquel on consent librement, en se soumettant volontairement à la force de la seule raison.
Les algorithmes exercent une causalité descendante sur la machine qu’ils dirigent, et sur des objets physiques qui pourraient être reliés à cette machine («l’Internet des objets»). Cependant, leur causalité sur l’humain est ascendante («bottom-up»). Ils peuvent agir sur des émotions, des réactions physiologiques, etc., mais ils n’agissent pas directement sur notre conscience, qui ne dépend que de nous. Ils agissent sur nous dans la mesure où nous n’avons pas une pleine maîtrise de nous-mêmes, de l’infrastructure émotive de notre être ; dans la mesure où notre vigilance se relâche, où nous nous laissons aller à la paresse. En définitive, les algorithmes ont un pouvoir sur nous seulement dans la mesure où une idéologie individualiste, hédoniste et progressiste à bon marché nous dispose à accepter l’intrusion du numérique dans nos vies, même lorsqu’il n’est pas vraiment utile, même lorsqu’il trompe de plus en plus difficilement notre ennui, et même lorsque nous devrions de toute évidence, lui consacrer moins de temps.
Ellis nous met en garde contre les philosophies réductionnistes qui font de l’humain un simple produit de conditionnements génétiques et sociaux. C’est ce type de philosophie qui nous conduit à une servitude volontaire aux algorithmes. Les philosophies réductionnistes donnent un vernis intellectuel à ce qui n’est en fait qu’une démission morale, un désengagement des réseaux humains vivants, les seuls véritables réseaux sociaux que sont la famille, la société civile, les grandes institutions. Le fait que le terme «réseau social» désigne aujourd’hui, dans l’usage courant, exclusivement des réseaux numériques qui atomisent les individus et favorisent la dépression nerveuse est un symptôme de la gravité de notre aliénation.
Il est vrai que cette démission morale est en partie l’effet de grand changements sociaux et économiques, de l’économie de marché, et de forces politiques qui dépassent la conscience des individus, de l’ingénierie sociale de l’État. Il s’agit ici de causalité ascendante, du moins complexe au plus complexe. Il s’agit ici, de façon analogue à l’action des algorithmes, d’une causalité ascendante qui n’agit que sur les strates inférieures de la psyché humaine. Cette action n’est donc que «pathologique». Toutefois, ces grands processus ne sont jamais subis purement passivement. Nous devons nous adapter à eux, mais cette adaptation compte une large part de liberté. Surtout, ces grands processus n’auraient jamais eu lieux sans des décisions humaines, aussi bien de la part des dirigeants d’entreprises, de syndicats ou d’États, que des citoyens qui les ont acceptés. Aucun de ces processus n’annule notre capacité de décider, d’innover, et de former des relations entre nous.
Critique habermassienne de l’idéologie technoscientifique, et critique d’Habermas
Il est tout à fait possible de soumettre ceux qui décident des algorithmes à des décisions politiques démocratiques. Le discours qui nous dit que cela est impossible tombe sous la critique de «la technique et la science comme «idéologie»» formulée par Jürgen Habermas. La technoscience est une «activité rationnelle par rapport à une fin», c’est-à- dire un processus méthodique de contrôle du réel orienté par une finalité humaine. La technoscience évalue et met en oeuvre les moyens d’atteindre une fin préalablement posée. La fin elle-même appartient au domaine des interactions humaines «médiatisées par le langage», c’est-à-dire au monde vécu intersubjectif, irréductible à la technoscience. La technoscience devient une idéologie lorsqu’elle prétend avoir réponse à tout, y compris aux questions intersubjectives. Alors, au nom de la nécessité du moyen, on soustrait la fin à la discussion publique. Cela a pour effet de promouvoir les intérêts et finalités de ceux qui possèdent et dirigent l’infrastructure technoscientifique au rang «d’évidences» indiscutables, de nécessités incontournables. Des décisions sont présentées comme justifiées par une nécessité technique, et donc soustraite à toute critique, alors que c’est d’elle en premier lieu que la technique dépend.Il faut donc dans une optique habermassienne soumettre les algorithmes à «l’archéologie» éclairante des sciences psychologiques, sociales et historiques, afin de dévoiler et critiquer les pulsions, les décisions et les interactions humaines qui les dirigent.
Encore faut-il toutefois que cette démystification soit rigoureuse, qu’elle soit porteuse de Lumières factuelles et logiques. Or les sciences humaines sont affligées du mal de la «critique comme idéologie», c’est-à-dire d’une surproduction théorique où des approches calamiteuses au plan méthodologique sont encouragées au nom d’un désir sans frein d’émancipation et d’égalité. Les finalités des sciences humaines ne sont pas claires en elles-mêmes. Comment un discours critique sur les finalités des algorithmes et de la technoscience peut-il avoir la moindre cohérence si ses propres finalités ne sont pas clairement établies? L’éthique libérale est plus rigoureuse que les thérories critiques de tendance postmoderne, mais cette rigueur n’est atteinte qu’au prix d’un formalisme vide. La liberté et l’égalité, la recherche de bien être définies en termes utilitaristes, sont sans doute les valeurs les plus universelles du monde universitaire, et plus largement, des institutions formelles occidentales. Le formalisme libéral réussit jusqu’à un certain point à mettre en place un formalisme des valeurs. Mais ce faisant, les valeurs de liberté, d’égalité et de bien être sont de moins en moins des idéaux substantiels, et de plus en plus des formes vides qui trahissent en fait l’absence de valeurs concrètes, l’absence de toute vision du bien.
L’éthique formelle de la communication comme celle que promeuvent Habermas et d’autres ne peut donc suffire à véritablement critiquer les finalités qui orientent les algorithmes, pas plus que les diverses théories contractuelles comme celle de John Rawls. Par définition, ces théories libérales sont formalisées à outrance précisément parce qu’elles imitent naïvement la rationalité des sciences naturelles. Elles aboutissent à des cadres très rigides qui délimitent ce qui est permis et ce qui est interdit, en excluant a priori toute notion de bien commun, de justice substantielle. Au nom de la rigueur formelle, elles rejettent en dehors du champs de la rationalité la vie bonne, la cité idéale. Au nom de la liberté, elles excluent d’emblée le bagage éthique des majorités historiques, la recherche de consensus sur le bien. En fait, le formalisme éthique a exactement le même défaut que l’idéologie technoscientifique: celui de d’inverser l’ordre des moyens et des fins. Le cadre formel qui devrait guider la discussion sur le bien devient un pseudo bien. Le postulat d’un «horizon hypothétique d’un consensus idéal» d’Habermas est imposé comme le seul consensus possible. Le «voile d’ignorance» de Rawls, loin de guider des dialogues concrets sur la justice, devient le dialogue mythique qui a toujours déjà fondé la justice.Dans un premier temps, le formalisme neutralise toute métaphysique du bien au nom du pluralisme métaphysique. Pour que l’individu puisse penser ce qu’il veut, toute pensée du commun est éliminée. Cela revient en fait à neutraliser le politique, en tant qu’action commune.
Dans un second temps, l’individualisme et l’égalitarisme formels deviennent le seul contenu. Loin de donner des finalités claires aux sciences humaines, le formalisme éthique les disperses dans toutes les directions, à la recherche de toute marginalité à défendre, de toute aspiration individuelle à promouvoir. Il est difficile alors pour les sciences humaines de demeurer toujours rigoureuses, impossible pour elles de développer une critique cohérente de la société. Les multinationales du numérique ont beau jeu de tenter d’imposer leurs finalités par leurs algorithmes, dans le climat de confusion entretenu par le verbiage obscurantiste des intellectuels post-modernes. Quant aux intellectuels libéraux, d’une rigueur admirable, les droits individuels qu’ils défendent sont un outil très efficace pour une industrie de l’information qui vogue depuis longtemps au vent d’une rhétorique du libre choix, du plaisir et de la réussite personnelle. Les algorithmes promettent précisément des contenus toujours plus personnalisés, toujours plus de diversifiés. En réalité, ils soumettent les individus à une standardisation qui les rend exploitables économiquement. L’individualisme libéral, lorsqu’il oublie ses racines historiques et métaphysiques, dissout les communautés, atomise les individus, qui se retrouvent sans ressource pour affronter les déterminismes auxquels on veut les soumettre. Si Habermas offre de bons instruments pour diagnostiquer l’aliénation technoscientifique, l’éthique libérale qu’il promeut aggrave le mal plutôt qu’elle ne le guérit.
Réactiver le politique par une éthique métaphysique
 Dans la hiérarchie des sciences élaborée par Ellis, la métaphysique occupe une double place. En bas, comme théorie «de la réalité ultime», la métaphysique définit l’être en général comme fondement des différents types d’êtres qu’étudient les sciences empiriques. C’est la métaphysique de la substance, des causes, de l’acte et de la puissance. En haut, au sommet des autres sciences, la métaphysique définit les finalités ultimes de l’être, le «sens de la vie». C’est la métaphysique du Bien, des idéaux transcendants. C’est cette métaphysique du Bien qu’il faut réactiver si l’on veut qu’un qu’un discours publique et une action politique sur les finalités des algorithmes, de la technoscience et de la société en général soient possibles. La transcendance du Bien exclut a priori que l’on puisse le saisir avec exactitude et précision, comme les sciences naturelles le font par l’analyse, l’expérimentation et la codification formelle de leur objet. La profusion du Bien et de la Justice excède par définition ce qui peut être formulé et anticipé dans des codes juridiques ou déontologiques. Mais le dialogue critique, mené avec coeur, peut affiner notre intuition du Bien.
Dans la hiérarchie des sciences élaborée par Ellis, la métaphysique occupe une double place. En bas, comme théorie «de la réalité ultime», la métaphysique définit l’être en général comme fondement des différents types d’êtres qu’étudient les sciences empiriques. C’est la métaphysique de la substance, des causes, de l’acte et de la puissance. En haut, au sommet des autres sciences, la métaphysique définit les finalités ultimes de l’être, le «sens de la vie». C’est la métaphysique du Bien, des idéaux transcendants. C’est cette métaphysique du Bien qu’il faut réactiver si l’on veut qu’un qu’un discours publique et une action politique sur les finalités des algorithmes, de la technoscience et de la société en général soient possibles. La transcendance du Bien exclut a priori que l’on puisse le saisir avec exactitude et précision, comme les sciences naturelles le font par l’analyse, l’expérimentation et la codification formelle de leur objet. La profusion du Bien et de la Justice excède par définition ce qui peut être formulé et anticipé dans des codes juridiques ou déontologiques. Mais le dialogue critique, mené avec coeur, peut affiner notre intuition du Bien.
Ellis promeut quant à lui une éthique pacifiste et non-violente, fondée sur une métaphysique théiste inspirée de Simone Weil et René Girard. D’autres thèses de la métaphysique classique doivent aussi être prises en compte: platonisme, aristotélisme, augustinisme, thomisme, kantisme. Le dialogue de l’Occident avec les grandes philosophies orientales n’en est qu’à ses débuts, et doit être approfondi dans les prochaines décennies. Ellis définit comme «métaphysique» les êtres et les idéaux que nous postulons rationnellement sans pouvoir les mesurer expérimentalement. La métaphysique n’est pas une science déductive, monologique, qui parviendrait à des résultats uniques et définitifs. Elle est plutôt une dialectique où un certain nombre de thèses fortes s’opposeront tant qu’il y aura vie et pensée humaines.
La métaphysique classique doit remettre dans leur ordre naturel la fin et les moyens. Elle doit montrer le caractère formel, vide, de l’éthique libérale, dont la finalité est de fournir un cadre procédural à la discussion, non un contenu. Le libéralisme et le formalisme ont rendu de grands services à l’humanité. Ils sont d’excellents outils pour identifier et promouvoir les droits des individus et des minorités. Ces outils ont toutefois des limites. Surtout, ces outils n’ont un usage bénéfique qu’employés à bon escient, avec au préalable une claire conscience du Bien. Ce dont il est question ici, c’est de réactiver une réflexion authentiquement politique sur le Bien commun, réflexion sans laquelle la démocratie ne peut être vivante.
Pour que les sciences humaines dans leur volet critique retrouvent clarté et cohérence, et jouent pleinement leur rôle critique face à la technoscience, les finalités de la société doivent être clarifiées. Pour que des législations puissent être instituées, et que soient civilisés les géants du numérique qui tentent de nous asservir avec leurs algorithmes, la démocratie doit être revitalisée. Les éthiques formelles peuvent servir d’outil de modération, elles peuvent fournir certaines balises pour garantir aux individus et aux minorités un accès à la représentation politique, et une certaine sécurité juridique. Le libéralisme ne peut pas et ne doit pas être simplement rejeté. Une maîtrise des géants du numérique n’est possible que par une action politique, et une action politique n’est possible que par une aspiration à un Bien commun.
C’est pourquoi le libéralisme doit réapprendre à laisser les majorités historiques jouer leur rôle de centres de gravités autour desquels se forment des consensus, imparfaits, certes, mais suffisants pour susciter et légitimer des actions de grande envergure. Le Bien est ce qui est désirable par-dessus tout, ce vers quoi la vie tend confusément et que la raison peut nous aider à clarifier. L’éthique ne doit plus être vue comme un simple garde- fou, une barrière contre les excès, mais à nouveau comme une recherche de la vie bonne. Un retour à une éthique métaphysique, à une recherche dialectique d’un Bien et d’une Justice substantielle serait une libération de nos pulsions sociales, une émancipation de notre besoin de nous engager dans des relations solides et durables. Les algorithmes ne seront soumis à un cadre démocratique que lorsque les réseaux sociaux redeviendront sociaux.
Bibliographie
Ellis, George Francis Rayner. How Can Physics Underlie the Mind ? Top Down Causation in the Human Context, Springer, 2016
Ellis, George Francis Rayner. Murphy, Nancey. On the Moral Nature of the Universe. Cosmology, Theology and Ethics. Fortress Press, 1996
Ellis, George Francis Rayner. True Complexity and its Associated Ontology, 2002, http:// www.math.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/32/Staff/Emeritus_Professors/ Prof_George_Ellis/Overview/wheeler.pdf
Habermas, Jürgen. La technique et la science comme «idéologie», Gallimard, 1973