Identité, langue et religion
Nos ancêtres attachaient plus d’importance à la force que leur apportait la religion qu’aux plaisirs dont elle les privait. Du strict point de vue de l’identité en tant que résistance à la dureté de la vie, la religion en a été ici un facteur déterminant.
Sujet usé, s’il en est un ! Erreur ! Au Québec, mais aussi en France et dans plusieurs autres pays européens, ce sujet est devenu original tant on s’est habitué à exclure la religion de l’équation identitaire. Certes, on continue d’associer la langue à l’identité, mais on a à ce point honte d’avoir pratiqué la religion de Rome qu’on rejette la simple hypothèse qu’elle puisse influer sur l’identité. Quand on reconnaît qu’elle a marqué de façon profonde et durable même les plus modernes d’entre nous, c’est pour préciser ensuite qu’elle persiste dans la mémoire à la manière d’un cauchemar, le cauchemar judéo chrétien. C’est en effet cette expression, toujours accompagnée de mépris, qui illustre le mieux l’attitude dominante à l’endroit de la religion.
Un événement encore chaud a confirmé ce diagnostic : une émission de télévision sur l’identité des Québécois signée Bernard Derome et diffusée lundi le 7 décembre sur les ondes de Télé Québec. Nulle ! Je fais miens ces jugements de Mathieu Bock-Côté et Gilles Proulx sur ladite émission, nulle mais intéressante en tant que symptôme d’un mal en attente de diagnostic. On a placoté – sans se «pogner» comme l’aurait souhaité Fred Pellerin – sur une idée, l’identité, que personne n’a songé à sortir de la confusion dans laquelle l’animateur semblait vouloir la laisser. Personne, sauf peut-être Fred Pellerin en rappelant que la langue est un vernis qui colle si bien à la peau qu’il se confond avec elle.
Il y eut, Dieu merci, des moments heureux dans l’émission, comme la distinction entre l’universel et l’international que Robert Lepage a proposée en précisant bien que l’universel est le rayonnement du particulier. Hélas ! cette solide intuition n’a pas eu d’écho dans le reste des propos de cet auteur plus international qu’universel, ni dans l’ensemble de l’émission. Depuis que je l’ai vue, je n’arrive pas à chasser de mon esprit les pages les plus atrocement belles et vraies jamais écrites sur le multiculturalisme. Elles se trouvent dans le chapitre du Zarathoustra intitulé Du pays de la civilisation :
Couverts des signes du passé et barbouillés de nouveaux signes : ainsi vous êtes-vous bien cachés de tous les augures! Et quand même on saurait scruter les entrailles, à qui donc feriez-vous croire que vous avez des entrailles ? Vous semblez pétris de couleurs et de bouts de papier assemblés à la colle.
Tous les temps et tous les peuples jettent pêle-mêle un regard à travers vos voiles; toutes les coutumes et toutes les croyances parlent pêle-mêle à travers vos gestes. […]
Toutes les époques déblatèrent les unes contre autres dans vos esprits; et les rêves et les bavardages de toutes les époques étaient plus réels encore que vos veilles!»
À la décharge de Bernard Derome, reconnaissons que l’identité est une notion difficile. Elle est ce qui fait de nous un être unique, elle est l’unité dans la diversité de qualités telles que l’authenticité, la densité, l’originalité, la présence, la résistance au malheur, etc. On peut aussi la définir par rapport au domaine à laquelle on l’applique. L’identité peut en effet être féminine, gaie, trans, religieuse, culturelle, religieuse, etc.
Je me limite ici à une des qualités constitutives de l’identité comme unité : la résistance. Et je choisis comme guide une jeune femme aux mœurs libres et nobles qui, sur ce plan, n’aurait rien eu à attendre de notre révolution tranquille : Etty Hillesum.
Au cours de la décennie 1940, il existait en Hollande un camp appelé Westerbork où l’on rassemblait les juifs avant leur déportation vers Auschwitz et autres destinations du même genre. Etty Hillesum a séjourné dans ce camp avant d’aller mourir à Auschwitz en 1943 à l’âge de 27 ans. Qui est donc cette jeune femme ? On la compare spontanément à Simone Weil, morte à Londres la même année, 1943, à l’âge de 33 ans. L’une et l’autre ont laissé une œuvre qui porte la marque du génie, un génie apparenté à celui de Marc-Aurèle, dans le cas de la première, à Platon dans le cas de la seconde.
L’une et l’autre ont abordé la question de l’identité d’une manière radicale en posant la question suivante : qu’est-ce qui subsiste en nous quand notre personnage, sinon notre personne, s’est effondré devant le malheur ? Nous avons déjà eu l’occasion de présenter la pensée de Simone Weil. Voici un passage des Lettres de Westerbork où Etty Hillesum évoque l’arrivée au camp de notables des grandes villes hollandaises :
Ils longent les minces barbelés, et leurs silhouettes vulnérables se découpent en grandeur réelle sur l'immense plaine du ciel. Il faut les avoir vus marcher ainsi…
La solide armure que leur avaient forgée position sociale, notoriété et fortune est tombée en pièces, leur laissant pour tout vêtement la mince chemise de leur humanité. Ils se retrouvent dans un espace vide, seulement délimité par le ciel et la terre et qu'il leur faudra meubler de leurs propres ressources intérieures – il ne leur reste plus rien d'autre.
On s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne suffit pas, dans la vie, d'être un politicien habile ou un artiste de talent. Lorsqu'on touche au fond de la détresse, la vie exige bien d'autres qualités. Oui, c'est vrai, nous sommes jugés à l'aune de nos ultimes valeurs humaines.» 1
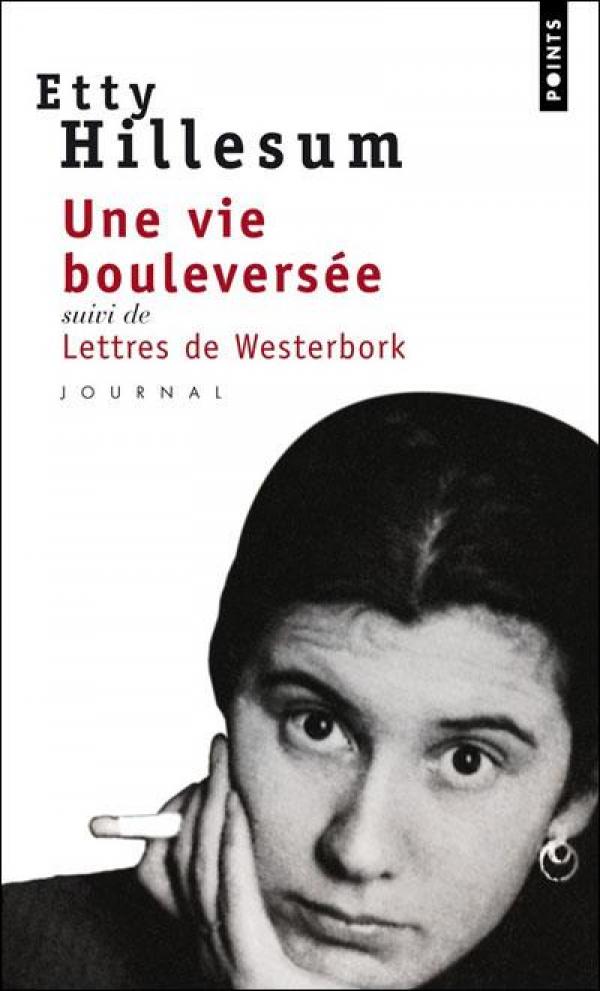 Etty Hillesum a témoigné dans son œuvre de ces ultimes valeurs humaines, et plus qu’humaines dans son cas. On est émerveillé de la voir à la fois si lucide devant les malheurs de son temps et de son milieu et si apte à en tirer de la joie. Elle était infiniment sensible à beauté, à celle des poèmes de Rilke, comme à celle de la nature. Les nazis ont inventé un supplice spécial pour de tels êtres : à la périphérie des villes hollandaises, on interdisait aux Juifs les routes conduisant aux plus beaux paysages. Au lieu de s’en plaindre, elle regardait avec plus d’attention le coin de ciel bleu auquel son regard avait encore accès.
Etty Hillesum a témoigné dans son œuvre de ces ultimes valeurs humaines, et plus qu’humaines dans son cas. On est émerveillé de la voir à la fois si lucide devant les malheurs de son temps et de son milieu et si apte à en tirer de la joie. Elle était infiniment sensible à beauté, à celle des poèmes de Rilke, comme à celle de la nature. Les nazis ont inventé un supplice spécial pour de tels êtres : à la périphérie des villes hollandaises, on interdisait aux Juifs les routes conduisant aux plus beaux paysages. Au lieu de s’en plaindre, elle regardait avec plus d’attention le coin de ciel bleu auquel son regard avait encore accès.
Les valeurs ultimes d’Etty Hillesum sont le cœur d’une vie indissociablement spirituelle, intellectuelle et affective gravitant autour de ce qu’elle ose appeler son âme. Amour de Dieu, amour humain ? Cette question perd tout sens dans le cas de Etty tant son amour de Dieu et son amour des hommes se nourrissent l’un de l’autre. «Tout mon être est en train de se métamorphoser en une grande prière pour lui», écrit-elle à propos de celui qui fut son amour salvateur, le chirologue Julius Speir, lui-même élève et disciple de Jung. 2
Cette juive a horreur de la loi du talion. La vengeance est une greffe qui ne prend pas sur elle. Un seul allemand faisant preuve d’humanité rachetait à ses yeux tous les suppôts d’Hitler. «Au camp, j’ai senti que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore. Et je pense avec une naïveté puérile peut-être mais tenace que si cette terre redevient un jour tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le Juif Paul a parlé jadis aux habitants de Corinthe.»
Retenons que non seulement elle n’a pas implosé sous le malheur, comme les vedettes, mais qu’elle s’est faite à son contact. Qui donc a dit, «nous ne sommes pas faits pour le malheur, mais par le malheur?» Dans sa balance intérieure, ce qu’elle avait reçu et recevait encore de la vie pesait toujours plus que ce que la vie lui enlevait. Ajoutons, pour les fins de notre propos, que jamais elle n’éprouvait si fortement le désir de bien écrire que lorsqu’elle voulait trouver le ton lui permettant de communiquer sa joie dans toute sa vérité, c’est-à-dire purgée de tout besoin de consolation ou de compensation. Et si elle s’adresse à Dieu par la prière ce n’est jamais pour lui demander des choses pour elle-même, sinon la force de rester tournée vers l’autre. C’est pour lui-même qu’elle aimait Dieu et non pour son ciel.
Voilà comment une vie de l’esprit qui fut aussi une vie de l’âme a permis à Etty Hillesum de conserver son identité dans le danger extrême.
L’histoire du Québec a été une longue période d’austérité, ponctuée de fêtes arrachées non au malheur mais à une vie qui, sauf exception, ne cessait jamais d’être dure. Qui voudrait, qui pourrait nier que le Dieu de saint Paul a contribué à leur forger à ces paysans, ces bûcherons, ces pêcheurs une âme, une citadelle intérieure capable de résister à la pression extérieure ? C’est à cette citadelle que pensait sans doute ce bon jésuite, professeur de physique au collège Sainte-Marie. Lors de son cours inaugural, il demandait à ses élèves de tenter d’enfoncer par des coups de poing une boite de fer blanc posée sur son pupitre. La boite demeurait intacte malgré la force des coups. Il mettait alors la pompe à vide en action. Montrant la boîte qui implosait, il lançait cet avertissement à ses élèves : «Voici ce qui vous arrivera, si vous n’avez ni vie, ni densité intérieure.» Ce que Nietzsche appelait des entrailles.
Nos ancêtres attachaient plus d’importance à la force que leur apportait la religion qu’aux plaisirs dont elle les privait. Du strict point de vue de l’identité en tant que résistance à la dureté de la vie, la religion en a été ici un facteur déterminant. C’est ce que nous rappellent tous nos classiques de Maria Chapdelaine, à Menaud, de Menaud au Survenant, du Survenant à Un homme et son péché. Dans le documentaire de Bernard Derome, c’est Boucar Diouf qui semblait avoir le mieux compris ces classiques: «C’est un gros problème : les Québécois n’aiment pas l’adversité. On bat en retraite très vite. Dès que la marmite commence à bouillir, on ferme. J’aurais aimé qu’on soit un peu plus guerrier. Pas dans le sens militaire du terme, mais juste de tenir son bout.»
La résistance d’Etty Hellisum dans un camp nazi est un exemple extrême et ce serait peut-être trop demander à un peuple que d’en faire le fondement de son éducation. Nous n’avons pas besoin d’une telle vertu héroïque pour mener une bonne vie dans une société comme la nôtre. Mais si l’on veut bien admettre que la sagesse en éducation consiste à prévoir le pire et à s’y préparer, si l’on admet aussi que l’exemple le plus élevé est souvent nécessaire pour affronter la plus petite épreuve, on admettra aussi qu’une Etty Hillesum ou une Marie de l’Incarnation ne sont pas un luxe dans une société, mais une nécessité.
Libre à chacun malgré cela d’avoir honte des Maria Chapdelaine et de considérer la résistance comme une vertu réactionnaire sans application dans une société évoluée comme la nôtre.
Mais êtes-vous sérieux amis indépendantistes quand vous me dites que nous n’aurons pas besoin de cette force d’âme pour faire l’indépendance ? C’est bien ce que vous me dites quand vous vous étalez votre mépris pour le passé religieux du Québec.
Sommes-nous donc vraiment «les fils déchus d’une race surhumaine» ? Comparaison n’est pas toujours raison. Se pourrait-il que le cumul du travail et de la famille rende la vie des femmes d’aujourd’hui plus dure que celle des mères de dix enfants dans le Québec d’hier ? Au rythme toutefois où nous consommons les antidépresseurs, nous sommes dans l’obligation de nous demander si nous résisterions mieux que les vedette hollandaises aux malheurs des camps nazis.
La révolution tranquille
Cela étant dit, la révolution tranquille est venue à son heure. Trois siècles d’efforts continus justifiaient bien une entrée triomphale dans une ère hédoniste allégeant les nécessités de la reproduction et de la survie. Encore eût-il été souhaitable que cette ère favorable produise de ces œuvres de premier ordre dont on a absolument besoin dans les temps durs. Sur cette question de justice culturelle entre les générations, Etty Hillesum a écrit une page inoubliable :
Produire des œuvres essentielles, qu’on pourrait lire, en des temps moins favorables pour résister au malheur, n’était-ce pas la mission du Québec d’après 1960 ? A-t-elle été remplie ? Certaines pensées de Dany Laferrière, entendues à la radio, m’ont semblé avoir atteint cette altitude. Sans doute son œuvre romanesque, que je connais mal, en contient-elle beaucoup d’autres. Mais pour trouver de telles perles, je me tourne d’abord vers Pierre Vadeboncoeur, Fernand Dumont, Jean-Paul Desbiens, Gilles Vigneault, Pierre Perrault, tous des artisans de la révolution tranquille ayant conservé un lien organique avec le passé.
Rompre radicalement et définitivement avec un tel passé est un acte comportant les plus grands risques pour tout un peuple comme pour les individus. Il est heureusement possible que le transcendant porté par une grande religion puisse se survivre à lui-même à travers une philosophie ou une spiritualité. Etty Hillesum avait comme mentor un athée qui lisait la Bible et saint Augustin. C’est là une voie que de nombreux Québécois ont choisie, une voie si difficile toutefois que les élus qui y ont accès ont besoin des cantiques de Noël pour se rattacher à une communauté plus vaste.
Le style a l'élévation de la pensée
Reste la langue comme facteur d’identité. On doit se demander toutefois si ce n’est pas le sens du transcendant qui donne aux hommes le souci de la perfection de la langue ? N’est-ce pas pour dire le Bien le plus pur et le plus élevé qu’on a besoin des mots les plus justes, les plus vivants et les plus harmonieux ? On ne se donne le mal de bien écrire que lorsqu’on a de belles choses à dire. Platon, ce passionné du Bien pur, charme encore par son style ceux qui le lisent aujourd’hui en traduction. «Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source.» C’est le conseil que donnait Rilke au jeune poète Kappus. Ce conseil, Etty Hillesum qui l’a entendu mille fois, ne pouvait que le suivre.
«Une estampe japonaise. Je voudrais n'écrire que des mots insérés organiquement dans un grand silence, et non des mots qui ne sont là que pour dominer et déchirer ce silence. En réalité les mots doivent accentuer le silence. Comme cette estampe avec une branche fleurie dans un angle inférieur. Quelques coups de pinceau délicats – mais quel rendu du plus infime détail ! – et tout autour un grand espace, non pas un vide, disons plutôt : un espace inspiré. Je hais l'accumulation des mots. Il faut si peu de mots pour dire les quelques grandes choses qui comptent dans la vie. »4
Certes, le sens de l’absolu au cœur de la vie religieuse n’est pas l’unique source d’incitation à la perfection de la langue. Lucrèce, Nietzsche et tant d’autres grands écrivains sont là pour témoigner d’un autre type d’appel à l’écriture achevée. Quiconque a remis cent fois un texte sur le métier a compris à jamais, qu’il soit athée ou croyant, que cette recherche gratuite de la perfection est une manifestation de ce qu’on appelle le sens de l’absolu. C’est un tel sens de l’absolu que Bossuet tentait d’inculquer au dauphin de France dont il était le précepteur.
«Ne croyez pas, monseigneur, qu’on vous reprenne si sévèrement pendant vos études, pour avoir simplement violé les règles de la grammaire en composant. Il est sans doute honteux à un prince, qui doit avoir de l’ordre en tout, de tomber en de telles fautes ; mais nous regardons plus haut quand nous en sommes si fâchés ; car nous ne blâmons pas tant la faute elle-même, que le défaut d’attention, qui en est la cause.
Ce défaut d’attention vous fait maintenant confondre l’ordre des paroles ; mais si nous laissons vieillir et fortifier cette mauvaise habitude, quand vous viendrez à manier, non plus les paroles, mais les choses mêmes, vous en troublerez tout l’ordre.»
1_Etty Hillesum, Une vie bouleversée, Paris, Seuil 1995, p.269
2- Ibid.158
3- Ibid 245
4- Ibid 121






