All’ épi paideia
En donnant à son article un titre grec, All’ épi paideia, Olivier Reboul disait son attachement à la culture classique. Il allait ensuite de soi que sa préférence aille à un corpus unique plutôt qu’à une polyvalence, une optionnalité, dissolvantes à ses yeux
Un titre en grec a de quoi surprendre. Mais ces trois mots de Platon sont proprement intraduisibles. On les trouve au début du Protagoras (312b), là où Socrate demande au jeune Hippocrate ce qu'il attend de l'enseignement du grand sophiste. Je donne ce passage dans la version d'A. Croiset :
En vue de ta culture » all' épi paideia: on pourrait aussi bien traduire « en vue de ton éducation », ou « dans un but éducatif », ou même « pour l’éducation ». En tout cas l'idée est claire ; il ne s'agit pas pour l'étudiant de devenir un professionnel de la grammaire, de la musique ou du sport, mais de se former librement par la pratique désintéressée de ces techniques. L'éducation n'a pas de but extérieur à elle-même : elle n'a d'autre fin que l'éducation.
Il s'agit là d'un concept-clé de notre civilisation. On le retrouve dans l'éducation romaine comme dans la paideia hellénistique, dans l'université médiévale comme dans les collèges de l'époque classique, dans le Gymnasium allemand comme dans le lycée français du 19e siècle ; de nos jours il inspire aussi bien le thomiste Maritain que le libre-penseur Alain. L'expression de Socrate demeure comme ce qui distingue l'éducation et l'enseignement de tout ce qui n'est que dressage, apprentissage, endoctrinement, de tout ce qui façonne l'homme en organe de l'Etat ou de l'Eglise, en outil au service de la production. L'éducation n'a d'autre fin que l’éducation : autrement dit, d'autre fin que l'homme.
Une telle conception a toujours rencontré des adversaires. Ils sont aujourd'hui si nombreux et si divers qu'on ose à peine écrire le mot « culture ». Il s'agit pourtant d'ouvrir le débat et d'examiner successivement ces critiques selon leur origine et leur inspiration respectives.
Le refus politique
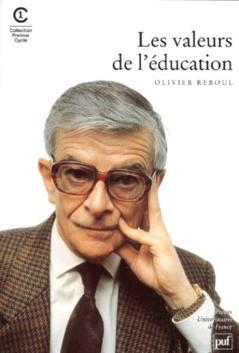 La protestation contre la culture est avant tout d'ordre politique. Il y a vingt ans, les milieux de gauche et d'extrême gauche considéraient encore l'école et l'université comme des foyers de lumière et d’émancipation : il arrivait souvent que les professeurs fussent à gauche de leur classe. Aujourd'hui il est fréquent de dénoncer « le pouvoir enseignant » comme l'organe le plus insidieux et le plus nocif du pouvoir. On ne conteste pas seulement les professeurs, mais les savoirs et les valeurs qu'ils transmettent, qui constitueraient la répression la plus subtile et la plus efficace de la révolte et du désir chez les jeunes, assurant ainsi leur insertion dans l'ordre bourgeois. La culture ne signifie plus alors formation, mais déformation, intégration et conformisme ; elle ravale l'éducation à la reproduction des normes et des clivages d'une société foncièrement aliénante.
La protestation contre la culture est avant tout d'ordre politique. Il y a vingt ans, les milieux de gauche et d'extrême gauche considéraient encore l'école et l'université comme des foyers de lumière et d’émancipation : il arrivait souvent que les professeurs fussent à gauche de leur classe. Aujourd'hui il est fréquent de dénoncer « le pouvoir enseignant » comme l'organe le plus insidieux et le plus nocif du pouvoir. On ne conteste pas seulement les professeurs, mais les savoirs et les valeurs qu'ils transmettent, qui constitueraient la répression la plus subtile et la plus efficace de la révolte et du désir chez les jeunes, assurant ainsi leur insertion dans l'ordre bourgeois. La culture ne signifie plus alors formation, mais déformation, intégration et conformisme ; elle ravale l'éducation à la reproduction des normes et des clivages d'une société foncièrement aliénante.
La culture serait donc bourgeoise à deux titres. D'abord comme source de sélection : la difficulté même des modèles qu'elle propose permet à la classe dirigeante de recruter, parmi les enfants qui parviennent à s'y plier, la petite élite qui assurera sa relève ; les autres enfants, ceux que la culture rebute, c'est-à-dire l'immense majorité, n'ayant d'autre perspective que d'être des prolétaires soumis. Ensuite comme principe de conformation, d'identification à des modèles anciens qui assurent depuis longtemps la stabilité de l'ordre social, le refus de tout changement réel. Conclusion : une révolution ne peut réussir que si elle est culturelle, et non simplement économique et politique. Il ne s'agit pas seulement de combattre les forces extérieures de la répression, comme la police, mais d'extirper de l'esprit des jeunes ce qui peut les rendre victimes consentantes ou complices de la répression. Il s'agit de détruire l'organe le plus subtil mais aussi le plus fragile de la société bourgeoise : l'enseignement. Ceci en dénigrant les modèles qu'il propose, en sapant l'autorité de ses maîtres, en instaurant face à l'institution un enseignement parallèle et critique qui la fera paraître absurde et vaine.
Un tel projet ne va pas sans équivoques. Est-on bien sûr d'abord que cette destruction de l'enseignement et de la culture ne rejoint pas la pensée réactionnaire, ne comble pas ses vœux les plus secrets ? Lorsqu'un homme de théâtre, A. Gatti, écrit : « Molière, Shakespeare représentent une forme d'oppression supplémentaire » (dans Le monde, du 21 X 1971, p. 17), il me rappelle que le gouvernement fasciste de Vichy avait déjà interdit le Tartufe de Molière ! Le vandalisme qui saccage les œuvres humaines, les conquêtes par lesquelles l'homme s'est au cours des âges libéré, n'est pas révolutionnaire mais fasciste. Loin de déranger le moins du monde la classe dirigeante, il voue les masses à l'ignorance, il en fait la proie de tous les manipulateurs. Les gouvernements bourgeois du 19e siècle, à commencer par Napoléon, se défiaient de la culture comme de la peste : ils voulaient pour l'élite un enseignement positif et professionnel, formant de bons ingénieurs et de bons officiers, et pour la masse un endoctrinement religieux capable de la tenir en lisière. Aujourd'hui encore, dès qu'une dictature s'installe quelque part, ce sont les intellectuels, les philosophes, les penseurs qu'elle enferme en premier.
« Le savoir c'est fini, déclare Philippe Labro ; la culture aujourd'hui, ça consiste à parler ». Mais de quoi, mais comment, mais à qui ? Ces apôtres du non-savoir ou de l'anti-culture en reviennent au mythe infantile du bon sauvage. Ils ne voient pas que la non-culture ne signifie absolument pas la virginité intellectuelle, la disponibilité heureuse à tout ce qui est nouveau et révolutionnaire, la créativité absolue: la non-culture, c'est une autre culture, une sous-culture; non pas la vierge ignorance du bon sauvage ou la merveilleuse spontanéité de l'enfant, mais un langage trop confus et trop pauvre pour communiquer et comprendre, mais la masse aveugle des préjugés qu'inculquent les média, mais le conformisme étroit, buté, fanatique, dont le pouvoir fasciste sait si bien tirer parti.
On dira que la culture est « bourgeoise » dans son contenu. Je ne pense pas que Shakespeare soit bourgeois, ni Molière, ni Mozart, pas plus qu'Euclide ou Newton. Ce n'est pas la culture en elle-même qui est proprement bourgeoise, mais le fait qu'elle soit confisquée par une classe privilégiée qui s'en sert pour dominer. Car ceux qui dominent sont toujours et sans exception ceux qui savent, ceux qui sont capables de communiquer, de rédiger, de comprendre. L'inégalité de la culture est sans doute plus injuste que toutes les inégalités économiques. Citons ici un propos de A. S. Neill :
Je pense des mathématiques ce que je pense du latin et du grec : quel est le but de l'enseignement des équations algé¬briques à des garçons qui répareront des automobiles ou vendront des cravates ? C'est de la folie.[1]
On se demande si un tel mépris de la culture n'est pas foncièrement réactionnaire. Car enseigner les mathématiques pures aux mécaniciens, c'est leur montrer que l'esprit n'est jamais tenu d'obéir sans comprendre, que la vérité n'est jamais ce qu'on croit sur parole. De même la formation littéraire et artistique est aujourd'hui indispensable si l'on veut que les jeunes ne soient pas esclaves de la publicité et de la propagande, si l'on pense qu'ils doivent pouvoir analyser, juger par eux-mêmes, exprimer leurs critiques et leur revendication, si l'on admet enfin qu'ils ont le droit de profiter de leur loisir non en consommateurs abrutis, mais en hommes.
Si l'on veut vraiment émanciper les jeunes, il faut leur donner non seulement une information mais une formation, afin qu'ils puissent juger par eux-mêmes et rompre les chaînes du consentement. Si l'on veut réellement changer la société, il faut accorder la culture à tous, et non aux enfants de la classe dirigeante. Comme disait déjà Alain, nous n'avons pas besoin « d’une élite éclairée ; nous avons besoin d'un peuple éclairé ». Un peuple manipulé ou un peuple éclairé : il faut choisir.
Le refus pragmatiste
Le refus le plus redoutable n'est pourtant pas celui des gauchistes, qui font encore à la culture l'honneur de la trouver dangereuse, c'est celui des pragmatistes de tout genre, qui se bornent à la rejeter parce qu'elle ne sert à rien. Pourquoi, disent-ils, contraindre les étudiants à des études « désintéressées » ... et qui en fait ne les intéressent guère, au lieu de leur donner la formation spécialisée dont eux et leur pays ont tant besoin ? Jusqu'à une époque récente, l'enseignement classique au Québec s'inspirait d'une philosophie méprisant la réussite matérielle, tournée vers les valeurs du passé, cultivant la scolastique au détriment des techniques et même des sciences positives. Une telle idéologie n'a pas peu contribué, on le sait, à priver le Québec des leviers de son économie. (Il faut dire qu'il s'agissait moins d'un enseignement que d'un endoctrinement). Ne peut-on attendre de l'enseignement qu'il permette à chacun de jouer un rôle efficace dans la production nationale ? N'est-il pas aussi important d'être maître de l'outil que de la langue ? Préparer l'avenir n'est-il pas plus urgent que sauvegarder le passé ?
Reprenons successivement les trois thèses majeures du pragmatisme : 1) le primat de l'enseignement technique et professionnel sur les humanités classiques ; 2) l'exigence que toute matière enseignée soit utile et efficace ; 3) le refus du passé au nom du présent, du souvenir au nom de l'avenir.
1 — C'est un truisme aujourd'hui que de rappeler l'importance de la formation technique et professionnelle. La question est de savoir si une telle formation doit venir après l'enseignement ou à la place. Il me semble que cette dernière option revient à un formidable pas en arrière : à vouer les enfants et les adolescents à ce dont l'école publique était censée les délivrer, à l'apprentissage. L'apprentissage enferme l'enfant dans un travail servile : il peut être formateur, mais c'est par accident, et il déforme aussi bien. L'apprentie dactylographe exerce ses doigts comme l'apprentie pianiste ; mais la première n'a pas pour but de développer son habileté manuelle, encore moins son sens esthétique ; elle est au service de la machine ; on la forme pour une fin qui n'est pas en elle. Par là même l'apprentissage n'instruit pas ; dans la méthode qui prévaut ici, dite d'essais et erreurs, l'erreur n'est qu'une faute, un échec dont le sens est de s'éliminer au plus vite ; l'apprenti acquiert alors un savoir-faire qui ne bougera plus, une mentalité qui ne changera plus. Toute initiative, toute invention, tout zèle même sont suspects, risquant de gâcher du temps, des machines, de l'argent. Et l'apprenti prend vite l'habitude d'obtenir un résultat correct, et de s'y tenir, avec une prudence conservatrice qui le retient d'oser, de réfléchir, de penser. « C’est le résultat qui compte » et le résultat n'est pas l'intelligence, le caractère, le cœur de l'apprenti, mais le rendement de ses actes.
C'est pourquoi je me méfie de ceux qui veulent remplacer le mot enseignement par apprentissage, traduisant ainsi l'anglais training qui a pourtant un sens bien plus étendu. Les mots ne sont pas innocents, en tout cas ceux qui les emploient ! Certes l'image du petit apprenti dans son échoppe, terrorisé à l'idée de se faire taper sur les doigts, appartient au passé. Mais il y a encore des apprentis ; il y a encore une conception de l'enseignement qui pense moins au développement de l'élève qu'à son utilisation comme futur agent de production ; il y a encore des pouvoirs qui préfèrent dominer des esclaves utiles et dociles, plutôt que d'affronter des hommes intelligents et libres.
A ces considérations de principe, on peut ajouter deux remarques concrètes. D'abord l'économie change à une telle vitesse qu'il est impossible de prévoir quel sera le marché du travail dans une génération. L'important est donc moins de donner aux jeunes une technique spécialisée, que de leur apprendre à se spécialiser, à se recycler — ce qui implique une culture de base. Ma seconde remarque porte sur les pays sous-développés, qui sont vraiment au cœur du problème. On objectait au président Bourguiba que la Tunisie, pour sortir du sous-développement, avait besoin non de gens connaissant l'arabe classique, le français et la philosophie, mais de techniciens et d'ingénieurs. Et Bourguiba de répondre : le sous-développement est aussi et peut-être avant tout une structure de l’esprit ; et seul un enseignement fondé sur les sciences théoriques, le français littéraire et la philosophie aura raison de cette structure retardataire et permettra au pays de démarrer. Puissions-nous, au rebours, ne pas tomber dans quelque sous-développement.
2 — Une autre forme du pragmatisme consiste à n'envisager les matières enseignées que selon leur utilité immédiate ou lointaine, et à les transformer dans ce sens. Sans doute est-il bon que l'élève sente que ce qu'il apprend sert à quelque chose, a un intérêt en soi. Et je me méfie beaucoup de ces pédagogues qui voient dans les matières enseignées une pure gymnastique, un exercice qui prépare à quelque chose que l'élève n'a pas à connaître. Apprendre une langue étrangère sans jamais s'en servir, analyser des morceaux choisis d'auteurs sans avoir le droit de connaître la suite, a quelque chose d'écœurant. Un certain enseignement dogmatique et desséché détruit la culture d'une manière bien plus efficace que toutes les imprécations gauchistes. Laurence Olivier a plus fait pour Hamlet et Gérard Philippe pour Le Cid que des générations de professeurs. Il est tragique que la culture soit si souvent dispensée par une pédagogie qui la rend odieuse ou fastidieuse. Mais est-ce la faute de la culture, ou de l'inculture des pédagogues ?
Maintenant il faut dire aussi qu'un pseudo-utilitarisme aboutit à détruire l'utilité véritable que l'on peut trouver dans l'étude. La grande réussite de «la mathématique moderne » me paraît consister en ceci qu'elle a rendu cette discipline intéressante, au sens fort où ceux qui l'apprennent se sentent concernés par ce qu'ils font : c'est qu'au lieu d'inculquer des mécanismes utiles mais aveugles, on s'attache à faire construire, c'est-à-dire comprendre. Il est dommage qu'un tel esprit ne soit pas plus répandu ailleurs. Il me semble qu'un enseignement purement utilitaire, comme le français administratif ou l'anglais commercial, est doublement fautif : d'abord parce qu'on renonce à éduquer, à former l'intelligence et le cœur ; ensuite parce que les jeunes ne sont pas motivés par un tel enseignement tant qu'ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent l’utiliser ; on oublie très vite une langue étrangère dès qu'on n'a pas à s'en servir. Ce que l'école doit d'abord révéler aux étudiants, c'est la beauté d'une langue. Ils apprendront à la pratiquer quand ils en auront vraiment besoin.
3 — C'est pourquoi je n'approuve pas ceux qui, sous prétexte d'être actuels et de préparer l'avenir, rejettent Shakespeare et Molière, Platon et Kant, pour les derniers auteurs à la mode. Peut-on « évoluer avec son temps » si l'on ne connaît que son temps ? Supposons un écolier de 1925 à qui on n'aurait enseigné que les auteurs, les philosophes, les musiciens en vogue à son époque ; ce sexagénaire serait-il vraiment armé pour comprendre la nôtre et évoluer avec elle ? Comprendre son temps exige du recul, un recul que seules peuvent donner les sciences qui prépare à quelque chose que l'élève n'a pas à connaître. Apprendre une langue étrangère sans jamais s'en servir, analyser des morceaux choisis d'auteurs sans avoir le droit de connaître la suite, a quelque chose d'écœurant. Un certain enseignement dogmatique et desséché détruit la culture d'une manière bien plus efficace que toutes les imprécations gauchistes. Laurence Olivier a plus fait pour Hamlet et Gérard Philippe pour Le Cid que des générations de professeurs. Il est tragique que la culture soit si souvent dispensée par une pédagogie qui la rend odieuse ou fastidieuse. Mais est-ce la faute de la culture, ou de l'inculture des pédagogues ?
Maintenant il faut dire aussi qu'un pseudo-utilitarisme aboutit à détruire l'utilité véritable que l'on peut trouver dans l'étude. La grande réussite de «la mathématique moderne » me paraît consister en ceci qu'elle a rendu cette discipline intéressante, au sens fort où ceux qui l'apprennent se sentent concernés par ce qu'ils font : c'est qu'au lieu d'inculquer des mécanismes utiles mais aveugles, on s'attache à faire construire, c'est-à-dire comprendre. Il est dommage qu'un tel esprit ne soit pas plus répandu ailleurs. Il me semble qu'un enseignement purement utilitaire, comme le français administratif ou l'anglais commercial, est doublement fautif : d'abord parce qu'on renonce à éduquer, à former l'intelligence et le cœur ; ensuite parce que les jeunes ne sont pas motivés par un tel enseignement tant qu'ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent l’utiliser ; on oublie très vite une langue étrangère dès qu'on n'a pas à s'en servir. Ce que l'école doit d'abord révéler aux étudiants, c'est la beauté d'une langue. Ils apprendront à la pratiquer quand ils en auront vraiment besoin.
3 — C'est pourquoi je n'approuve pas ceux qui, sous prétexte d'être actuels et de préparer l'avenir, rejettent Shakespeare et Molière, Platon et Kant, pour les derniers auteurs à la mode. Peut-on « évoluer avec son temps » si l'on ne connaît que son temps ? Supposons un écolier de 1925 à qui on n'aurait enseigné que les auteurs, les philosophes, les musiciens en vogue à son époque ; ce sexagénaire serait-il vraiment armé pour comprendre la nôtre et évoluer avec elle ? Comprendre son temps exige du recul, un recul que seules peuvent donner les sciences fondamentales et les grands auteurs. Ce qui n'est que mode est vite démodé.
Et j'ai bien peur qu'un étudiant qui passe tout son cours de philosophie à discuter sur le manifeste du F.L.Q. ne soit plus tard aussi ridicule que ne le serait un étudiant d'il y a 50 ans qui ne connaîtrait d'autres textes que les discours de Wilfrid Laurier !
Une formation professionnelle et spécialisée prolonge l’éducation ; elle ne peut en aucun cas la remplacer, car l'éducation a pour fin l'étudiant lui-même : l'éveil de son intelligence, raffinement de sa sensibilité, la formation de son jugement personnel. Et sans cette formation de base, la formation professionnelle elle-même risque d'être manquée, car elle ne donnera jamais que des spécialistes étroits et bornés, incapables de se recycler, d'apprendre, de comprendre — de s'adapter à leur temps !
Le refus pédagogique
Un refus plus insidieux de la culture vient des pédagogues eux-mêmes. Ils affirment certes qu'on doit éduquer les étudiants pour eux-mêmes et non pour la société, mais ils nient que la culture libérale, telle qu'on la conçoit depuis Platon, puisse y servir en quoi que ce soit. Ils rejettent la culture au nom de l'éducation. Une telle conception se retrouve dans deux écoles, pourtant opposées l'une à l'autre, les behavioristes et les non-directifs.
1 — Le behaviorisme a tendance à nier que l'acquisition d'un savoir-faire puisse faciliter celle d'un savoir-faire différent : il n'y a de transfert que dans des situations identiques ; sinon le transfert est d'ordre négatif. Autrement dit, un savoir acquis perturbe l'acquisition de savoirs analogues et pourtant différents. Par exemple la secrétaire habituée à un type de clavier sera perturbée devant une machine à clavier différent ; un violoniste sera perturbé s'il apprend le violoncelle, où l'écart des doigts est plus grand ; un étudiant sachant l'anglais fera plus de fautes qu'un autre en apprenant l'allemand, etc. De ces constatations, d'ailleurs discutables, on en vient à nier l'idée même de culture générale, c'est-à-dire d'une formation utilisable dans des situations différentes de celles où on l'a acquise. Thorndike affirme ainsi que les disciplines intellectuelles ne développent pas plus l'intelligence que les pratiques :
Une année d'entraînement en cuisine, en couture, en éducation physique ou en tenue de bibliothèque a à peu près autant d'effet sur «la puissance générale de penser » qu'un enseignement d'égale importance en algèbre, morale, physique ou latin.[2]
On préconise donc une pédagogie qui rejette la culture abstraite au nom du concret, de la spécialisation, qui veut rendre les activités scolaires aussi proches que possible de la « vie réelle », comme l'artisanat, l'anglais parlé, etc.
J. Château, après bien d'autres, a montré l'inanité d'une telle théorie. Retenons ici une de ses expériences : on fait passer à deux groupes, chacun de 85 jeunes adultes, deux séries de tests d'intelligence d'abord, puis d'aptitude technique. Le premier groupe, composé d'étudiants avancés, manifeste une supériorité écrasante aux tests d'intelligence sur le second groupe, composé de jeunes ouvriers qualifiés ; mais même dans les tests techniques les étudiants montrent encore une légère supériorité.[3] C'est que la culture permet justement de s'adapter à des situations nouvelles, insolites, par le fait même qu'elle donne et donne seule à l'étudiant deux aptitudes d'ailleurs étroitement solidaires : une maîtrise de soi et une méthode.
Je ne puis aborder ici la question de savoir quelles sont les disciplines scolaires qui offrent la « transférabilité maximale », i.e. qui forment le plus à la méthode et à la maîtrise de soi. Je me borne à signaler les conclusions de Château: 1) un enseignement utilisant des symboles: mathématiques, cartes de géographie, analyse littéraire, traduction, facilite bien plus l'analyse et le transfert qu'un enseignement borné au «concret», à l'anecdote, à l'image, au vécu; 2) une structure acquise n'est vraiment assimilée et donc transférable que si elle a été, dans une certaine mesure, oubliée; trop fraîche et trop présente, elle perturbe au lieu d'aider; pour paraphraser une phrase célèbre, je dirais qu'il y a culture parce qu'on a tout oublié; 3) une structure n'est transférable que si elle n'éveille pas un intérêt violent; la passion, le sérieux excessif, le fanatisme bloquent l'esprit au lieu de l'ouvrir à des expériences différentes et de l'adapter à des situations neuves.[4]
2 — Les pédagogues qui s'inspirent plus ou moins de la non-directivité nous posent un autre problème. Je ne discute pas ici de leurs méthodes, qui à certains égards sont plus favorables à la culture que les procédés autoritaires : car le but de l'enseignement est de donner le goût de ce qu'on enseigne, non d'en dégoûter. Je me borne à mettre en question deux concepts, qui semblent liés aux méthodes non directives, celui de créativité et celui d'optionnalité.
La créativité est un concept moderne et, en un sens, polémique ; on l'oppose à l'initiation et au culte des modèles, caractéristiques non seulement de l'enseignement mais de la culture classique. De plus en plus le texte libre remplace la rédaction, le dessin libre le dessin d'initiation, la libre discussion le cours magistral. Libérer le potentiel créateur qui se trouve dans chaque enfant est sans doute la fin la moins discutable de l'éducation. Le danger est d'oublier qu'une telle fin n'est jamais donnée au départ. D'abord on ignore trop que l'enfant, du moins à certains âges, se plaît à reproduire et à imiter. Livré à lui-même, il imitera, mais des modèles plats et vulgaires ; il s'exprimera par clichés ; ne vaut-il pas mieux partir de cette tendance à l'imitation, qui est spontanée, et l'orienter vers de beaux modèles ? L'esthétique d'Astérix n'exprime pas la spontanéité enfantine, mais l'infantilisme des adultes qui en font commerce. D'autre part, arriver à créer, à trouver du nouveau ou simplement à s'exprimer de façon personnelle et originale, ne va pas de soi ; il ne suffit pas, comme le croit C. Rogers, que l'enfant soit encouragé pour qu'il y parvienne. L'encourager, certes, mais au travail, à la persévérance, à l'imitation active et critique, à cette « transpiration » qui est la condition première de l’« inspiration» (J. Mill). Ceux qui revendiquent la créativité de l'enfant au détriment de sa culture sont trop souvent des adultes qui n'ont pas su assimiler leur propre culture et cherchent un alibi dans l'infantilisme.
Quand on demande à A.S. Neill : « L’élève ne se retournera-t-il pas un jour contre vous pour blâmer votre école de ne pas l'avoir forcé à apprendre les mathématiques et la musique ?», il répond : « Rien n'empêchera jamais un jeune Einstein de devenir Einstein, ni un jeune Beethoven de devenir Beethoven ».[5] Mais comment un enfant trouvera-t-il sa vocation de musicien ou de scientifique s'il n'a pas eu l'occasion d'entrer dans la musique ou dans la science et d'affronter leurs difficultés ? Il y a des Mozart assassinés ; et peut-être qu'une éducation trop démagogique contribue à ce crime.
Ce qui m'amène finalement au problème de l’optionalité. Libérale en apparence et respectueuse de l'enfant, cette doctrine pourrait bien constituer en fait la plus implacable des sélections ; en laissant à tous l'illusion de choisir leur programme, elle n'est qu'un procédé particulièrement hypocrite de trier une élite. Car enfin comment l'enfant qui entre dans le secondaire pourrait-il choisir entre la géométrie et la guitare, comment l'étudiant qui entre au CEGEP pourrait-il choisir entre la philo et l'anglais technique, alors qu'il ignore tous des termes du choix ? Un enseignement démocratique me semble l'opposé de ce libéralisme mystificateur ; car donner la culture fondamentale à tous les jeunes implique qu'on favorise chacun dans les matières où il est le moins doué : ce sont les fragiles qui ont le plus besoin de sport, les poètes de physique, les scientifiques de littérature. Et l'optionnalité est non seulement désastreuse pour l'enfant, mais pour la société elle-même: car si chacun n'apprend que ce qui l'intéresse, on aura des ingénieurs incapables de comprendre les problèmes sociaux, des architectes ignorant tout de nos besoins et de nos rêves, des médecins aussi fermés à leurs malades que des vétérinaires, des directeurs asservis aux ordinateurs, des technocrates aveugles quant aux fins de leur technique, des artistes étrangers au patrimoine artistique et à ce que les hommes attendent de l'art. On aura surtout une masse de travailleurs ignorant le sens de leur travail et des consommateurs inaptes à choisir, à aimer, à juger par eux-mêmes. Un tel résultat n'est ni plus ni moins que la faillite de l'éducation.
* * *
Je ne me cache pas que cet article risque de déplaire. Il heurte de front bien des idées reçues et des pratiques courantes. Nombre d'affirmations devraient d'ailleurs être approfondies, nuancées, précisées. Mais je tiens à rappeler l'enjeu de tout ce débat : pourquoi, ou pour quoi éduquons-nous les jeunes ? Pour les endoctriner selon les vœux d'une église, d'une nation, d'un parti ? Pour les dresser en esclaves utiles et dociles de la production capitaliste ? Devant un tel défi, je pense que la réponse de Socrate n'a pas vieilli : non pour faire des techniciens, mais pour former des hommes, maîtres de leurs puissances propres, de leur expression, de leur jugement, de leur goût : all' épi paideia.
Olivier Reboul, Professeur de Philosophie, Université de Montréal, novembre 1972[6]
