Pour renouer avec Fernand Dumont
Voici comment un jeune québécois de 23 ans, né en Beauce, a lui-même renoué avec la pensée de Fernand Dumont.
Je ne sais pas encore la route
Mais je sais de qui sont mes saisons
Fernand Dumont, Parler de septembre, 1970
Introduction
Vingt ans nous séparent du décès de Fernand Dumont (1927-1997), lequel fut à la fois philosophe de la culture et des sciences humaines, sociologue, théologien et poète. Ce penseur, qui fut l’un des plus importants, sinon le plus important de toute l’histoire du Québec, n’est visiblement plus à la mode. Son œuvre est immense, riche et touche à plusieurs thèmes. Fils d’un « pays hypothétique », il n’a pas tourné 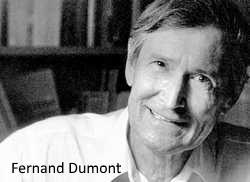 le dos aux siens ; il leur vouait au contraire une tendresse naturelle. Le volet « études québécoises » de son œuvre est considérable, bien qu’il ne faille pas l’y réduire. La nation, l’État, la société, la communauté politique sont des termes qui paraissent simples, mais ils peuvent revêtir des significations différentes selon les contextes et les auteurs. Dans l’usage quotidien, tant dans les médias que dans les chaumières, un certain brouillage s’opère, lequel donne lieu à des confusions interprétatives. Sous la plume de Fernand Dumont, il est nécessaire de bien tenir compte des définitions et des nuances. Dans un premier temps, nous verrons ce que sont chez lui la nation, l’État et la communauté politique ; sans ces définitions, il nous serait impossible de bien comprendre sa pensée. Dans un deuxième temps, nous verrons ce que signifient pour lui le Canada et le Québec tant sur le plan théorique que sur le plan historique. Dans un troisième temps, si on accepte l’idée que le Québec est une communauté politique à parachever, nous verrons le lieu de ralliement qu’il propose ainsi que ceux qu’il rejette. Dans un quatrième temps, nous présenterons les critiques de Gérard Bouchard à l’endroit de Fernand Dumont et le contre-modèle qu’il propose, le Québec comme francophonie nord-américaine ; l’intérêt de cette démarche réside dans le fait que la thèse de Bouchard a connu du succès au cours des vingt dernières années. Finalement, nous essaierons de lier cet aspect de la pensée dumontienne aux préoccupations de l’heure.
le dos aux siens ; il leur vouait au contraire une tendresse naturelle. Le volet « études québécoises » de son œuvre est considérable, bien qu’il ne faille pas l’y réduire. La nation, l’État, la société, la communauté politique sont des termes qui paraissent simples, mais ils peuvent revêtir des significations différentes selon les contextes et les auteurs. Dans l’usage quotidien, tant dans les médias que dans les chaumières, un certain brouillage s’opère, lequel donne lieu à des confusions interprétatives. Sous la plume de Fernand Dumont, il est nécessaire de bien tenir compte des définitions et des nuances. Dans un premier temps, nous verrons ce que sont chez lui la nation, l’État et la communauté politique ; sans ces définitions, il nous serait impossible de bien comprendre sa pensée. Dans un deuxième temps, nous verrons ce que signifient pour lui le Canada et le Québec tant sur le plan théorique que sur le plan historique. Dans un troisième temps, si on accepte l’idée que le Québec est une communauté politique à parachever, nous verrons le lieu de ralliement qu’il propose ainsi que ceux qu’il rejette. Dans un quatrième temps, nous présenterons les critiques de Gérard Bouchard à l’endroit de Fernand Dumont et le contre-modèle qu’il propose, le Québec comme francophonie nord-américaine ; l’intérêt de cette démarche réside dans le fait que la thèse de Bouchard a connu du succès au cours des vingt dernières années. Finalement, nous essaierons de lier cet aspect de la pensée dumontienne aux préoccupations de l’heure.
La nation, l’État et la communauté politique
Un lecteur un tant soit peu attentif à l’œuvre de Fernand Dumont comprendra sans coup férir que la nation est issue du passé et non de quelque abstraction constitutionnelle. Elle ne peut pas être confondue avec la société. La nation est un mode de structuration comme il en existe d’autres ; ni plus ni moins importante que les autres modes, elle doit être appréhendée en tant qu’elle est produite par l’histoire. Elle constitue « […] d’abord une communauté d’héritage historique[1]». Bien que le mot nation présume une origine commune, son développement n’implique nulle fatalité : « […] les nations sont des entités historiques mouvantes[2]. » Chaque nation a son histoire ; on aurait tort d’appliquer des caractéristiques générales à chacune d’entre elles. Même la langue n’est pas une caractéristique essentielle : certaines nations, au fil des aléas de l’histoire, peuvent troquer une langue pour une autre, sans compter que maintes nations parlent plusieurs langues. Il abonde dans le sens de Renan dont il se réclame ; ce dernier l’avait compris, « [l]a langue invite à se réunir ; elle n’y force pas[3] ». Dumont ne nie pas l’importance de la langue française pour les Québécois, au contraire ; dans le contexte nord-américain, elle les distingue très clairement, mais la mémoire est encore plus importante. La différence et les droits d’une nation ne peuvent se comprendre et se justifier que par leur parcours historique, ce que permet la mémoire. Pour structurante qu’elle soit, elle n’explique pas tout : « […] la nation n’englobe pas les phénomènes sociaux comme une boîte enclot son contenu[4]. » La nation, dont le premier critère est la mémoire, est le produit d’une histoire : opérant sur le plan des représentations collectives, elle est un groupement par référence, laquelle consiste – en résumé – en une mémoire historique, en des idéologies et en un imaginaire littéraire.
Qu’est-ce que l’État définit ? La citoyenneté. Il assure aux individus un accès égal aux droits fondamentaux, leur confère un statut public ; il veille à insérer une dose d’équité dans les inégalités de revenus par le biais de ressources communes telles que le système de santé, la scolarisation, l’assurance-maladie, etc. ; il a un rôle à jouer dans l’économie et dans le développement de la culture ; il fixe les normes et les procédures de la société. Il peut coïncider avec la nation comme l’inverse ; la coïncidence ou la distance s’explique souvent par l’histoire. Mais la nation et l’État supposent des modes de cohésion collective différents. Ils ont un point commun, cependant : tous deux ont été produits par l’histoire. Nous l’avons dit, la nation puise directement dans la mémoire ; mais « […] l’État est au premier chef un projet d’organisation collective qui vise à la constitution sans cesse reprise d’une société de droit[5] ». L’État a une substance temporelle, il n’est pas État en tant qu’il est l’institution fondamentale du présent ; il est État, aussi, dans la mesure où il a un projet, lequel puise dans une antériorité qui légitime des promesses et des garanties. L’État et la nation étant deux modes différents de cohésion, il serait injuste d’attribuer à l’un la qualité de communauté pour la retirer à l’autre. Les deux sont des communautés dont les fondements sont différents. Leur distinction est réelle, mais elle est loin d’être étanche ; des liens sont non seulement de mise, mais inévitables. Dumont l’explique :
S’il revient à l’État de promouvoir l’égalité des citoyens et la justice distributive, cette responsabilité concerne en particulier le maintien et l’épanouissement des communautés nationales. De la part de l’État, ce n’est pas là simple concession à la diversité des nations, mais une exigence positive : comment imaginer une communauté politique d’où serait bannie l’une des sources culturelles qui l’alimentent[6]?
Dumont ne semble pas établir une différence marquée entre l’État et la communauté politique ; s’il y en a une, elle est subtile. Ils ont certainement des fonctions de nature différente, mais la communauté politique semble liée davantage à l’État que ne l’est la nation.
À la lumière de ces explications, on constate que la communauté politique est un groupement par intégration qui assigne des rôles et des statuts. Il en donne une définition : « [u]ne communauté politique est le produit d’une progressive sédimentation de solidarités autour d’un projet[7]. » La nation et la communauté sont de nature différente, chacune d’elles suppose une allégeance et une fonction différentes. Elles se situent du moins sur le même niveau, c’est-à-dire qu’elles sont les deux principaux axes de la société, laquelle, pour être précis, « […] est un mode particulier de structuration des phénomènes collectifs, celui où on saisit leurs arrangements sur le plan des grands ensembles[8] ». Tout le problème de la genèse de la société québécoise est qu’elle s’est formée sous l’effet d’une disjonction entre la nation et la communauté politique du fait d’une dépendance extérieure.
Qu’appelle-t-on Canada et Québec ?
Les définitions étant claires, allons plus loin. Qu’en est-il de la nation et de la communauté politique dans le contexte du Canada et du Québec ? Dire que Dumont était en faveur de la souveraineté politique du Québec n’explique rien de façon satisfaisante. Prenons en premier lieu le cas du Canada. Il n’est pas une nation ; parler d’État-nation est une méprise. Les nations présentes au Canada ne coïncident pas avec un État. La nation nouvelle dont il était question, en 1867, était la nation politique ; cela a confirmé encore davantage que l’autre nation était culturelle – les Canadiens français appartenaient de facto à deux nations différentes, du moins en théorie. Le projet fédératif était justifiable, mais à deux conditions : d’une part, il devait assurer la sauvegarde et l’épanouissement des nations constituantes et d’autre part, il devait faire en sorte que la fédération édifie une communauté politique. Et une telle communauté n’est pas sans substance ; elle suppose, nous l’avons vu, des solidarités qui se cristallisent dans un projet. Mais quel projet ? Pour Dumont, « […] l’histoire de la Confédération est celle de l’échec d’une communauté politique[9] », ce qui ne veut pas dire qu’il n’en existe aucune au Canada. Pour comprendre, il ne suffit que de penser à la façon dont s’est érigé le pays. L’Union des Canadas en 1841 avait pour but d’assimiler ceux qu’on appelait alors les « Canadiens », les francophones ; le régime de l’Union, instable, a conduit le Québec dans la Confédération. Celle-ci a vu le jour pour des raisons précises : mettre fin à l’instabilité politique du régime de l’Union, unir les colonies britanniques face aux États-Unis, accroître l’économie du pays notamment par la construction de chemins de fer. En 1867, le Québec a hérité de peu de pouvoirs ; ils étaient essentiellement culturels, ce qui le mettait d’emblée à rebours ou simplement à l’écart de la nation nouvelle, la nation politique issue de la Confédération. Une communauté politique doit avoir un projet ; de l’Union à la Confédération, des projets naissent, aboutissent, mais qui peut dire qu’ils servent la nation francophone étant donné que l’Union, qui conduit inéluctablement à la Confédération, naît d’une volonté d’assimiler les francophones ? Outre un projet, la communauté politique, parce qu’elle est un groupement par intégration, doit pouvoir s’appuyer symboliquement sur des consensus. En France, la Révolution française fait figure de consensus, tout comme aux États-Unis la Déclaration d’indépendance ne fait sourciller personne. Rien de tel ne s’est produit en 1867.
Dumont l’explique :
Les Pères [de la Confédération] ont refusé de tenir une consultation populaire ; celle-ci aurait constitué, en la circonstance, non pas seulement le recours à un mécanisme démocratique, mais un acte fondateur analogue à ceux qu’ont connus d’autres communautés politiques. Un historien [Jean-Paul Bernard, 1971] a calculé que, parmi les 49 représentants des comtés francophones qui ont pris part au vote, 25 ont acquiescé et 24 se sont opposés au projet de fédération. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le consentement à la nation nouvelle, à la communauté politique en gestation, était fragile. Voilà une communauté qui doit célébrer ses origines avec discrétion[10]…
Ainsi l’histoire montre-t-elle que le vocabulaire, à lui seul, ne peut édifier une communauté politique authentique. C’est un échec dont il ne faut pas se réjouir ; Dumont le qualifie même de tragédie. Il n’a pas été possible d’édifier une seule communauté politique qui aurait été le lieu de rencontre des différents groupes nationaux, où des consensus, des solidarités et un projet auraient été possibles. Le Canada et le Québec ne forment pas une, mais deux communautés politiques qui se sont édifiées de façon parallèle. La Révolution tranquille, inaugurée en 1960, a contribué à affermir la communauté politique québécoise. À ce stade, il est important de rappeler ce qui est pour Dumont une lapalissade : « […] la communauté politique doit respecter et promouvoir l’épanouissement des nations qui, sans s’identifier à elle, contribuent à sa vitalité[11]. » Si le Québec, tout comme le Canada, est une communauté politique qui doit tenir compte de ses différentes composantes culturelles, quelle est son identité propre ? Il n’est pas une nation. Si tel était le cas, le projet de souveraineté politique devrait concorder avec la volonté d’édifier un État-nation, ce que Dumont ne veut pas et ce que l’histoire dément ; les nations qui composent le Québec dépassent ses limites territoriales et l’État-nation est un modèle théorique, la plupart des États étant multinationaux. En ce sens, parler de nation québécoise revient à vouloir identifier la nation à l’État. Les francophones, tant au Canada qu’au Québec, voyaient dans le biculturalisme la raison d’être de la communauté politique canadienne ; ce biculturalisme n’est-il pas un leurre ? Pour Dumont, fustiger le Canada parce qu’il a été incapable d’être le foyer politique appuyant les francophones et vouloir, dans le même souffle, faire coïncider au Québec la nation avec l’État, en fondant la légitimité du projet sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, est une incohérence. La nation étant un groupement par référence, il est erroné de croire que le Québec est une nation ; on ne peut pas, par la magie des mots, y inclure les anglophones, les allophones et les autochtones s’ils ne le veulent pas.
Il s’en explique :
[l]’histoire a façonné une nation française en Amérique ; par quelle décision subite pense-t-on la changer en nation québécoise? Définir la nation par des frontières territoriales, c’est affirmer que l’État s’identifie à elle; construction toute verbale et parfaitement artificielle de tacticiens politiciens[12].
Le lecteur dubitatif vis-à-vis de tels propos ne doit pas s’inquiéter : la position de Dumont est peu partagée, ce qui ne l’empêche pas d’être fort pertinente dans le débat. La question se pose : pourquoi faire la souveraineté politique du Québec si la nation française ne doit pas être consubstantielle à l’État ? La nation est-elle donc fermée à l’altérité ? Tant s’en faut : « la communauté nationale n’est pas faite de cette fraternité du sang […][13]. » Il est des descendants d’Écossais, d’Irlandais, d’Anglais et d’Italiens qui ont intégré la nation française au Québec, tout comme, à l’inverse, des descendants de Français ont intégré la nation anglaise ou la nation américaine. Avec de la volonté, quiconque peut être capable de s’agréger à une référence collective ; la contrainte est par ailleurs condamnable et inutile. La nation est capable de pluralisme, là n’est pas le problème, bien que la vigilance soit toujours de mise en démocratie. Demander aux anglophones au Québec de connaître la langue française est naturel, mais l’on ne peut pas les forcer à s’intégrer dans la culture française sans qu’ils abdiquent leurs droits historiques. La référence n’est pas « fixiste », elle peut être appropriée, nous l’avons dit. Néanmoins, Dumont est lucide : « [l]’immigrant sait fort bien qu’il n’a pas seulement à choisir une langue, mais l’une des deux sociétés […] ; « [i]l semble qu’un peuple aux proportions comme le nôtre, minoritaire en Amérique par la singularité de sa langue et de sa culture, n’offre pas aux immigrants un visage bien attirant[14]. »
Il faut comprendre que ce n’est pas par fermeture à l’autre que Dumont a fait ce constat, mais par souci de la pluralité et en vertu de sa connaissance de l’histoire. On ne crée pas une nation avec des mots… Le lecteur me pardonnera de citer de longs passages de ses mémoires. Après la publication de Genèse de la société québécoise et surtout de Raisons communes, Dumont sait fort bien qu’on lui reproche de s’opposer au concept de nation québécoise. Il comprend que les tenants du nationalisme territorial et de la nation civique cherchent à unir les Québécois dans une maison commune. Ses intentions ne sont pas différentes ; pourquoi chercherait-il à diviser ? L’intellectuel est tenu à une rigueur à laquelle les militants et les politiciens ne sont pas nécessairement tenus. Dans ses mémoires, il écrit pourquoi le concept de nation québécoise est fautif ; il conduit à une double difficulté. Voici la première :
[…] Je ne suis pas certain que les anglophones du Québec se sentent spontanément inscrits dans cette nation nouvelle. Tout indique qu’ils se conçoivent, et c’est leur droit, comme faisant partie d’une nation anglophone qui déborde le Québec; ce qui explique leur attachement au Canada et le peu d’attirance qu’exerce le projet souverainiste sur la très grande majorité d’entre eux. En leur garantissant, avec raison et en vertu de droits historiques, un système scolaire et des services de tous ordres qui leur soient propres, ne leur reconnaît-on pas explicitement une culture distincte de la culture francophone? Et une nation n’est-elle pas d’essence culturelle (non pas ethnique, comment le donnent à entendre certains auteurs à des fins polémiques)[15]?
La deuxième difficulté est fort simple : si la nation devient la nation québécoise, donc une nation politique, comment désignera-t-on la collectivité francophone ? Doit-on superposer deux nations ? Qualifier les Québécois de « groupe ethnique » dans une nation politique ? Un tel résultat serait bien peu satisfaisant : pourquoi s’efforcer de faire advenir la souveraineté si ce n’est que pour un résultat aussi piètre ? Nous avons écrit plus haut pourquoi Fernand Dumont croit dans le projet de souveraineté du Québec : la communauté politique canadienne ne s’est pas consolidée, ou elle s’est mal consolidée en empêchant l’épanouissement des francophones. C’est pourquoi il veut que la communauté politique québécoise, qui s’est affirmée dans son originalité depuis 1960, soit parachevée. Ainsi l’écrit-il :
Pour ma part, il m’a toujours paru évident que, selon la plupart de ses promoteurs, la souveraineté apporterait un indispensable support politique à la vitalité d’une culture francophone. J’y vois aussi la possibilité d’instaurer une communauté politique là où la Confédération canadienne a échoué : une communauté de citoyens, un peuple si l’on veut, rassemblant tous les habitants du Québec. En distinguant nation et communauté politique, on a des chances de respecter la complexité des réalités historiques et de dissiper des ambiguïtés qui sont autant d’obstacles pour la cause que promeuvent un grand nombre d’entre nous[16].
Toutes ces considérations montrent qu’il est impensable pour Dumont de fonder un État national au Québec. Le projet de parachèvement de la communauté politique québécoise par la souveraineté politique n’a pas surgi au hasard, et Dumont le sait : premièrement, ce projet est inhérent au destin de la nation française en Amérique et, deuxièmement, nous l’avons dit abondamment, la communauté politique qui se forme au Canada ne lui permet pas de s’épanouir. Inutile de se mettre des œillères, donc : le projet est né de francophones québécois et est porté par eux de façon générale, mais non exclusive. Il l’écrit sans ambages : c’est d’un instinct de survie qu’il est question. Dans ce contexte, l’indépendance est un devoir et le nationalisme un moyen qu’il faut sans cesse justifier :
[l]’indépendance est pour nous le devoir immédiat et qu’il faut accomplir à court terme. Mais un peuple comme le nôtre ne vivra jamais de calmes certitudes. Sans répit, il lui faudra prouver à lui-même et aux autres que le nationalisme n’est pas le recroquevillement dont on nous accuse : qu’il est simplement la courageuse acceptation de ce que nous sommes en vue de plus universelles responsabilités[17].
Il est intéressant de constater que Dumont voit dans le nationalisme québécois une acceptation de soi alors que Jean Bouthillette y voit une volonté d’être. Mais Dumont ne considère pas l’acceptation de soi comme un stade final ; elle doit mener à l’universel. Il y a donc une convergence avec la définition que Bouthillette offre du nationalisme, qu’il soit québécois ou d’ailleurs : « [v]olonté de puissance chez les grands peuples, le nationalisme, chez les petits, est une volonté d’être[18]. » Qui oserait dire que le nationalisme québécois est volonté de puissance ?
Quels fondements pour la communauté politique ?
Sur quelles assises la communauté politique québécoise devrait-elle être fondée ? Dumont commence par éliminer les éléments qu’il juge néfastes. La communauté politique ne doit pas être fondée sur le multiculturalisme au sens courant du terme : une superposition de communautés culturelles. Au Canada ou ailleurs, le multiculturalisme est un leurre. Difficile de nier que le facteur unificateur de la société canadienne ne soit pas la langue anglaise ! Le multiculturalisme doit donc être exclu du projet de parachèvement de la communauté politique, mais les différences culturelles doivent être préservées : toute communauté politique n’exige pas l’uniformité. Ainsi elle se refusera à assimiler brutalement les immigrants. Des règles doivent prévaloir, mais la coercition est à proscrire. Pour l’immigrant, il ne s’agit pas de se couper de sa culture d’origine pour baigner dans son nouveau contexte ; c’est à l’aide de sa culture originelle qu’il peut s’intégrer adéquatement. C’est d’ailleurs le propre de la communauté politique de pouvoir concilier l’existence de groupes nationaux différents ; il va sans dire que les nations anglaise et autochtones, dans une communauté politique parachevée, auraient la place qui leur revient.
Le multiculturalisme et l’assimilation brutale sont donc des voies où il ne faut pas s’engager ; mais que faire, et que dire ? Que tout habitant du Québec est québécois ? Dire pareille évidence empêche de comprendre la complexité du phénomène. Relève aussi de l’évidence le fait que l’affirmation du mouvement souverainiste a accentué une fracture collective ; deux sociétés parallèles n’avaient-elles pas vécu pendant longtemps sans qu’on réfléchisse à leurs causes sociologiques ? La culture publique commune prônée par plusieurs, dont Gary Caldwell, serait-elle une panacée ? S’il s’agit de réunir différentes composantes culturelles de la société pour qu’elles aient en commun les institutions juridiques et politiques, on est loin du compte : elles sont évidemment nécessaires pour la citoyenneté, mais insuffisantes pour former une communauté politique : « […] celle-ci suppose des références culturelles auxquelles les individus s’identifient[19]. » Dumont rejette donc l’assertion selon laquelle il est possible qu’une culture publique commune soit le ciment de la communauté politique ; nul ciment n’est possible sans références culturelles. On ne fait pas tenir ensemble des sujets politiques uniquement sous le magistère d’institutions politiques et juridiques. La langue française, parlée par la presque totalité de la population, ne pourrait-elle pas être ce ciment ? Devrait-elle être promue en tant qu’outil de communication ou en tant qu’outil de culture ? Une langue appréhendée dans sa totalité est une culture ; il faudrait alors que la langue française devienne une culture de convergence, celle qui est le point de rassemblement de toutes les autres cultures. Pour y arriver, on n’aura recours ni à des mesures autoritaires ni à quelque pacte moral. Une double orientation sera nécessaire : dans la vie quotidienne, la connaissance de la langue française comme élément essentiel de citoyenneté pour la diversité ; dans l’enseignement, la connaissance de l’histoire du Québec, de ses régions, de ses institutions politiques et juridiques, est de même essentielle. Le reste suppose des arrangements de culture, un métissage en quelque sorte, qui se fasse naturellement et qu’il serait hasardeux de vouloir accélérer. La culture de convergence ne sera pas concoctée en laboratoire ; s’il y en a une éventuellement au Québec, et il doit y en avoir une, c’est la culture française qui devra être en cause. Dans un cas contraire, la communauté politique québécoise, qu’elle s’inscrive à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, deviendra nulle. Une fois réglée la question de la communauté politique, les efforts devront se centrer sur le devenir de la culture.
Gérard Bouchard, critique de Dumont
Le Québec comme francophonie nord-américaine ou la nation coupée d’elle-même
La thèse de Fernand Dumont sur la nation québécoise est pour ainsi dire le point de départ du livre La nation québécoise au futur et au passé de Gérard Bouchard – livre au sujet duquel on n’a pas assez fait remarquer qu’il ne traite pas du passé. Après avoir récusé les modèles tant de la nation civique que de la nation ethnique, lesquels sont inapplicables in extenso, Bouchard présente quelques thèses qu’il considère comme ethniques pour mieux affronter celle de Dumont à laquelle il attribue le plus d’autorité dans le champ politique et intellectuel. Nous avons montré les tenants et aboutissants de la thèse de Fernand Dumont, qui est à la fois claire et complexe, fondée justement sur des considérations historiques et sociologiques. Bouchard présente sa pensée comme une fermeture à l’autre, un ethnicisme à peine dissimulé, vecteur potentiel de discrimination. Quelques citations suffiront à montrer ce que nous considérons comme une mauvaise foi évocatrice des vingt dernières années que nous venons de traverser ; toutefois, il ne s’agit pas de résumer le débat entier[20]. Grosso modo, ce dernier, sans lui rendre justice, croit que « […] sous la plume de M. Dumont, l’intégration des immigrants [est] en réalité synonyme d’assimilation pure et simple à la culture canadienne-française[21] ». N’avons-nous pas démontré l’inverse ? En outre, « [sa] proposition générale conduit à réinstaller l’ethnicité au premier rang de la représentation symbolique de la société québécoise en lui donnant une reconnaissance formelle et, pour ainsi dire, officielle[22] ». N’est-ce pas en distinguant nation et communauté politique, en refusant à tout prix la fondation d’un État national, que Dumont a montré son souci de ne pas rendre l’ethnicité – si une telle chose existe encore – consubstantielle à l’État et à la société ? Il est étonnant que Bouchard confonde l’ethnicité et la culture. Pis encore, selon le concepteur de l’interculturalisme, « [s]i une telle proposition devait prévaloir, elle viendrait en quelque sorte confirmer tout le mal que l’on entend ici et là à propos du nationalisme québécois, tous ces préjugés et stéréotypes malveillants qui l’associent au repli, à l’ethnicisme, au refus de la différence[23] ». Est-il donc préférable de ne pas mesurer la nation à l’aune des complexités historiques pour être capable de pluralisme ? Nous croyons également avoir montré l’inverse. Dumont serait finalement coupable de vouloir institutionnaliser les différences : « [i]l est aisément prévisible qu’en accentuant, en institutionnalisant en quelque sorte les différences, un quadrillage ethnique de l’espace culturel québécois va favoriser des cloisonnements, un durcissement des rapports entre communautés, une détérioration de l’altérité […][24]. » Comment institutionnaliser les différences quand l’institution principale de la société québécoise, l’État, devrait pour Dumont être distincte des différentes composantes culturelles ou nationales de la société ? Ces composantes, qui ont des rapports entre elles, contribuent à la vitalité de l’État ; ce dernier devient le foyer politique de la nation principale que Dumont nomme la nation française, présente à l’intérieur et à l’extérieur des limites territoriales du Québec.
Mais quel modèle préconise donc Gérard Bouchard, lui qui ne concède aucune once de clairvoyance à Fernand Dumont ? Montrons de quel modèle il s’agit, puis soumettons-le à la critique s’il y a lieu. Bouchard propose le modèle de la nation québécoise en tant qu’elle est une francophonie nord-américaine. Quatre éléments le composent ; quatre éléments font en sorte que c’est un modèle viable. Premièrement, il s’agit, puisque c’est possible selon lui, de superposer la nation culturelle à la nation civique. Deuxièmement, ce modèle remplit trois critères fondamentaux : « […] le respect de la diversité, le maintien d’une cohésion collective, la lutte contre la discrimination[25]. » En troisième lieu, il s’inspire des modèles classiques les plus progressistes, tout en tenant compte des aspirations propres au Québec contemporain. Finalement, il propose une redéfinition pour élargir le nous à la totalité de la francophonie québécoise. Comment circonscrire ce nouvel espace collectif, qui adviendrait à la suite de la fondation d’une nouvelle nation culturelle ? Par la langue française, comme dénominateur commun, qu’elle soit la langue maternelle, seconde, tierce, ou simplement la langue d’usage. Cet espace collectif, culturel dans le même temps, est inclusif : « [s]ur le plan culturel, ce cadre désigne le lieu premier de la francophonie québécoise, à laquelle chacun peut participer et appartenir à raison de sa maîtrise de la langue[26]. » Ce modèle réduirait au possible le coefficient d’ethnicité (l’expression est de Bouchard) de cette nation, qui superposerait sur le peuple une nouvelle nation culturelle et dont la langue française serait le socle commun. Afin que l’aventure réussisse, l’identification des individus en tant qu’ils seraient des Canadiens français est à exclure : « [c]’est peut-être même l’une des conditions de l’intégration culturelle du Québec[27]. »
Regardons cela point par point. Le « modèle » de la nation québécoise en tant qu’elle est une francophonie nord-américaine est composé de quatre éléments essentiels que nous avons déjà énumérés. D’abord, comment serait-il possible de superposer une nouvelle nation culturelle à une nation civique ? Comment crée-t-on une nation ? Nous aimerions que Bouchard l’explique. Suffit-il d’inventer un nouveau mot ? Bouchard peut critiquer Dumont comme il l’entend, puisque personne ne peut se soustraire à la critique, mais ce dernier a toujours le mérite d’avoir montré très clairement comment est advenue la nation culturelle francophone au Québec, négativement et par contraste avec la nation nouvelle, la nation politique issue de la Confédération. L’histoire a une utilité que le présent – pour ne pas dire le présentisme – exclut. Ensuite, Bouchard nous dit que ce modèle est valable notamment parce qu’il respecte la diversité et qu’il est le plus propice pour lutter contre la discrimination. La discrimination, qu’elle soit ethnique ou autre, est condamnable et il est fort à parier que les intellectuels québécois de même que les citoyens s’y opposent, et à juste titre d’ailleurs. Notre désaccord fondamental avec Bouchard réside en ceci : il est impossible de mettre en avant un modèle pour une nation ; il est impossible de créer, le temps d’écrire un livre, une nouvelle nation culturelle. Bien qu’elle évolue au fil du temps, personne ne le conteste, la nation est issue de l’histoire. Pourquoi chercherait-on à la définir par ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire par l’autre (respect de la diversité) et par un enjeu de politique publique (lutte à la discrimination) ? La sociologie se confond-elle maintenant, pour ce qui est de sa fonction précise, avec la haute fonction publique ? Est-ce parce que l’on considère en certains quartiers, malgré un titre qui réfère au passé, que la nation est à remodeler pour le futur ? La caractéristique première d’une nation, Dumont l’a montré, est la mémoire. La nation est dénaturée dès lors que la mémoire est fragilisée. Bouchard ne cache pas son souhait de réécrire l’histoire nationale[28]. Comment concilier cette manœuvre, parce que c’est de cela qu’il s’agit, avec le respect tant de la vérité historique que celui des ancêtres, et même des descendants à venir ? S’agit-il de transmettre une mémoire morcelée par quelque « professionnel de la science historique » ? En troisième lieu, pour respecter les aspirations particulières des Québécois, laissons-leur choisir le modèle qui leur convient ou, simplement, laissons-les être. Il est difficile de contester que ces derniers aient inscrit leur démarche collective, depuis la Révolution tranquille, dans un récit progressiste. Il est de même fort probable qu’ils en décideront de même dans le futur, mais ils ont le loisir de choisir autre chose que le progressisme. Pourquoi Bouchard croit-il que la nation québécoise est indissociable du progressisme ? Issue d’un héritage historique, elle a déjà été conservatrice et il se peut qu’elle le redevienne quelque jour ; aucune prescription d’idéologie ne peut être faite à une nation. Finalement, le modèle qu’il propose étend le nous à toute la francophonie québécoise. Soit. Mais n’est-ce pas déjà le cas ? N’accuse-t-on pas les nationalistes québécois de focaliser uniquement sur les francophones ? Pour aller jusqu’au bout de la logique de Bouchard, qui est celle de l’ouverture maximale, ou, dans ses termes, celle de réduire au possible le coefficient d’ethnicité, pourquoi le nous ne devrait-il s’étendre qu’à la francophonie québécoise ? Certains groupes pourraient être discriminés, après tout. Et comment prouve-t-on qu’il n’y ait aucune corrélation entre la langue et l’ethnicité ? En se fiant à la souche, les Québécois et les Français ont pour la plupart des ancêtres communs. La connaissance de la langue française est un critère suffisant pour participer à cet espace culturel, selon Bouchard. Peut-il nous expliquer, en la circonstance, comment distinguer un Québécois d’un Français et un Français d’un Suisse ? Sans la mémoire, nulle nation culturelle n’est possible. Par ailleurs, il est quelque peu amusant que Bouchard souhaite que l’identification au Canada français s’étiole alors qu’à l’heure à laquelle il écrit, en 1999, plus personne, hormis les aînés peut-être, ne s’identifie comme des Canadiens français. La principale critique que nous adressons à Bouchard, outre ce que nous avons déjà mentionné, est qu’il propose ce qui est déjà. Aux yeux de la plupart, le Québec est une nation qui est aussi, et depuis toujours ? une francophonie nord-américaine. En quoi sa proposition est-elle novatrice ? En lisant le livre, le lecteur ne pourra que constater que l’auteur ne s’associe que de façon allusive au mouvement souverainiste. Cette confusion ne brouille-t-elle pas son « modèle » ?
Les préoccupations de l’heure
En définitive, vingt ans sans le magistère intellectuel de Fernand Dumont auront contribué à accentuer le brouillage de la représentation collective dont les Québécois sont victimes ; il n’est pas question de personnaliser le débat, de croire que la parole de Dumont était incontestable, mais plutôt de renouer avec un pan de sa pensée qui n’est pas négligeable. Nous ne pouvons nier que pour rendre sa pensée à la fois plus limpide et plus dense, il eût fallu nous plonger dans sa Genèse de la société québécoise ; nous voulions cependant rendre compte le plus simplement possible d’une pensée politique ancrée dans l’histoire et qui devra tôt ou tard resurgir dans l’espace public. Le 150e anniversaire de la Confédération devrait nous rappeler que la communauté politique canadienne a échoué et qu’elle s’est construite sur un malentendu. Dire que « nous sommes tous des Québécois » est une vérité, mais qui ne règle en rien la disjonction réelle entre la nation et la communauté politique. Les souverainistes québécois agissent comme si le Québec était une nation politique, ce que l’histoire récuse ; ils veulent fonder un État national en voulant y inclure tout le monde, même ceux qui ne le veulent pas. Vouloir inclure et respecter tout le monde en identifiant la nation à l’État est d’une incohérence totale. Cette entreprise n’est possible qu’en vidant la nation de sa substance et de ce qu’elle est, c’est-à-dire un groupement par référence, une communauté issue de l’histoire dont la mémoire et non la langue est la composante première. Renouer avec Fernand Dumont ne suppose pas de lire ou de relire ses écrits comme s’ils étaient l’Évangile ; cela suppose plutôt d’arrêter de croire que de simples mots peuvent créer une réalité qui n’a jamais existé au regard de l’histoire. Cela suppose, également, de mesurer la nation et la communauté politique à l’aune des complexités historiques et du devenir de la culture et, surtout, de ne pas sombrer dans des accusations d’ethnicisme lorsque le débat fait référence à l’histoire particulière des Québécois. N’est-ce pas un début de solution pour cesser de focaliser sur la date du prochain référendum sur la souveraineté et pour dissiper le brouillage de la représentation collective ?
[1] Fernand Dumont, Raisons communes, Montréal, Boréal, 1997 [1995], p. 53.
[2] Ibid., p. 54.
[3] Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? suivi de Le judaïsme comme race et comme religion, textes présentés par Schlomo Sand, Paris, Flammarion, coll. « Champs classiques », 2011 [1882 et 1883], p. 67.
[4] Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Montréal, Boréal, coll. « Boréal compact », 1996 [1993], p. 16.
[5] Fernand Dumont, Raisons communes, op. cit., p. 56.
[6] Ibid., p. 57.
[7] Ibid., p. 58.
[8] Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, op. cit., p. 321.
[9] Fernand Dumont, Raisons communes, op. cit., p. 58.
[10] Ibid., p. 59. La dernière phrase de la citation, dans le contexte qui est le nôtre alors que le Canada célèbre son 150e anniversaire, fait sourire : le Canada ne célèbre pas ses origines avec discrétion.
[11] Ibid., p. 62.
[12] Ibid., p. 66.
[13] Ibid., p. 54.
[14] Ibid., p. 23.
[15] Fernand Dumont, Récit d’une émigration, Oeuvres complètes, tome V, Québec, Presses de l’Université Laval, 2008, p. 446.
[16] Ibid., p. 426-427.
[17] Fernand Dumont, La vigile du Québec, Montréal, Hurtubise HMH, coll. « Constantes », 1971, p. 90.
[18] Jean Bouthillette, Le Canadien français et son double, Montréal, L’Hexagone, 1972, p. 54.
[19] Fernand Dumont, Raisons communes, op. cit., p. 69-70.
[20] Pour une critique à la fois serrée et juste des accusations de Bouchard à l’endroit de Dumont, on consultera Serge Cantin, « Nation et mémoire chez Fernand Dumont. Pour répondre à Gérard Bouchard », dans La souveraineté dans l’impasse, Québec, Presses de l’Université Laval, 2014, p. 187-211. Pour une critique des propositions de Bouchard et de la mauvaise conscience des souverainistes, on lira le livre de Jacques Beauchemin, L’Histoire en trop. La mauvaise conscience des souverainistes québécois, Montréal, VLB éditeur, coll. « Études québécoises », 2002, 216 p.
[21] Gérard Bouchard, La nation québécoise au futur et au passé, Montréal, VLB éditeur, coll. « Balises », 1999, p. 49.
[22] Ibid., p. 52.
[23] Ibid., p. 54.
[24] Ibid., p. 55.
[25] Ibid., p. 62.
[26] Ibid., p. 63.
[27] Ibid., p. 70.
[28] Ibid., p. 107-124.