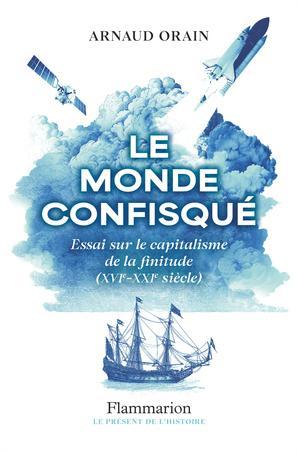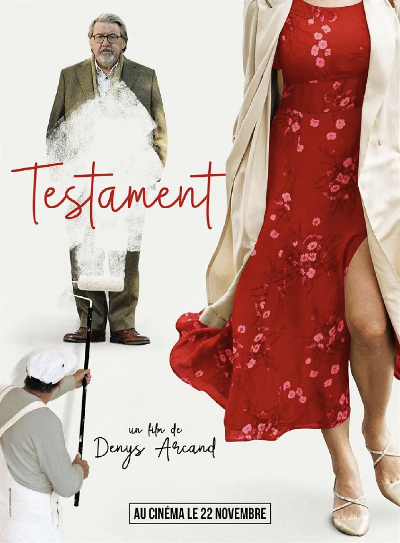Lecture critique de «No Society», de Christophe Guilluy
La thèse de Guilluy
La thèse du nouvel essai[1] de Christophe Guilluy est que les sociétés occidentales sont en train de se dissoudre à cause d’une nouvelle opposition entre classes sociales. D’un côté, les élites urbaines, métropolitaines, qui promeuvent un universalisme désincarné et anti-social. De l’autre, les anciennes classes moyennes, devenue des classes « périphériques ». Toujours majoritaires, les classes périphériques sont attachées au bien commun et à une identité concrète, ce qui en fait les seules porteuses d’un véritable projet social.
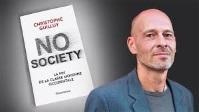 Le titre de l’essai, « No Society », est emprunté à une célèbre citation de Margareth Thatcher où la dame de fer affirmait que seul l’individu est réel. La « société », elle, ne serait rien de plus que la somme de ses parties. Cet individualisme est selon Guilluy la philosophie naturelle des classes supérieures urbaines, qui rassemblent ceux qui profitent de la mondialisation de l’économie, et valorisent le progrès, l’ouverture et la diversité. Les classes périphériques, elles, pensent en termes d’attachement à une identité nationale, à un héritage culturel et à des valeurs communes.
Le titre de l’essai, « No Society », est emprunté à une célèbre citation de Margareth Thatcher où la dame de fer affirmait que seul l’individu est réel. La « société », elle, ne serait rien de plus que la somme de ses parties. Cet individualisme est selon Guilluy la philosophie naturelle des classes supérieures urbaines, qui rassemblent ceux qui profitent de la mondialisation de l’économie, et valorisent le progrès, l’ouverture et la diversité. Les classes périphériques, elles, pensent en termes d’attachement à une identité nationale, à un héritage culturel et à des valeurs communes.
Le discours des élites est produit et relayé par les médias et le monde universitaire. Il vise à créer une image idéalisée de l’économie néo-libérale et des flux migratoires. En même temps, il délégitimise les résistances populistes à ceux-ci comme étant rétrogrades et racistes. Ce discours culmine dans une tentative d’imposer dans l’espace public une vision de l’humain vidée de tout ancrage dans des nations, des histoires et des lieux concrets. Cet universalisme abstrait ne prend en compte que des individus ou des groupes d’individus interchangeables, malléables, utilisables parce qu’homogènes.
L’universalisme rend invisible les réalités sociales et nationales, en premier lieu l’opposition entre les « métropolitains » et les « périphériques ». Celle-ci est rendue visible par la géographie, qui est littéralement l’agglomérat, la cristallisation des processus idéologiques et politiques décrits ci-haut : « […] c’est moins le niveau de revenus que la relégation culturelle et géographique qui façonne les nouvelles classes populaires[2]. » Il revient donc au géographe Guilluy de dévoiler la vérité, de réhabiliter le populisme. Selon lui, les majorités nationales, grâce à leur supériorité numérique et à leur capital culturel, sont assez puissantes pour redevenir les moteurs de l’histoire.
De l’espoir pour les classes moyennes
Dans ce qu’il a de plus fort, comme dans ce qu’il a de plus controversé, le propos de Guilluy se décline en trois points principaux. Premièrement, la classe périphérique a, partout en Occident, une réalité sociologique et géographique indéniable.
Deuxièmement, elle se définit comme une classe moyenne qui a perdu une bonne partie de son statut économique et social : ses conditions de vie matérielle se dégradent depuis quelques décennies, et elle sert de bouc émissaire à l’élite métropolitaine, qui l’accuse de tous les maux qui accablent les minorités.
Troisièmement, elle est porteuse d’une vision sociale-démocrate du bien commun : services sociaux, réglementation des marchés économiques, redistribution de la richesse, etc. Elle serait la seule porteuse de la société comme telle.
Malgré son titre négatif, « No Society - La fin de la classe moyenne occidentale », l’ouvrage de Guilluy est avant tout optimiste. Bien qu’il ne le dise pas explicitement, il semble proposer que les intellectuels lâchent les élites métropolitaines pour apporter leur contribution au vaste mouvement politique des classe moyennes qui se met en branle partout dans le monde.
Déjà majoritaire chez les membres de la classe moyenne issus des majorités ethniques d’âge moyen, le populisme serait en voie de s’accroître des retraités de la classe moyenne, dont les acquis seraient menacés par les réformes néo-libérales, et d’une partie des minorités ethniques issues de l’immigration, dans la mesure où leur accession à la classe moyenne leur fait partager les espoirs et les craintes de la majorité.
Il y aurait ainsi de véritables forces de changements à l’œuvre dans nos sociétés, forces qui iraient dans le sens de la social-démocratie, de la réglementation des marchés financiers, et du nationalisme. Non pas une révolution, plutôt un retour à l’équilibre, une reconstruction des structures matérielles et culturelles nécessaires au bien-être des majorités historiques.
L’ambition de Guilluy semble être de fournir une synthèse intellectuelle capable d’éclairer et de légitimer les forces populaires déjà à l’œuvre dans nos sociétés. Cette ambition est rendue possible, au plan théorique, par le caractère non réductionniste du modèle que propose Guilluy. L’éclatement de la société entre métropolitains et périphériques s’incarne dans la géographie, il est causé par les processus économiques néo-libéraux, mais ces processus sont en dernière analyse eux-mêmes fondés sur des décisions politiques, et légitimés culturellement par les médias et le monde intellectuel. Le politique est donc premier pour Guilluy, ce qui distingue essentiellement son modèle du marxisme, duquel toutefois une lutte des classes nouveau genre et le recours à des mesures étatiques de bien commun le rapproche en partie.
Le rôle de la culture
L’ouvrage de Guilluy confère une grande puissance aux forces culturelles des médias et du monde universitaire. C’est la culture universaliste et individualiste dans laquelle on baigne depuis des décennies qui a permis aux gouvernements de réaliser des réformes néo-libérales et multiculturelles sans créer trop de remous chez les majorités historiques, du moins pendant un certain temps. Toutefois, Guilluy passe très rapidement sur la question des processus culturels. Il affirme que les médias ont influencé les mentalités dans le sens de l’universalisme, sans analyser les modalités de cette influence, et à vrai dire sans la démontrer solidement. C’est l’une des faiblesses de l’ouvrage.
La question, en effet, n’est pas si simple. On pourrait faire valoir, par exemple, que la culture de masse penche très souvent du côté de l’ethnocentrisme, de la caricature des minorités ethniques, etc. Une masse considérable de contenus numériques véhiculent le populisme. Ces contenus sont en bonne partie produits par de grandes entreprises, ou par des groupes œuvrant à propager des points de vue opposés au libéralisme, aux droits individuels, etc. Bref, la manipulation des esprits n’a pas qu’une seule source, et elle ne va pas que dans un seul sens.
Certes, ces contenus peuvent être produits par « le vrai monde ». Guilluy, pourrait s’en réjouir, et y voir l’affirmation dans l’espace public des opinions des classes moyennes. Il faudrait alors clarifier ce qui distingue la saine affirmation des intérêts et de l’identité des majorités historiques du rejet de l’autre et du racisme. Critiquer le vide et l’hypocrisie de la bien pensance des élites est une chose, accepter la bêtise réactionnaire et la haine en est une autre.
De plus, les médias nous influencent non seulement par leur contenu, mais également par leur forme. La consommation massive et irréfléchie d’images numériques nous rend de plus en plus hédonistes, présentistes. Elle nous atomise. Sans exagérer la force de ce phénomène, on peut dire qu’il tend à rendre moins spontané qu’autrefois un certain nombre d’attitudes essentielles à la vie sociale et politique. Chose certaine, l’attitude populiste en laquelle Guilluy place de grands espoirs n’est certainement pas suffisante pour combattre les effets délétères du numérique.
Que sont réellement les classes moyennes, et que veulent-elles ?
La principale faiblesse de l’argumentation de Guilluy concerne la réalité même des classes moyennes dont il parle. Les classes moyennes « périphériques » sont probablement moins homogènes et moins unies qu’il ne le prétend. Guilluy établit assez clairement qu’il existe une opposition entre ceux qui bénéficient de la mondialisation néo-libérale, et ceux qui y perdent. Cela est déjà beaucoup. Cela ne prouve pas cependant que ces deux groupes soient unis chacun de leur côté. Chacun de ces deux groupes peut être plus nominal que réel.
« Être perdant de la mondialisation » n’est pas en soi un mode d’être substantiel. Plusieurs nations sont aux prises avec la mondialisation, chacune avec sa situation historique, et dans chaque nation, plusieurs classes sociales, groupes professionnels, ou communautés régionales ont des préoccupations qui leurs sont propres. Lorsque Guilluy oppose les gens « de quelque part » à ceux «de nulle part », il doit précisément prendre au sérieux les particularismes régionaux, les différences culturelles, économiques et politiques.
En outre, Guilluy présente comme une évidence que les classes moyennes désirent toutes plus de services de l’État. Cela me semble une fausseté manifeste. Les mouvements populistes sont souvent, au contraire, partisans d’une réduction l’intervention de l’État et des charges fiscales. Aux États-Unis, les partisans du Tea Party sont en guerre contre ce qu’ils ont surnommé l’ « Obamacare », et s’opposent en général à l’intervention de l’État, aux taxes, aux impôts. Au Québec, le populisme des classes moyennes que décrit Guilluy correspond surtout à l’électorat de la CAQ, plutôt favorable au libre marché qu’à l’État.
En France, une « révolte des indépendants » a mobilisé contre l’interventionnisme étatique, vers le milieu des années 2010, des milliers de petits commerçants et travailleurs autonomes écrasés par les charges fiscales. En 2018-2019, les Gilets Jaunes réclament avant tout des réductions de taxes et une baisse de salaires de certains élus. Le caractère hétéroclite des Gilets Jaunes, où l’extrême-droite se mêle à l’extrême-gauche, témoigne de ce qu’il est plus facile d’unir les citoyens contre la mondialisation que pour un modèle social.
La notion de bien commun ne se réduit pas à l’État providence. La subsidiarité, l’engagement communautaire ou individuel, et même le libre marché économique, avec un cadre juridique solide, peuvent aussi prétendre parvenir au bien commun. Il est normal et sain que diverses nations et groupes sociaux envisagent l’un ou l’autre de ces visions du bien. Les classes moyennes et les mouvements populistes ne se laissent pas facilement conceptualiser, d’autant qu’on peut aussi parler de populisme de gauche, qui touche une partie des classes moyennes qui adhère à l’universalisme des élites métropolitaines tout prônant la solidarité avec les plus pauvres et les minorités ethniques ou sexuelles.
Un juste milieu est-il possible ?
L’un des points forts de l’ouvrage de Guilluy est son approche non réductionniste, qui considère les décisions politiques des individus et des nations comme des causes réelles, et l’humain en général comme capable de penser et d’agir par soi-même. C’est pourquoi il refuse de voir les supporteurs de Trump ou de Marine Le Pen comme des arriérés ou comme de simples pantins des médias populistes.
Guilluy me semble surtout demander qu’on prenne les préoccupations des majorités historiques au sérieux, non à légitimer sans nuance tout ce que les leaders populistes mettent de l’avant. On se demande toutefois dans quelle mesure son optimisme face au populisme ne constitue pas une démission face aux dérives d’extrême-droite de nombreux leaders populistes. S’il existe un « bon populisme e », c’est certainement celui des classes moyennes pragmatiques, modérées, qui se méfient de toute forme d’extrémisme. Il est permis d’espérer que le Québec du gouvernement Legault s’engage dans un populisme de ce type.
Guilluy commet une erreur en identifiant les valeurs mondialistes et universalistes au conservatisme libertarien de Thatcher. Le conservatisme thatchérien est incompatible avec la social-démocratie prônée par Guilluy, mais non avec la valorisation de l’identité nationale, bien au contraire. Comme Guilluy le voit très bien lui-même, l’universalisme abstrait est maintenant prôné par les grands partis socio-démocrates d’Occident. Que l’universalisme soit aujourd’hui instrumentalisé par le néo-libéralisme est exact, comme le nationalisme l’a aussi été, mais il est faux qu’il se confond tout simplement avec lui. Le souci pour l’humanité s’enracine dans l’histoire de l’Occident et dans la nature humaine, et il a à ce titre sa vérité propre.
Guilluy devrait nuancer le jugement qu’il porte sur les médias universalistes, libéraux, de même que sur le monde universitaire. Lorsque des pans de l’opinion publique adhèrent aux valeurs de l’élite mondiale, à l’ouverture et à la solidarité entre tous les humains, il faut aussi y voir l’expression de sentiments et de croyances sincères. Guilluy exacerbe les différences, certes réelles, entre les valeurs d’enracinement et d’universalisme. C’est probablement pourquoi il livre au nom du sens commun une bataille sans pitié contre le monde universitaire, au risque de glisser vers l’obscurantisme. Ce qu’il faut, c'est plutôt tenter d’articuler philosophiquement le particulier et l’universel, de concevoir un universel concret, non de répudier toute universalité.
Conclusion
En définitive, l’ouvrage « No Society » présente une argumentation riche, mais il a le défaut d’aboutir à des thèses simplistes, exagérément polémiques. L’opposition radicale entre les métropolitains et les périphériques exagère l’éclatement de notre société actuelle, et la reconstitution de la société autour de l’identité nationale et des valeurs sociales démocrates supposément portées par les classes moyennes pose un faux dilemme entre l’unité homogène de type socialiste, d’un côté, et la diversité hétérogène de type capitaliste, de l’autre. En réalité, les facteurs qui rendent l’unité sociale difficile sont nombreux, et ils ne sont pas tous négatifs, tant il s’en faut que l’unité sociale doive être absolue. Guilluy ne va pas jusqu’au socialisme pur et dur qui nie la diversité sociale. Toutefois, il caricature l’individualisme libéral et la valorisation de la diversité, au risque de sembler les nier.
L’unité ne doit pas dissoudre la diversité. Il est par essence impossible qu’une partie de la société soit porteuse à elle seule du fait social. Les classes moyennes de Guilluy ne peuvent pas plus faire société à elles seules que le prolétariat de Marx. L’identité historique portée par les classes moyennes ne peut reconquérir un statut reconnu de culture commune que si elle peut susciter l’adhésion des autres groupes sociaux, à savoir les minorités défavorisées et les élites. Cela suppose une richesse humaine, une générosité qui semble faire cruellement défaut à de nombreux mouvements populistes, qui pour plusieurs carburent au ressentiment.
Partout dans le monde, l’immigration inquiète les citoyens : « L’intensification des flux migratoires débouche partout sur les mêmes tensions, les mêmes demandes de régulation, la même insécurité culturelle[3]. » Ces préoccupations sont en soi légitimes, et Guilluy pense que la plupart des peuples veulent simplement trouver une façon raisonnable de conserver leur identité. Le nationalisme québécois, traditionnellement humaniste, démocratique et profondément pacifiste, pourrait faire figure de modèle en la matière.
En attribuant un rôle particulier aux classes moyennes, Guilluy s’inscrit dans une très longue tradition. Aux yeux d’Aristote, les classes moyennes de son époque pouvaient jouer un rôle pacificateur dans la cité parce qu’elles étaient les moins obsédées par les possessions matérielles. Contrairement aux pauvres, elles n’étaient pas perpétuellement en manque. Contrairement aux riches, elles ne rêvaient pas de s’enrichir au-delà du nécessaire. Il semble qu’aujourd’hui on fasse rêver les classes moyennes à l’enrichissement, alors même qu’elles s’appauvrissent et qu’on leur demande d’accepter une relativisation de leurs repères moraux et culturels, d’où leur colère. C’est-là le constat incontournable posé par Guilluy. Le problème est de plus en plus clair, mais il reste entier.