Le Québec conquérant de Pierre Perrault
«Nous autres icitte à l’Île aux Coudres on a appris à vivre en vivant.» Léopold Tremblay, dans Pour la suite du monde
«Il y a dans ce cinéma comme une symbiose, difficilement explicable, entre la parlure des gens du pays et l’environnement qui lui fait écho, entre le sonore et le visuel, le temps de la parole proférée et l’espace qui la reçoit.» Paul Warren, Québec français, mai 1980.
Que penser de la vitalité d’un peuple dont les quatre principaux partis nationalistes sont plus attachés à leur petite souveraineté qu’à celle du pays? Pierre Perrault a répondu à l’avance à cette question. J’ai découvert cette réponse de façon inattendue.
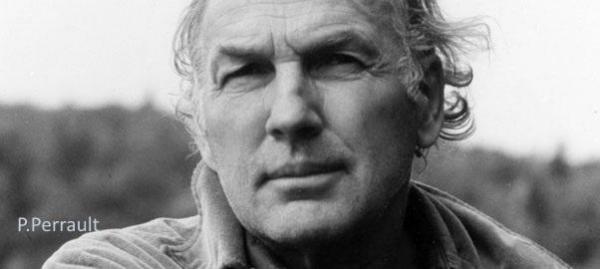 Il y a quelques années, à l’occasion du débat sur les valeurs, un lecteur de Gatineau nous écrivait pour nous dire que nous, de l’Agora sommes trop européens, trop français et que cela nous empêche de comprendre l’homme d’ici et ses valeurs. Je ne comprends rien à votre Simone Weil, précisa G.I (notre lecteur). Son envoi contenait la lourde photocopie d’un article fleuve consacré à Pierre Perrault dans le numéro de janvier 1983 de la revue Séquences.
Il y a quelques années, à l’occasion du débat sur les valeurs, un lecteur de Gatineau nous écrivait pour nous dire que nous, de l’Agora sommes trop européens, trop français et que cela nous empêche de comprendre l’homme d’ici et ses valeurs. Je ne comprends rien à votre Simone Weil, précisa G.I (notre lecteur). Son envoi contenait la lourde photocopie d’un article fleuve consacré à Pierre Perrault dans le numéro de janvier 1983 de la revue Séquences.
Tout récemment, je découvrais un tout autre point de vue sur Pierre Perrault, dans un livre écrit par deux jeunes philosophes, Olivier Ducharme et Pierre Alexandre Fradet, et intitulé Une vie sans bon sens, allusion au film Un pays sans bon sens. Pierre Perrault, le sourcier de la parole, le pourfendeur des intellectuels et des écrivains en général, le chasseur fier d’avoir pu profiter de ses études classiques pour jouer au hockey, y est comparé à Nietzsche et à Michel Henry. Chers auteurs, je vous sais gré d’attirer mon attention sur un cinéaste poète qui me semblait à jamais perdu pour la jeunesse, et ne serait-ce que pour cette raison, je veux bien faire quelques pas avec vous, mais ne forcez-vous pas un peu la note en comparant notre explorateur à des penseurs comme Frédéric Nietzsche et Michel Henry? Voilà, dira dans la préface Jean-Daniel Lafond, «une invitation au banquet des idées à la quelle Pierre Perrault ne s’attendait guère.»
Jean-Daniel Lafond, réalisateur de La trace du rêve, un excellent film sur Pierre Perrault, avait lui-même préparé le terrain en présentant Michel Serres à Pierre Perrault : «La rencontre avec Michel Serres a été un sauf-conduit pour Pierre. Il a trouvé le passeur qui lui a permis d'entrer en philosophie sans le savoir. Cette rencontre marque un véritable tournant dans sa démarche, une remise en question qui lui permet de comprendre que l'on peut parler grec et latin et philosopher sans s'éloigner de la vie, des lieux, des paysages, des gens. Je suis sûr également que Michel, le philosophe, a trouvé matière à réflexion chez celui qui se réclame fils du magnétophone et de la caméra synchrone légère pour explorer le Québec et, dans La bête lumineuse, pour explorer l'homme québécois afin de mieux se connaître lui-même.»
 Sans s’éloigner de la vie. C’est la phrase qui résume le mieux le grand souci de Pierre Perrault aussi bien que la thèse des deux auteurs d’Une vie sans bon sens. Vu sous cet angle, leur choix des deux philosophes à qui comparer Perrault est judicieux. Nietzsche, est le philosophe de la vie, le critique d’une rationalité qui triomphera dans cette Amérique de toutes les machines. Nietzsche fut un marcheur comme le sera Perrault, les auteurs n’ont pas souligné ce fait qui rapproche les deux hommes l’un de l’autre plus que tout autre trait commun.
Sans s’éloigner de la vie. C’est la phrase qui résume le mieux le grand souci de Pierre Perrault aussi bien que la thèse des deux auteurs d’Une vie sans bon sens. Vu sous cet angle, leur choix des deux philosophes à qui comparer Perrault est judicieux. Nietzsche, est le philosophe de la vie, le critique d’une rationalité qui triomphera dans cette Amérique de toutes les machines. Nietzsche fut un marcheur comme le sera Perrault, les auteurs n’ont pas souligné ce fait qui rapproche les deux hommes l’un de l’autre plus que tout autre trait commun.Nietzsche : «Demeurer le moins possible assis : ne prêter foi à aucune pensée qui n’ait été composée au grand air, dans le libre mouvement du corps - à aucune idée où les muscles n’ont pas été de la fête. Le préjugé vient des entrailles. ‘’Être cul de plomb’’ je le répète, c’est le vrai péché contre l’esprit.» (Ecce Homo)
Nietzsche eut Sils Maria, Perrault aura son Ungava. À propos de son film sur l’Abitibi, il écrira : «Ce film nous l’avons fait pour disculper le retour à la terre et aussi son discours tant méprisé par l’intelligence qui n’a jamais labouré un arpent pour vivre ou survivre.» Le thème du retour à la terre est aussi nietzschéen, dans un sens que Ducharme et Fradet ont bien précisé : «Labourer une terre en Abitibi, ce n'est pas effectuer un pas en arrière, mais la rendre cultivable pour la première fois. S'installer en Abitibi, ce n'est pas renouer avec les traditions qui s'effritent, mais étendre son royaume et exploiter des ressources inexploitées jusqu'alors. Le retour à la terre dont il est question chez Perrault n'est donc pas à entendre au sens où le passé mérite d'être répété puisqu'il ''serait près de se perdre'', mais plutôt au sens où il faut demeurer ancré dans le devenir mondain, matériel, terrestre. Cette conception du retour à la terre fait ainsi directement écho à la ''fidélité à la terre'' dont parle Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra, et qui implique un enracinement dans le monde sensible, humain, changeant. ''Moi aussi, [écrit Nietzsche,] je parle d'un retour à la nature, quoique ce ne soit pas proprement un retour en arrière, mais une marche en avant vers en haut, vers la nature, le naturel sublime. » (Une vie,p.47) Les auteurs auraient tort toutefois de prétendre que Perrault n’a pas eu le respect du passé comme tel. Il dénonce en tout cas énergiquement le manque de mémoire : «Il y a au Québec une tendance maladive à récuser le passé, l’autre, l’espoir.» (Séquences, p.16)
Quant à Michel Henry, il est l’un des trop rares philosophes contemporains qui ont réussi à penser la vie en évitant le double piège du vitalisme et du réductionnisme. Ducharme et Fradet n’auraient-ils écrit Une vie sans bon sens que pour faire connaître cet auteur, il faudrait leur être reconnaissant. Voici la page clé de leur livre. « ‘’Toute vie est par essence affective, l'affectivité est l'essence de la vie.’’ Au-delà de tout biologisme, de tout vitalisme et de tout romantisme, la vie présente chez Henry est donc entièrement tournée vers le sentiment de soi. La vie se confond avec l'affectivité, car elle est ce à partir de quoi chaque soi a une expérience de soi-même et du monde. À l'instar de l'affectivité, la vie est autonome par rapport à tout sentiment particulier : ‘’ L'autonomie est l'essence de la vie, identique à l'affectivité elle-même, elle est le fait que la vie se sent, a, est le sentiment d'elle-même.’’ Et c'est en raison de cette autonomie même que la vie constitue le fondement de l'existence du soi : étant indépendante de toute autre chose, elle se fonde sur elle-même pour être. Fondement affectif de tout ce que le soi peut expérimenter, la vie se rapporte au corps subjectif ou transcendantal. C'est l'élément premier à partir duquel nous nous expérimentons en tant que soi et nous expérimentons le monde lui-même. Dans son introduction à Philosophie et phénoménologie du corps (1965), Henry traite directement du corps transcendantal : ‘’un corps qui est un je’’» (Une vie,p.135)
 On est ici aux antipodes du cogito cartésien et du corps machine et tout près de ce filon vital dont Perrault cherche les origines et dont il veut assurer la continuité. Par origine, il faut entendre d’abord la saxifrage, petite fleur blanche que l’on trouve au pays des bœufs musqués et qui inspira cette pensée à Pierre Perrault :« les fleurs n’existent pas si elles cessent de peser de toute leur fragilité sur le destin du monde.» Se souvenait-il du mot de Victor Hugo, «nul ne peut affirmer que le parfum de l’aubépine est inutile aux constellations» ? Comment la saxifrage tire-t-elle sa vie du calcaire friable ? Quelle forme l’affectivité prend-elle chez elle ? 1- (L’oumigmatique, l’Hexagone, Montréal 1995, p.285)
On est ici aux antipodes du cogito cartésien et du corps machine et tout près de ce filon vital dont Perrault cherche les origines et dont il veut assurer la continuité. Par origine, il faut entendre d’abord la saxifrage, petite fleur blanche que l’on trouve au pays des bœufs musqués et qui inspira cette pensée à Pierre Perrault :« les fleurs n’existent pas si elles cessent de peser de toute leur fragilité sur le destin du monde.» Se souvenait-il du mot de Victor Hugo, «nul ne peut affirmer que le parfum de l’aubépine est inutile aux constellations» ? Comment la saxifrage tire-t-elle sa vie du calcaire friable ? Quelle forme l’affectivité prend-elle chez elle ? 1- (L’oumigmatique, l’Hexagone, Montréal 1995, p.285)Comment les habitants de l’Île-aux-Coudres ont-ils fleuri dans leur solitude ? Le miracle est le même. Au commencement était le corps. Dans La suite du monde, le premier film de Pierre Perrault, c’est un frémissement du corps qui s’empare des jeunes au printemps et les incite à renouer avec une tradition dont seuls quelques vieux de l’Île ont conservé le souvenir. Voudront-ils accompagner les jeunes dans le fleuve, au mois d’avril, pour y planter les arbrisseaux qui guideront le marsouin vers l’espace fermé où ils pourront le capturer vivant ? S’ensuivent des palabres sans fin, parfait exemple de démocratie populaire, qui aboutiront à la décision de passer à l’action. On imagine mal Pierre Perrault évoquant des palabres ne débouchant pas sur l’action. Avis aux nationalistes d’aujourd’hui. Dans ces palabres, un thème central : qui donc a eu assez de génie pour construire de telles pêches (et pour assurer la subsistance de toute une communauté) ? Les Indiens, dit l’un ; non, les Ancêtres bretons, dit l’autre. La question ne sera pas tranchée, mais qu’importe.
 Ce qui importe c’est que le génie soit attribué à des Anciens, à une époque où ces derniers sont présumés ignorants et tout juste dignes d’être oubliés. Il ne s’agit pas ici d’une profession de foi passéiste. Tout le monde sait que les Japonais d’aujourd’hui sont plus efficaces que les vieux de l’Île-aux-Coudres en matière de pêche aux mammifères marins. C’est la manifestation et la transmission de la vie qui est en cause. Une pêche aux marsouins est une création de la vie, comme une signature inimitable et comme tout ce qui tient une communauté : les fêtes de mi-carême, la messe du dimanche, etc. Ce savoir vernaculaire mérite le même respect que la parole issue de la même souche. Procréer, ce n’était pas seulement mettre un enfant au monde, c’était lui remettre un monde lui-même constamment recréé.
Ce qui importe c’est que le génie soit attribué à des Anciens, à une époque où ces derniers sont présumés ignorants et tout juste dignes d’être oubliés. Il ne s’agit pas ici d’une profession de foi passéiste. Tout le monde sait que les Japonais d’aujourd’hui sont plus efficaces que les vieux de l’Île-aux-Coudres en matière de pêche aux mammifères marins. C’est la manifestation et la transmission de la vie qui est en cause. Une pêche aux marsouins est une création de la vie, comme une signature inimitable et comme tout ce qui tient une communauté : les fêtes de mi-carême, la messe du dimanche, etc. Ce savoir vernaculaire mérite le même respect que la parole issue de la même souche. Procréer, ce n’était pas seulement mettre un enfant au monde, c’était lui remettre un monde lui-même constamment recréé.Recréé et non pas surajouté, imposé de l’extérieur. Ce n’est ni par racisme, ni par étroitesse d’esprit que Pierre Perrault se dresse en permanence contre l’autre sur ce continent, celui qui fait déferler sa culture sur la nôtre, c’est parce que ce déferlement opère la rupture d’un mouvement vital. Il y a sur cette question du vernaculaire une intime parenté entre la pensée d’Ivan Illich et celle de Pierre Perrault. Le vernaculaire est le canal par lequel se transmet une conception non mécaniste de la vie. L’école transmet un savoir abstrait, mis en tranches pour entrer dans la machine industrielle. C’est ainsi qu’il faut interpréter ce qui, dans l’œuvre de Pierre Perrault, peut ressembler à un préjugé anti-intellectuel.
Dans le cas des Amérindiens, auxquels Pierre Perrault a aussi donné la parole, la fin du vernaculaire est une tragédie, sans doute, préciserons-nous, parce qu’ils ne sont pas comme nous issus de ce XVIIe siècle français qui a donné le ton à la modernité. Ducharme et Fradet ont bien compris le point de vue de Perrault sur cette question :
Autrefois l'indien [sic] n'avait pas besoin de personne [sic] pour vivre à l'intérieur des terres. Maintenant l'indien [sic] est voué à la ration perpétuelle parce qu'on lui a enlevé ce qu'il savait pour vivre [...] parce qu'il ne sait plus rien pour vivre. D'après moi les indiens [sic] vont augmenter en nombre, mais ils vont de moins en moins savoir quelque chose pour vivre. Le moins ils vont savoir quelque chose pour vivre, le plus ils vont être paresseux [sic]. Le plus ils vont être paresseux, […] le plus ils vont rester assis, le moins ils vont aller à l'intérieur des terres.[sic)»
Le défi est le même, à quelques degrés près pour les Québécois d’origine européenne que pour les Indiens : maintenir le filon de la vie au milieu des techniques apprises à l’école, sans quoi nous deviendrons tous des marionnettes béates dans la société de consommation mondialisée. C’est dans ce contexte que le nationalisme doit prendre son nouveau sens vital. En 1960, il fallait créer des écoles. Il faut maintenant veiller sur le filon de la vie en partant à la reconquête d’une culture américanisée à un point tel que personne n’ose voir le mal dans toute son ampleur, tout le monde étant persuadé que Céline a conquis Las Vegas alors que c’est Las Vegas qui a conquis le Québec. Las Vegas et la Silicone Valley. Les grands diffuseurs américains exploitent sans vergogne les créateurs du monde entier, à commencer par les nôtres, avec leur consentement.
Ils diffusent leurs œuvres sous le nom vague et méprisant de contenu en contrôlant totalement l’opération, qu’ils orientent vers l’uniformité tout en se réservant la quasi-totalité des bénéfices. On commence à apercevoir la supercherie dans le monde de la chanson. Ce que pressentait Pierre Perrault en 1983 : «Ils recherchent le modèle américain qui les materne et les sécurise non sans les marginaliser irrémédiablement. Le choix est simple en vérité; soit devenir le client qui a raison parce que son choix est confirmé par les autres, soit choisir l'acte créateur qui n'est jamais une espérance, mais une conquête. » (Séquences, p.9)
***
Réponse de Pierre Perrault à notre question initiale:Que penser de la vitalité d’un peuple dont les quatre principaux partis nationalistes sont plus attachés à leur petite souveraineté qu’à celle du pays? Le passage qui suit est tiré du numéro de janvier 1983 de la revue Séquences. Pierre Perrault répond longuement à cette question de Léo Bonneville: Qu’est-ce qui vous a conduit en Abitibi pour y faire des films comme Un Royaume vous attend.?
«L'Abitibi! Un mot étrange! Lointain! Une belle sonorité amérindienne, mais qui n'évoquait dans mon esprit ni légende, ni épopée, ni carte postale. Et je partageais avec plusieurs une superbe ignorance de cette région qui est une aventure d'hommes à la conquête d'un territoire. Mais passée sous silence. Bien sûr, je connaissais L 'Abatis de Félix Antoine Savard, ces très belles pages sur l'Abitibi et les colons des années 30. […]
La colonisation de l’Abitibi, fut un échec bien réel […] m ais il y avait aussi l'Abitibi qui restait. C'est celle-là qui tout à coup nous a passionnés. Non pas seulement à cause de l'Abitibi, non pas seulement à cause de la terre. Mais parce que cette Abitibi-là avait une idée du royaume. Du royaume à « bâtir avant la nuit »! Du royaume à conquérir! Du courage et de l'entêtement! Une Abitibi qui refusait de se rendre, de se soumettre! Une Abitibi qui combattait! Une Abitibi qui ne croyait pas à une souveraineté sans effort, sans risque, sans austérité! Une Abitibi qui acceptait une pauvreté dans le présent en vue d'une souveraineté, d'une liberté à venir! Le contraire en somme de la morosité qui rêve des Iles Vierges pour fuir la météo d'Alcide, la morosité de ceux qui prennent la fuite pour peu qu'on leur propose de se mettre à la tâche, la morosité universitaire ou syndicale qui voudrait d'un royaume sans abattre un arbre, sans perdre une plume: le retour à la terre sur l'assurance chômage en somme! Et rien de plus!
L'Abitibi de l'entêtement, l'Abitibi qui restait, qui luttait, qui croyait que 1' avenir est dans le travail, dans l'acharnation, dans la coopération, c'est celle-là qui nous a passionné. Parce que l'Abitibi du présent avec ses cultivateurs solitaires et ses chef-d'oeuvreux incroyables, l'Abitibi du passé avec ses défricheurs chimériques, l'Abitibi m'a fait rencontrer l'épopée; la seule épopée québécoise.
Douze mille hommes ont été engagés dans cette aventure, douze mille soldats, douze mille fantassins, à pied, désarmés, « fourbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché ni de dotation », douze mille hommes sans compter les femmes et les enfants, les chiens et les chats, les vaches pas de bœufs, les violons sans archet, les berceuses sans chanteau, les chaînes sans crochet, la hache démanchée, douze mille hommes et la ressource des lièvres innombrables et de l'orignal braconné à l'occasion, pour conquérir une place au soleil, un royaume forestier, d'immenses savanes, une terre argileuse, des lacs à profusion, un sous-sol éventuel, une maîtrise probable sur toute la vie. Depuis 1760, pour la première fois, collectivement, consciemment, nous entreprenions une conquête. Je trouvais passionnant, émouvant tout ce discours un peu passé, un peu vieillot, toujours vivant, bien antérieur à tous ces discours récents qui disent maîtres chez nous... vers les sommets... égalité ou indépendance... Québec au travail... cent mille emplois... souveraineté- association, comme autant de promesses que tout va s'arranger sans rien changer, tandis que petit à petit tout un peuple se voit progressivement réduire à la boîte à lunch sans qu'on ne lui propose jamais de reprendre possession, de lever la hache, de se mettre à la tâche, de conquérir en somme. L'aventure abandonnée de l'Abitibi (abandonnée par les politiques qui ne s'intéressent pas trop au petit monde), il me paraissait intéressant de l'examiner dans la perspective du présent qui se propose de consentir à des espérances sans jamais les mettre en œuvre. Comme s'il suffisait de consentir à l'avenir pour qu'il naisse. Pour une fois la promesse du royaume reposait sur une action. Pour une fois, on ne promettait pas le paradis à rien faire. Comme à la loterie.
 Les intellectuels de la morosité actuelle qu'ont-ils fait pour que la promesse s'accomplisse? Comment ont-ils vécu la promesse qu'ils ont élue? Rien ne sert d'espérer si on consent à l'échec comme à une délivrance. Rien ne sert d'espérer si on a peur du froid. Si on fuit dès les premières neiges. Si on abandonne aussitôt que la météo fédérale annonce une tempête. Les intellectuels sont-ils autre chose que les lièvres de la ferveur? Ont-ils peur de sacrifier leur scotch pour changer quelque chose dans le rapport de force qui nous met toujours à la merci de l'autre? Et ils condamnent l'espérance parce queTricofil capitule, sans soupçonner que Tricofil a cédé parce qu'ils n'ont pas compris que c'était la guerre, parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils fournissaient des armes à l'ennemi, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient concernés et qu'on ne gagne pas la guerre avec des promesses. Et puis qu'on leur proposait de se salir les mains, ils ont pris la fuite, cherchant dans la modernité, la post-modernité, le formalisme, le temps fou, la mainmise, la croissance personnelle, l'informatisation, un avenir qu'ils n'ont qu'à suivre de loin puisqu'il est imaginé ailleurs. Nous avons voulu avec Hauris Lalancette et l'Abitibi proposer un autre modèle, une autre façon de nommer l'avenir en dehors des projets politiques et des espérances électroniques, une espérance qui mange du lièvre pour bâtir une souveraineté dans les faits, et non pas la chimère d'une souveraineté politique qui ne serait que théorique, qui ne serait que politique. Une espérance qui ne serait pas une tempête qui se cherche un verre d'eau. Car l'Abitibi, sans succès peut-être, avait consenti à se salir les mains. Les gars de l'Abitibi n'ont pas été les lièvres de la ferveur. Bien sûr, ils ont mangé du lièvre. Mais surtout ils ont pris en main un avenir. Ils ont recommencé le royaume au premier arbre. Et ils ont pour ainsi dire réussi la conquête. Mais une aussi humble réussite peut-elle être prise comme modèle par des intellectuels qui préfèrent Fitzcarraldo, Ben-Hur ou E. T., qui s'ennuient religieusement devant India Song, qui ont peur de manquer le bateau et ne se risquent pas à le bâtir, qui servilement recherchent le modèle américain qui les materne et les sécurise non sans les marginaliser irrémédiablement? Le choix est simple en vérité; soit devenir le client qui a raison parce que son choix est confirmé par les autres, soit choisir l'acte créateur qui n'est jamais une espérance mais une conquête. Mais la conquête exige de passer aux actes. Les intellectuels préfèrent habiter le discours. Or leur discours les effraie, ils ont peur des promesses qu'ils ont formulées, ils préfèrent le navire qui leur propose la chaleur des voyages organisés. Mourir en Floride, en somme.
Les intellectuels de la morosité actuelle qu'ont-ils fait pour que la promesse s'accomplisse? Comment ont-ils vécu la promesse qu'ils ont élue? Rien ne sert d'espérer si on consent à l'échec comme à une délivrance. Rien ne sert d'espérer si on a peur du froid. Si on fuit dès les premières neiges. Si on abandonne aussitôt que la météo fédérale annonce une tempête. Les intellectuels sont-ils autre chose que les lièvres de la ferveur? Ont-ils peur de sacrifier leur scotch pour changer quelque chose dans le rapport de force qui nous met toujours à la merci de l'autre? Et ils condamnent l'espérance parce queTricofil capitule, sans soupçonner que Tricofil a cédé parce qu'ils n'ont pas compris que c'était la guerre, parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils fournissaient des armes à l'ennemi, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient concernés et qu'on ne gagne pas la guerre avec des promesses. Et puis qu'on leur proposait de se salir les mains, ils ont pris la fuite, cherchant dans la modernité, la post-modernité, le formalisme, le temps fou, la mainmise, la croissance personnelle, l'informatisation, un avenir qu'ils n'ont qu'à suivre de loin puisqu'il est imaginé ailleurs. Nous avons voulu avec Hauris Lalancette et l'Abitibi proposer un autre modèle, une autre façon de nommer l'avenir en dehors des projets politiques et des espérances électroniques, une espérance qui mange du lièvre pour bâtir une souveraineté dans les faits, et non pas la chimère d'une souveraineté politique qui ne serait que théorique, qui ne serait que politique. Une espérance qui ne serait pas une tempête qui se cherche un verre d'eau. Car l'Abitibi, sans succès peut-être, avait consenti à se salir les mains. Les gars de l'Abitibi n'ont pas été les lièvres de la ferveur. Bien sûr, ils ont mangé du lièvre. Mais surtout ils ont pris en main un avenir. Ils ont recommencé le royaume au premier arbre. Et ils ont pour ainsi dire réussi la conquête. Mais une aussi humble réussite peut-elle être prise comme modèle par des intellectuels qui préfèrent Fitzcarraldo, Ben-Hur ou E. T., qui s'ennuient religieusement devant India Song, qui ont peur de manquer le bateau et ne se risquent pas à le bâtir, qui servilement recherchent le modèle américain qui les materne et les sécurise non sans les marginaliser irrémédiablement? Le choix est simple en vérité; soit devenir le client qui a raison parce que son choix est confirmé par les autres, soit choisir l'acte créateur qui n'est jamais une espérance mais une conquête. Mais la conquête exige de passer aux actes. Les intellectuels préfèrent habiter le discours. Or leur discours les effraie, ils ont peur des promesses qu'ils ont formulées, ils préfèrent le navire qui leur propose la chaleur des voyages organisés. Mourir en Floride, en somme.
Mourir en Floride pendant qu'Hauris Lalancette se bat en Abitibi pour préserver une idée du royaume vendue par ses frères, une idée de l'Abitibi rachetée par la C.I.P., une terre pourtant généreuse étouffée par Canada Packers. Et je n'accuse pas la C.I. P. ni Canada Packers de nous conquérir au fur et à mesure, mais les intellectuels qui militent partout ailleurs que dans l'humilité du pain quotidien, là où justement prennent naissance les cultures. Et c'est là, dans l'échec tonitruant, que j'ai rencontré Hauris pour la première fois, dans une réunion de « paroisses marginales » (pour ne pas dire condamnées) au lac Castagnay. Le lac Castagnay, c'est un petit village qui avait comme tant d'autres réussi sa conquête. Il n'en reste plus rien qu'un carrefour et, à chaque coin, ce qui était trop lourd à déménager, au bord d'un lac magnifique. L'église, bien sûr, en pierre des champs, bâtie sans doute à la courvée, par les soirs, après le travail des champs, une église autrefois tenue par des Franciscains qui avaient fondé une cité nouvelle, tentant par toutes sortes de moyens archaïques de protéger cette fragile communauté des marchands et de la boîte à lunch. Fermée l'église. À tout jamais. En face, le presbytère devenu un hôtel pour recevoir les touristes américains qui font la pêche sur le lac. De l'autre côté, un garage abandonné lui aussi par les fuyards... et une école fermée par les normes. Autour, pas une seule maison. Toutes parties sur les remorques de Charlemagne Gobeil. On ne voit que des solages vides comme les espoirs et des granges déhanchées pour témoigner des derniers combattants. Il n'y a plus de village. Mais il reste les rangs et à gauche et à droite un homme du bout du rang qui refuse de se rendre, de capituler, qui se bat encore, les armes à la main, pour un espoir que les écrivains de la modernité dénigrent comme on casse du sucre sur le dos des pauvres. Et, dans l'école, ces derniers combattants se réunissent pour combattre un gouvernement (libéral à l'époque) qui prétend les replanter en épinettes, remettre aux épinettes noires qu'ils ont combattues à mains nues tout le royaume, remettre à la morosité les terres d'une véritable légitimité. Au nom d'une rentabilité immédiate. Pour transformer des conquérants en mercenaires.





