Frankenstein ou la Genèse de la posthumanité
« Voici, écrivait Monette Vacquin dans Frankenstein ou les délires de la raison, un mythe moderne, dont l'origine et l'apparition, contrairement à celles de la plupart des mythes, ne se perdaient pas dans la nuit des temps, bien au contraire. Il avait une date : l'aube du XIXe siècle.»[1]
Frankenstein, le roman de Mary Shelley, n’est certes pas un grand roman, quoique sur le plan littéraire il se compare avantageusement au Meilleur des Mondes de Huxley, mais c’est néanmoins un ouvrage de première importance par rapport à la posthumanité dans laquelle nous entrons, une sorte de genèse. On le considère aussi comme le premier ouvrage de science fiction.
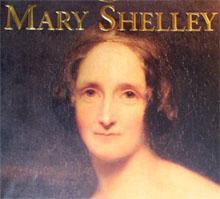 Mary Shelley n’avait que dix-huit ans quand elle a commencé à écrire Frankenstein, livre qui connut un immense succès, succès populaire d’abord, ce qui explique pourquoi on en a tiré une cinquantaine de films et de pièces de théâtre Ce succès semble toutefois avoir créé autour de lui un écran de fumée qui en masqua l’importance en tant que mythe fondateur d’une nouvelle humanité. Victor Frankenstein est le nom du savant qui fabriqua un être vivant auquel il ne donna pas de nom, l’appelant tantôt le monstre, tantôt la créature, mais cette créature était appelé à détrôner son créateur et à usurper son nom.
Mary Shelley n’avait que dix-huit ans quand elle a commencé à écrire Frankenstein, livre qui connut un immense succès, succès populaire d’abord, ce qui explique pourquoi on en a tiré une cinquantaine de films et de pièces de théâtre Ce succès semble toutefois avoir créé autour de lui un écran de fumée qui en masqua l’importance en tant que mythe fondateur d’une nouvelle humanité. Victor Frankenstein est le nom du savant qui fabriqua un être vivant auquel il ne donna pas de nom, l’appelant tantôt le monstre, tantôt la créature, mais cette créature était appelé à détrôner son créateur et à usurper son nom.
La psychanalyste française Monette Vacquin fut l’une des premières à en comprendre la portée au moment (le milieu de la décennie 1980) où la fécondation in vitro commença à entrer dans les mœurs. « Voici, écrivait-elle dans Frankenstein ou les délires de la raison, un mythe moderne, dont l'origine et l'apparition, contrairement à celles de la plupart des mythes, ne se perdaient pas dans la nuit des temps, bien au contraire. Il avait une date : l'aube du XIXe siècle. »[1]
On sortait du siècle des Lumières, on entrait dans les suites de la Révolution française, on croyait au progrès sans présumer qu’il pourrait avoir un côté sombre. Après la Renaissance, l’homme gravitait encore autour de Dieu; en ce début du XIXe siècle, c’est Dieu qui gravitait autour de l’homme, devenu à ses propres yeux la mesure de toute chose. La rumeur voulait qu'Erasmus Darwin, le grand père de Charles, ait donné vie à de la matière morte. L’électricité ne mettait-elle pas cette même matière en mouvement? Et l’injustice, l’inégalité étaient telles, partout où le regard chargé d’idéal pouvait se poser, qu'on en venait à penser qu'il serait plus simple de refaire l’homme que de l’améliorer.
« Mary, ajoute Monette Vacquin, était la fille de deux philosophes anglais célèbres en leur temps, Mary Wollstonecraft, pionnière du féminisme, et William Godwin, penseur radical. Elle était également l'épouse du poète Percy Bysshe Shelley. Fille des Lumières, Mary s'était opposée courageusement aux préjugés, avait entendu user de sa raison pour vivre et pour aimer. Par sa vie, par ses intérêts intellectuels, elle avait été intimement mêlée à tous les courants de pensée qui agitaient son époque. »[2]
« Et ces courants rendaient un son étrangement familier à mes oreilles. Ses parents libres penseurs avaient été des apôtres de l'amour libre. Shelley s'était fait le théoricien de la liberté sexuelle. Byron, qui fut un de ses proches, avait brandi son homosexualité et son amour incestueux pour sa demi-sœur Augusta comme autant de questions lancées à l'univers. Ensemble, Mary, Shelley et Byron avaient parcouru les routes de France et d'Italie, affichant douloureusement leurs transgressions, cherchant dans les idéaux de la Révolution française des outils leur permettant de mieux comprendre le monde et eux-mêmes. Routards avant la lettre, ces jeunes gens de génie avaient anticipé, dans leur microcosme, ce que notre génération allait vivre, sur un mode bien plus large. »[3]
Quelques années après avoir écrit Frankenstein, de nouveau en voyage en Italie et en France, Mary, Shelley, sa sœur Claire, maîtresse de Byron et Byron lui-même formaient un quatuor libre au point de sombrer dans ce qu'on appellerait aujourd’hui la criminalité. Refusant de se rendre à l’évidence de la grave maladie de Clara, sa fille et celle de Mary, Shelley par son entêtement à poursuivre sa route vers Venise où l’attendait Byron provoqua la mort de l’enfant.
Dans Frankenstein ou les délires de la raison, Monette Vacquin fait correspondre diverses parties du roman avec diverses scènes de la vie de Mary Shelley. Les rapprochements sont souvent saisissants. Lors d’un séjour près du lac de Genève, trois des membres du quatuor avaient accepté, à la suggestion de Byron, d’écrire une histoire fantastique. C’est un rêve qui donna à Mary les grandes lignes de son sujet, un rêve qui s’avérera prémonitoire, car elle perdra peu après deux de ses enfants, à l’instar de Victor, le créateur du monstre, qui perdit plusieurs de ses proches.
L’essai de Monette Vacquin est celui d’une psychanalyste. Notre approche sera différente. Nous nous arrêterons à diverses étapes de la vie, ou plutôt de l’existence de Frankenstein, avec l’espoir d’y trouver, sans miser sur la psychanalyse, des indications qui nous permettront de mieux comprendre l’engouement actuel pour les robots et de mieux en prévoir les suites.
Victor Frankenstein, le personnage principal du roman, (le créateur du monstre auquel il donnera son nom) est né à Genève dans le plus doux des foyers chrétiens que l’on puisse imaginer. Son prénom, qui signifie vainqueur en latin, nous donne toutefois à pressentir qu'il nourrit de grandes ambitions ayant pris forme en lui sous l’influence d’auteurs alchimistes tels Corneille Agrippa, Paracelse et Albert Magnus. Plus tard, à l’université d’Ingolstad, il découvrira la chimie moderne dans l’enthousiasme.
« Guidé par les nouveaux maîtres (alchimistes) que je m'étais choisis, je partis, plein de zèle, à la recherche de la pierre philosophale et de l'élixir de vie. Mais c'est sur ce dernier que se concentra bientôt toute mon attention. La fortune n'était à mes yeux qu'un but inférieur, mais quelle gloire s'attacherait à ma découverte, si je réussissais à libérer l'organisme humain de la maladie et à rendre l'homme invulnérable, sauf à une mort violente! »
« J'entrevoyais encore d'autres possibilités. Provoquer l'apparition de fantômes et de démons était une chose que mes auteurs favoris disaient tout à fait réalisable, et dont je recherchais passionnément l'accomplissement. »[4]
Victor allait mettre la chimie moderne au service de ses rêves d’alchimiste. « Enfant, les résultats promis par les adeptes modernes des sciences naturelles ne m'avaient pas satisfait. Dans une confusion d'idées devant être attribuée à mon extrême jeunesse et à l'absence d'un guide averti, j'avais parcouru à rebours les étapes de la connaissance et échangé les découvertes des chercheurs récents contre les rêves des alchimistes oubliés. De plus, je n'éprouvais que mépris à l'égard des usages de la philosophie naturelle moderne. C'était bien différent lorsque les maîtres de la science recherchaient les secrets de l'immortalité et de la puissance. De telles vues, bien que sans valeur réelle, étaient empreintes de grandeur, mais, hélas! tout avait changé. L'ambition des chercheurs semblait se limiter à l'annihilation de ces visions sur lesquelles reposait principalement mon intérêt envers la science. L'on me proposait, en somme, de troquer des chimères d'une infinie grandeur contre des réalités de médiocre valeur. »[5]
Passage crucial. C’est en combinant un idéal démesuré apparu dans une période obscure, avec l’efficacité de la science moderne que Victor atteindra son but. N’est-ce pas une combinaison semblable qui fut à l’origine de la posthumanité?
Par rapport à Shelley et à Byron, Mary Shelley a conçu Victor comme un ascète et sa chambre à l’Université d’Ingolstadt ressemblait plus à la cellule d’un moine qu'au pied à terre d’un partisan de l’union libre. Il était l’homme d’un projet auquel il sacrifiait l’affection des siens y compris celle d’Élisabeth, cette femme parfaite qui avait prononcé à son endroit le fiat de la vierge.
Un romancier plus âgé et plus fin psychologue que Mary nous aurait sans doute appris pourquoi ce célibataire incorruptible avait préféré la science et le pouvoir à la chair et à la femme, peut-être aurait-il vu à l’œuvre en lui un orgueil semblable à celui de ces viri spirituales ayant marqué l’histoire du millénarisme, cette doctrine liant le paradis sur terre de l’humanité au succès de la science et de la technique.
Victor incarnait, si l’on peut dire, cette rationalité, ces lumières, qui émaillaient les discours de Shelley et Byron, mais sans jamais pénétrer dans leur vie. On notera surtout que son premier but était médical : « libérer l’organisme humain de la maladie et rendre l’homme invulnérable.» C’est toujours par cette porte médicale que, par la suite, les projets prométhéens pénétreront dans l’humanité.
Victor Frankenstein tel que décrit par Mary était donc rempli des meilleurs intentions du monde et par rapport à Byron et Shelley, c’était un saint. Mais alors que les deux poètes aimaient la nature, cette dernière était devenue étrangère à Victor : « L’hiver, le printemps et l’été passèrent pendant que je me livrais à mes travaux, mais ils m’absorbaient à tel point que je ne vis pas les fleurs s’ouvrir, ni les bourgeons se transformer en feuilles, spectacle qui avant ne manquait jamais de me ravir. Cette année là les feuilles se desséchèrent avant que mon travail n’approchât de sa fin. »
Ce dessèchement des feuilles était le premier signe d’une malédiction dont Victor avait souvent eu le pressentiment. Il évoque un mystérieux rapport entre l’âme des hommes et les phénomènes naturels auquel on était sensible à l’époque romantique. Un peu plus tôt dans le roman, Victor avait fait cette confession. « Apprenez donc sinon par mes préceptes du moins par mon exemple, combien il est redoutable d’acquérir certaines connaissances, et combien plus heureux que l’homme qui désire devenir plus grand que la nature ne l'y destine, est celui qui s’imagine que sa ville natale est le pivot de l’univers. »[6]
Ce sont des passages comme celui-là qui ont incité Asimov et ses lecteurs à ranger Mary Shelley parmi les médiévalistes, le plus bas degré, le plus primitif et le plus pessimiste dans l’échelle des rapports de l’homme avec le robot. « C’est pourquoi les médiévalistes adoptent une position pessimiste du refus des robots sur terre. D’autant plus qu'ils sont sous l’influence d’un très puissant complexe : celui de Frankenstein qui est le nom du héros d’un roman de l’époque médiévale, qui construisit un robot, lequel se retourna contre son créateur. »[7]
Frankenstein ou le Prométhée moderne. Le sous-titre du roman prend ici tout son sens. Mary Shelley connaissait bien les tragiques grecs et donc l’histoire de Prométhée, racontée notamment par Eschyle. Elle savait que l’ubris, la démesure, était la définition même du mal pour les anciens grecs, mais aussi l’essence de la tragédie, laquelle illustre le châtiment, la Némésis, qu'entraîne la démesure. Victor sera poursuivi par sa créature comme Oreste par les Erinnyes.
C’est moins en tant que grecque qu'en tant que chrétienne que Mary Shelley condamne l’œuvre de Victor. Comme elle l’a fait naître dans une famille chrétienne et l’a fait vivre comme un ascète, on peut même penser qu'elle voit le christianisme comme la cause de sa démesure plutôt que comme le fondement de sa punition.
Nuance, car le christianisme, dont Mary restait imprégnée avait aussi ses raisons de craindre la démesure dans la connaissance, comme en témoigne cette page éblouissante du Génie du christianisme :
« L'homme pouvait détruire l'harmonie de son être de deux manières, ou en voulant trop aimer, ou en voulant trop savoir. Il pécha seulement par la seconde : c'est qu'en effet nous avons beaucoup plus l'orgueil des sciences que l'orgueil de l'amour : celui-ci aurait été plus digne de pitié que de châtiment; et si Adam s'était rendu coupable pour avoir voulu trop sentir plutôt que de trop concevoir, l'homme peut-être eût pu se racheter lui-même, et le Fils de l’Éternel n'eût point été obligé de s'immoler. Mais il en fut autrement : Adam chercha à comprendre l'univers, non avec le sentiment, mais avec la pensée; et touchant à l'arbre de science, il admit dans son entendement un rayon trop fort de lumière. A l'instant l'équilibre se rompt, la confusion s'empare de l'homme. Au lieu de la clarté qu'il s'était promise, d'épaisses ténèbres couvrent sa vue : son péché s'étend comme un voile entre lui et l'univers. Toute son âme se trouble et se soulève; les passions combattent le jugement, le jugement cherche à anéantir les passions; et dans cette tempête effrayante, l'écueil de la mort vit avec joie le premier naufrage. »
« Tel fut l'incident qui changea l'harmonieuse et immortelle constitution de l'homme. Depuis ce jour les éléments de son être sont restés épars, et n'ont pu se réunir. L'habitude, nous dirions presque l'amour du tombeau, que la matière a contractée, détruit tout projet de réhabilitation dans ce monde, parce que nos années ne sont pas assez longues pour que nos efforts vers la perfection première puissent jamais nous y faire remonter. » [8]
Grecque et encore chrétienne, Mary Shelley avait donc deux raisons de penser que son héros faisait le mal en croyant guérir l’homme de la maladie. Mais pourquoi Victor est-il allé jusqu’au bout de sa démarche, envahi par la culpabilité comme il l’était? Peut-être faudrait-il poser la question à ceux qui ont créé les premiers organismes génétiquement modifiés. Le pire aurait pu se produire. Ils ont cru qu'il ne se produirait pas, du moins dans l’immédiat.
Il est vrai que dans le cas de Victor l’enjeu était plus grand et plus grave : il créait un individu qui, s’il avait pu se reproduire, aurait pu fonder une nouvelle espèce. Sa première réaction, un rejet total de sa créature est tout de même étonnante : autant il avait mis de rationalité, de science, de méthode, de patience à la créer, autant il mit de passion et d’irréflexion à la rejeter. Et pourquoi l’a-t-il faite monstrueuse? Acte manqué? Tout se passe en effet comme si Victor avait voulu démontrer que l’homme peut créer la vie et, du même coup, tuer dans l’œuf chez ses descendants tout désir de reproduire cette prouesse. Il faut ici préciser que le monstre, qui finira pas prendre le nom de son créateur, n’était ni un robot, ni un clone, mais une âme embryonnaire dans un corps achevé. Beau sujet de réflexion pour ceux qui s’intéressent à la domination de l’homme par l’homme. Le monstre était libre. Or, quiconque avait observé les révoltes de l’homme, également libre, pouvait craindre la pire des révoltes des monstres contre des hommes n’ayant pas la toute puissance de Dieu.
Voici la page clé du livre de Mary : « Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat de mes longs travaux. Avec une anxiété qui me mettait à l'agonie, je disposai à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà une heure du matin. La pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux, et la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la lueur de la flamme vacillante, je vis la créature entrouvrir des yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément, et ses membres furent agités d'un mouvement convulsif.
 Comment pourrais-je dire l'émotion que j'éprouvais devant cette catastrophe, ou trouver les mots pour décrire l'être repoussant que j'avais créé au prix de tant de soins et de tant d'efforts? Ses membres étaient, certes, bien proportionnés, et je m'étais efforcé de conférer à ses traits une certaine beauté. De la beauté! (Grand Dieu! ) Sa peau jaunâtre dissimulait à peine le lacis sous-jacent de muscles et de vaisseaux sanguins. Sa chevelure était longue et soyeuse, ses dents d'une blancheur nacrée, mais cela ne faisait que mieux ressortir l'horreur des yeux vitreux, dont la couleur semblait se rapprocher de celle des orbites blafardes dans lesquelles ils étaient profondément enfoncés. Cela contrastait aussi avec la peau ratatinée du visage et de la bouche rectiligne aux lèvres presque noires.
Comment pourrais-je dire l'émotion que j'éprouvais devant cette catastrophe, ou trouver les mots pour décrire l'être repoussant que j'avais créé au prix de tant de soins et de tant d'efforts? Ses membres étaient, certes, bien proportionnés, et je m'étais efforcé de conférer à ses traits une certaine beauté. De la beauté! (Grand Dieu! ) Sa peau jaunâtre dissimulait à peine le lacis sous-jacent de muscles et de vaisseaux sanguins. Sa chevelure était longue et soyeuse, ses dents d'une blancheur nacrée, mais cela ne faisait que mieux ressortir l'horreur des yeux vitreux, dont la couleur semblait se rapprocher de celle des orbites blafardes dans lesquelles ils étaient profondément enfoncés. Cela contrastait aussi avec la peau ratatinée du visage et de la bouche rectiligne aux lèvres presque noires.
Bien que multiples, les péripéties de l'existence sont moins variables que le sont les sentiments humains. Pendant deux années, j'avais travaillé avec acharnement, dans le seul but d'insuffler la vie à un organisme inanimé. Je m'étais pour cela privé de repos, et j'avais sérieusement compromis ma santé. Aucune modération n'était venue tempérer mon ardeur. Et pourtant, maintenant que mon œuvre était achevée, mon rêve se dépouillait de tout attrait, et un dégoût sans nom me soulevait le cœur. »[9]
Après avoir créé Adam et Ève, Dieu, selon la Genèse, s’était montré heureux de son œuvre. « Et Dieu vit que cela était bon. » Ce que Victor avait sans doute compris en découvrant son œuvre c’est qu'il est si difficile d’imiter Dieu que celui qui ose le faire malgré tout risque plus de produire un monstre qu'un être harmonieux. Et sans doute, s’il avait pu raisonner froidement, aurait-il compris que pour éviter les retombées de son acte, il lui aurait fallu créer un être programmable plutôt qu'un être libre. Seul un Dieu en effet pouvait prendre le risque de créer un être libre.
Emporté par son désir de puissance, Victor avait, si l’on peut dire, enfanté le monstre sans manifester le moindre sentiment à l’endroit de l’être en croissance qu'il avait sous les yeux. Il avait agi sous le signe du secret, de la solitude et de la parfaite indifférence. Il n’est pas interdit de voir là une préfiguration du destin du fœtus dans un utérus artificiel. « Je collectais des os dans un charnier et je violais de mes doigts profanes les secrets extraordinaires des organismes humains. » Il n’était que volonté de puissance : « La vie et la mort me semblaient des limites idéales qu'il me fallait franchir, avant de déverser sur notre monde enténébré un torrent de lumière. »[10]
À l’origine du moins, le monstre c’était Victor, sa créature était née innocente. Il s’était empressé de projeter en elle une difformité intérieure personnelle, qu'il ne pouvait supporter un instant de plus. D’où la grave maladie dont il souffrit dans les mois qui ont suivi l’envol de sa créature.
L’opinion publique, aidée en cela par les cinéastes, a fait de Frankenstein (fils) un tueur sans conscience, alors qu'à l’état de nature il ressemblait plutôt à la bête du célèbre conte la Belle et la Bête. Au fur et à mesure qu'il prit conscience de la gamme des sentiments que les hommes peuvent éprouver, il ne désira qu'une chose : inspirer et éprouver un amour, bonheur qui lui sera toujours refusé, en raison de sa repoussante laideur. Vu sous cet angle, il apparaît comme l’archétype de l’homme qui est devenu criminel faute d’avoir reçu le minimum d’amour qui l’aurait comblé.
Le plus beau passage du roman est celui où après avoir observé une famille heureuse depuis sa cachette dans un hangar, il se prend au désir d’avoir son humble part de ce bonheur. Il sait qu'il ne peut se montrer sans provoquer la terreur de ceux qui le voient. Mais il a remarqué que dans la maison qu'il observe, la personne la plus aimable, le grand père, est aveugle. Et il sait que sa voix est aussi douce que celle des habitants de la maison. Il s’approche donc du vieil aveugle et entame avec lui une conservation qui le transporte dans la plus grande joie, une joie qui s’arrêtera brutalement lorsque les autres membres de la famille feront irruption dans la pièce et l'attaqueront sauvagement. Tout à son malheur, il ne se défend même pas, alors qu'il lui aurait suffi de quelques gestes pour les tuer un à un.
Aura-t-il désormais d’autres choix que de tuer les humains pour entrer en contact avec eux? En même temps que l’amour, il avait découvert la femme et son absence dans sa genèse aussi bien que dans vie. « Homme et femme il les créa. » Ici il faut revenir à la Bible. Victor n’avait pas cru nécessaire d’imiter Dieu au point de donner une femme à sa créature, et sa créature le lui reproche dans une supplique qui jette une lumière singulière sur toutes les formes de procréation artificielle.
Avant de quitter le laboratoire, lieu de sa genèse et de sa naissance, où son créateur l’avait abandonné, Frankenstein s’était emparé d’une veste de Victor contenant des papiers. Ces papiers il put les lire et en livra ensuite l’essentiel à Victor en ces termes : « Le processus des faits scandaleux ayant abouti à ma création y est expliqué en détail et mis en évidence. Une description minutieuse de mon affreuse et répugnante personne y figure, rédigée en termes qui exprimaient bien votre horreur et qui allaient rendre la mienne ineffaçable. La lecture de ce document me souleva le cœur. ''Maudit soit le jour qui m'a vu naître !'' m'écriai-je, désespéré. Damné créateur! Pourquoi avez-vous façonné un monstre à ce point hideux que même vous, vous vous êtes détourné de moi, plein de dégoût? Dieu dans sa pitié fit l'homme beau et attrayant, à sa propre image; mais mon être est une version immonde du vôtre, rendue plus horrible encore par cette ressemblance. Satan, lui, avait au moins des compagnons, d'autres diables pour l'admirer et l'encourager. Mais moi, je suis seul et détesté de tous. […] Je n’avais pas d’Ève pour adoucir mes peines ou partager mes pensées. J’étais seul! Je me souviens des supplications d’Adam à son créateur. Mais où était mon créateur à moi? Il m’avait abandonn ! Et dans l’amertume de mon cœur, je le maudissais. »[11]
Comment interpréter cette supplique à la lumière de tous les changements survenus dans le monde de la reproduction humaine depuis trente ans? Tel enfant conçu comme Frankenstein dans l’anonymat et les procédés techniques d’un laboratoire ne subira peut-être pas les séquelles d’une telle entrée dans la vie. Il n’empêche que dans l’acceptation même de la fécondation in vitro et de toutes les interventions souvent eugénistes dont elle est l’occasion, il y a un glissement vers l’anonymat et vers la froide technicisation d’actes qui s’accomplissaient dans la chaleur et la présence humaines. Dans une société évoluant dans cette direction on aimera de moins en moins les enfants et la solitude les frappera davantage, comme elle frappera davantage les personnes âgées, pour les mêmes raisons. Le désir d’enfant, si fort dans le cas de ceux qui ne sont pas naturellement en mesure de procréer, ne témoigne nullement d’une acceptation accrue des enfants dans la société. Il témoigne plutôt d’un mode de vie si éloigné de la vie et de ses rythmes qu'il provoque la stérilité.
La fécondation in vitro n’est pas un acte isolé, sans effet sur l’ensemble de la vie des sociétés, elle s’accompagne d’une transformation de l’imaginaire dont on sous-estime généralement les effets . Est-ce par hasard que tant d’adolescentes courent le risque de l’anorexie pour conserver un corps ressemblant à celui d’une vierge filiforme plutôt qu’à celui d’une mère?
À l’origine de cette nébuleuse créatrice de solitude et de froideur entre les êtres, il y a aussi le choix, la seule dimension de la liberté à laquelle nous sommes vraiment attachés : choix d’avoir ou de ne pas avoir un enfant, choix de son sexe et de ses qualités. Le respect de la nature limitait les choix, ce sont maintenant les choix qui font reculer la nature. La plupart de nos choix en ce moment sont des choix contre la nature. D’où cette fissure profonde au cœur de nos sociétés et au fond de chacun de nous. Par un côté de nous, nous nous attachons à la nature et nous croyons l’aimer, par l’autre nous idolâtrons le choix et nous lui sacrifions la nature. Tous ces facteurs convergent vers le même but : le recul de la vie, l’emmachination des êtres humains. Et si tout cela, qui devient de plus en plus manifeste, ne nous inquiète pas outre mesure n'est-ce pas parce que, devenant nous-mêmes de plus en plus semblables aux machines, nous continuons de nous reconnaître dans un monde qu'elles dominent de plus en plus?
On pourrait croire que c’est cet avenir que Mary Shelley voyait venir avec horreur. Ce ne semble pas être le cas. En 1826, elle publiera un roman futuriste intitulé The Last Man, où elle montrera une humanité entière détruite, non par la démesure de l’homme, mais par une épidémie apparaissant comme une vengeance des dieux contre une humanité qui n’avait pas su se guérir de ses vices. Ce qui la fait apparaître comme une inconsolable romantique déçue à l’avance aussi bien par une humanité demeurée traditionnelle, comme c’est le cas dans The Last Man que par une humanité hautement technicisée comme celle qui s’ébauche dans le laboratoire de Victor à Ingolstadt.
Tout nous incite par ailleurs à considérer Frankenstein comme le premier roman de la Némésis technologique. Ivan Illich publiera au début de la décennie 1970, un essai intitulé la Némésis médicale dans lequel il montrera comment la médicalisation excessive des sociétés et la perte d’autonomie des personnes qui en est la conséquence deviendra avec le temps contre-productive au point que les maladies iatrogènes, provoquées par les traitements médicaux deviendront aussi fréquentes que les maladies naturelles. La Némésis que préfigure le destin de Frankenstein serait celle où, à force de techniciser la reproduction humaine jusqu’au recours à l’utérus artificiel, on produirait des êtres humains n’aspirant qu'à devenir de plus en plus semblables aux conditions de leur naissance, seule façon pour eux de ne pas en ressentir l’horreur.
Victor ne donnera pas à Frankenstein la compagne qu’à bon droit il réclamait de lui : « (une) Ève pour adoucir mes peines ou partager mes pensées ».
Ce monstre me devient de plus en plus cher à mesure que j’avance dans le roman tandis que son créateur me paraît de plus en plus odieux. Il avait toutes les raisons du monde d’éprouver de la compassion pour sa créature, même après qu'elle eût étranglé ses proches. N’était-il pas responsable de cette laideur qui lui valut la haine de tous les humains qu'elle a rencontrés et n’est-ce pas cette haine qui l’avait conduite sur le chemin du crime?
La fin du roman donne à réfléchir. Victor pourchasse sa créature jusqu’au pôle Nord. Il mourra avant elle sur un bateau, mais alors qu'il n’y a plus de place en lui que pour une haine dictée par sa culpabilité, le monstre se montre capable de pardon et d’une lucidité sans failles :
« Lorsque je parcours l'effrayant catalogue de mes crimes, je ne puis imaginer que je suis cette même créature dont les pensées étaient emplies naguère de visions sublimes et transcendantes de la beauté et de la majesté du bien. Mais il en va ainsi! L'ange déchu devient un diable monstrueux. Cependant, même cet ennemi de Dieu et de l'homme connaît dans sa désolation, des amis et des compagnons. Moi, je suis seul. »[12]
Moi je suis seul. Irrémédiable solitude de l’homme enfanté par des machines, produit d’un climat social où les liens vivants se brisent un à un, à commencer par ceux qui unissaient un homme et une femme dans l’acte d’enfanter.
[1]Vacquin, Monette, Frankenstein ou les délices de la raison, Éditions François Bourin Paris 1989, p.10.
[2] Op.cit., p 10
[3] Op.cit., p.11
[4] Shelley, Mary, Frankenstein, Marabout, Paris 1978, p.60
[5] Op.cit., p. 71
[6] Op.cit., p. 82
[7] Béland, Jean Pierre, Georges A.Legault, Asimov et l’accessibilité des robots, PUL, Québec, p.21
[8] Chateaubriand, Génie du christianisme, Tome premier, Librairie Garnier, Paris, 1930 p.83-85
[9] Shelley, Mary, Frankenstein, Marabout, Paris 1978, p.91
[10]Op.cit., p.84
[11] Op.cit., p.217
[12] Op.cit., p.376






