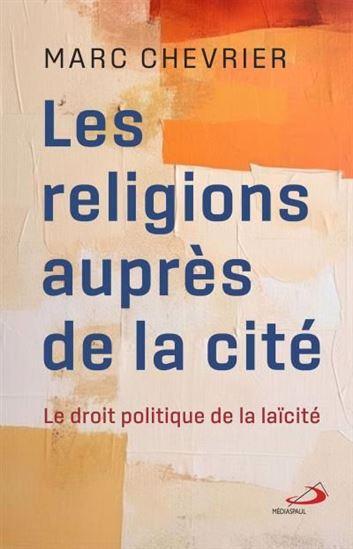La vie des empires en temps de pandémie
La vie des empires en temps de pandémie
On trouvera ici quelques extraits de l’ouvrage de Marc Chevrier, ami de longue de date de l’Encyclopédie de l’Agora, paru peu de temps avant le basculement du monde dans la pandémie de la covid-19. Certains passages peuvent nous éclairer sur la dynamique du pouvoir dans les grands ensembles humains, qu’exacerbe une crise comme celle de la pandémie actuelle.
Marc Chevrier, L’empire en marche. Des peuples sans qualités, de Vienne à Ottawa, Paris, Hermann, Québec, presses de l’Université Laval, 2019, 635 p
Entretien avec Mathiey Bock-Côté sur QUB RADIO
L’esprit de dissociation en régime fédéral et l’indigénat administratif colonial, p. 225-228.
Dans cet extrait, l’auteur étudie comment les régimes fédéraux cultivent à un degré extrême la dissociation des tâches et du pouvoir suivant une logique impériale de domination. Il illustre son propos à partir de l’exemple européen et des enseignements tirés par l’écrivain George Orwell de la gouverne coloniale britannique en Birmanie. En effet, à l’instar de l’empire, le régime fédéral tient sur le principe que l’instance supérieure gouverne sans administrer. C’est justement ce qu’on observe dans la crise actuelle : que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe, le palier fédéral ou supranational semble planer au-dessus de la mêlée, alors que les États en Europe, et souvent par l’entremise de leurs gouvernements régionaux comme en Italie et en Allemagne, et les états fédérés en Amérique du Nord, sont à la manœuvre, les deux mains gantées et le visage masqué. Au Québec, c’est l’état du Québec, en principe responsable du système de santé, qui administre les hôpitaux et les CHSLD, l’équivalent des EHPAD en France ; le palier fédéral, quant à lui, surplombe la scène de haut, en se réservant les grandes prérogatives, les finances, l’armée, les frontières et la vigile scientifique. En temps de pandémie, il a fait valser les milliards et multiplie les directives générales, appuyé de ses experts sanitaires ; il joue le sauveur, mais en laissant les tâches ingrates et besogneuses aux paliers inférieurs, quitte à dépêcher quelques soldats en renfort dans les maisons de retraite au bord du naufrage, comme les gouvernements fédéraux canadien et belge l’ont fait.
Ce qui achève d’éloigner les collectivités fédérées de l’exercice véritable de la souveraineté est cette autre dissociation que le partage des compétences en régime fédéral tend à établir entre fonction impérante et fonction d’administration, c’est-à-dire que la fonction législative est concentrée pour les domaines les plus névralgiques dans l’État fédéral, alors que l’exécution des normes, fédérales et étatiques, revient plutôt aux collectivités fédérées. Cette dissociation est bien sûr observable surtout dans les fédérations germaniques et dans l’Union européenne, au sein desquelles beaucoup de compétences législatives connaissent un système de concurrence qui fait en sorte que les collectivités ne peuvent légiférer à l’égard de certaines matières que si l’échelon supérieur s’est abstenu de le faire. Fort d’une telle répartition des compétences, le gouvernement du Bund allemand a peu à peu centralisé l’exercice de la fonction législative depuis 1949, pour ne laisser aux Länder qu’un domaine législatif étriqué et l’exécution des lois fédérales. Il s’avère que ce système, dont on retrouve l’équivalent dans le cadre unique de l’Union européenne, où les États membres vouent une partie significative de leur activité législative nationale à la mise en oeuvre des directives européennes, serait une survivance du Saint-Empire romain germanique, qui aurait marqué les fédérations allemande, autrichienne et suisse. Cependant, dans le Saint-Empire, la fonction législative autonome de l’empereur était quasi inexistante, alors que dans ces fédérations, et dans une moindre mesure dans l’Union européenne, la fonction législative de l’ordre fédéral ou supranational s’approche de celle de l’État national. La fédération serait donc un empire législativement centralisé.
Dans les systèmes fédéraux à dominante anglo-saxonne, cette dissociation est moins prononcée, tant et si bien que les collectivités fédérées administrent peu de politiques fédérales et édictent leurs propres lois à l’égard d’une liste de matières plus étendue que dans les fédérations germaniques. Toutefois, l’État fédéral n’est pas en reste et détient plusieurs leviers législatifs, fiscaux et judiciaires pour court-circuiter, encadrer et centraliser la fonction impérante des états. Grâce à des pouvoirs législatifs unilatéraux, il peut ainsi intervenir dans les secteurs ressortissant exclusivement aux collectivités fédérées ; par l’exercice de son pouvoir financier, il ne se prive guère de normaliser les législations fédérées ; enfin, il se fie à une puissante Cour suprême qui, dans les fédérations anglo-saxonnes, de Canberra à Ottawa, voit généralement à renforcer l’autorité législative de l’État fédéral, quitte, de temps à autre, à sanctionner certains excès de zèle législatif pour maintenir l’apparence d’un équilibre fédératif. Autre facteur qui peut parfois limiter la puissance administrative des états fédérés : l’autonomie ou l’intégration de leur fonction publique. En Inde, les fonctions publiques des états et celle de l’Union sont regroupées dans un même corps, l’All India Services, placé sous l’autorité du premier ministre fédéral.
On notera, du reste, que les Britanniques s’étaient fait une spécialité de la dissociation entre les tâches législatives et de commandement et celles d’administration pour la direction de leur empire. George Orwell observa dans un texte consacré à la domination britannique de la Birmanie que la politique impériale de son pays tenait dans cette formule : « Ne jamais faire faire à un Européen ce que peut faire un Oriental[i]. » Expliquant le sens de cette formule, il écrit :
En d’autres termes, le pouvoir suprême demeure entre les mains des autorités britanniques, mais les petits fonctionnaires, ceux qui exécutent les besognes administratives et doivent, de par leurs fonctions, se trouver en contact direct avec le peuple, se recrutent parmi les indigènes. En Birmanie, par exemple, les magistrats de second plan, les policiers jusqu’au grade d’inspecteur exclusivement, les postiers, les employés du gouvernement, les édiles villageois, etc., sont des Birmans. Au cours de ces dernières années, pour calmer les esprits et mettre un frein à une agitation nationaliste qui commençait à devenir inquiétante, on décida même d’accepter la candidature d’indigènes instruits à divers postes importants[ii].
Pour Orwell, ce système de l’indigénat administratif représentait trois avantages décisifs. Premièrement, les indigènes ont généralement des exigences salariales plus faibles que celles des Européens. Deuxièmement, comme les indigènes ont une meilleure connaissance de « la mentalité de leurs compatriotes », ils peuvent donc mieux régler les questions épineuses. Enfin, écrit Orwell, « ils ont intérêt à se montrer loyaux envers un gouvernement qui les emploie et les nourrit ». La loyauté ainsi acquise permet d’obtenir « la collaboration étroite des classes instruites ou semi-instruites, dont le mécontentement risquerait de faire des leaders de rebelles ». Avec ce système, les Britanniques sont devenus « les maîtres du pays ». Orwell n’indique toutefois rien sur l’origine de l’indigénat collaborationniste et administratif. Il est loisible de penser qu’il remonte à aussi loin que l’Acte de Québec de 1774, par lequel le Parlement de Westminster, contre l’avis défavorable d’Edmund Burke, accorda aux habitants de sa colonie française des libertés et la jouissance de ses institutions civiles et religieuses. La loi britannique dispensa notamment les sujets catholiques du serment du test, imposé après la conquête de 1763, qui les excluait de l’administration coloniale. Ce faisant, elle inaugura une longue pratique collaborationniste de recrutement des « indigènes » aux fonctions subalternes et de leurs éléments les plus ambitieux à quelques postes de plus haut niveau. Selon un historien de l’Empire britannique, « les administrateurs impériaux surent tirer des leçons fructueuses de l’Acte de Québec, qui maintinrent par la suite les institutions locales reçues de leurs autres conquêtes et les adaptèrent avec un franc succès[iii] ». Ce détour par l’histoire de l’Empire britannique jette un éclairage sur ce qui sous-tend la division entre législation et administration présentée d’ordinaire dans les études sur le fédéralisme comme une simple modalité technique de répartition des tâches gouvernementales. Cette division a l’avantage de concentrer les fonctions déterminantes de la souveraineté dans l’État fédéral et de confier l’administration, fédérale et étatique, à des collectivités aux fonctions impérantes limitées, mais astreintes aux tâches subalternes de services à la population qu’exécutent des fonctionnaires recrutés localement. Autour de celles-ci se greffent de petites bourgeoisies jouissant d’une certaine aisance, aux horizons bornés aux sphères de leurs tâches, qui trouvent du contentement dans leur statut de préposées à la mise en oeuvre des grands desseins arrêtés dans la capitale fédérale et modulés dans la capitale fédérée.
Pierre Elliott Trudeau et Lord Acton sur l’empire, p. 572-575
La pandémie de la covid-19 a vu de nombreux États concentrer soudainement d’immenses pouvoirs, en décrétant des mesures d’urgence exceptionnelles. Certains y ont vu le signe d’une dérive despotique ou même totalitaire, qui a remis à l’honneur une célèbre phrase de Lord Acton : « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. » Mais à part cette phrase devenue une antienne du libéralisme, on connaît peu les idées de cet aristocrate catholique qui connut une courte carrière au sein du Liberal Party anglais à la fin du XIXe siècle et qui conseilla le premier ministre Gladstone. Dans le monde anglo-saxon, Acton obtient la notoriété grâce à sa critique de la démocratie et de la liberté nationale, à ses yeux intrinsèquement dangereuses, qui devaient être contenues notamment par les empires multinationaux et le fédéralisme. Acton a joui d’une grande popularité au Canada, notamment auprès de Pierre Elliott Trudeau, dont il marqua la pensée et raffermit sa résolution de combattre le nationalisme, convaincu que le Québec était une société imparfaite, incapable de se gouverner par elle-même. Comme le montre l’extrait, Acton et Trudeau se rejoignent sur un point essentiel : pour les deux, le fédéralisme et l’empire multinational résident sur le principe d’une hiérarchie émulatrice, qui met en concurrence des « nationalités » jugées inaptes, peu évoluées ou immatures avec une nationalité supérieure, si bien que les premières s’amendent et se civilisent sous l’emprise de l’autre. Mais à cet égard, Trudeau s’avère plus radical encore que Lord Acton.
On a vu comment le nationalisme impérial canadien a, dès ses balbutiements, vanté les synthèses réalisées par l’Empire britannique. À la faveur d’un choix judicieux de peuples qui grossiront par l’immigration les peuples déjà présents dans la colonie et réunis, au Canada, par la grâce de la conquête, il serait aussi possible d’atteindre à une nouvelle mouture humaine, supérieure à la somme de ses parties, c’est-à-dire formée des meilleurs éléments venus du monde. Ce genre de raisonnement apparaît clairement chez John Bourinot, qui loue, dans sa comparaison de la Grande-Bretagne avec le Canada qui auraient tous les deux su offrir un terreau favorable à la souche teutonne, le pouvoir synthétique et dialectique des conquêtes, celle des Normands en 1066 et celle de la Grande-Bretagne en 1763[iv]. Dans les deux cas, la nation conquise s’est revivifiée au contact avec l’envahisseur ; la nation anglaise s’est ressaisie pour garantir son esprit de liberté naturel à son caractère teuton contre l’influence normande, et la nation française du Canada, délivrée du despotisme latin de la France, a pu renouer, non sans quelques convulsions, avec ses qualités teutonnes laissées en dormance. Face à la nation britannique qui a tôt atteint sa majorité, la nation canadienne-française, encore dans sa minorité, se blottirait donc sous la discipline salvatrice de la nation aînée.
Lord Acton, également l’une des grandes inspirations de Pierre Elliott Trudeau, a vanté la qualité synthétique des conquêtes et des empires qui se sont construits sur elles. Acton donna aussi dans le teutonisme, comme plusieurs de ses contemporains. Il écrivit, en effet :
C’est un fait pur et simple qu’on n’a pu atteindre jusqu’ici le type de liberté que l’Église en tout temps et en tous lieux a nécessité que dans les États d’origine teutonne. Nous avons à peine besoin de voir l’importance de cette observation pour considérer la vocation missionnaire de la race anglaise dans les lointaines régions qu’elle a peuplées et parmi les nations qu’elle a conquises ; car, en dépit de l’apostasie religieuse, aucun autre pays n’a su préserver dans sa pureté l’idée de liberté qui a conféré à la religion son ancien pouvoir en Europe, laquelle demeure la fondation de la grandeur de l’Angleterre[v].
[…]
Acton était convaincu que les nations ne sont pas égales dans leur capacité à embrasser un régime politique ou un autre. Une nation sortie de la barbarie ne peut se gouverner elle-même ; de même, « un peuple qui s’est voué à l’égalité, ou à la monarchie absolue, est incapable de produire une aristocratie[vi] » ; c’est pourquoi, selon Acton, toute politique sensée doit tenir compte du facteur national, car il détermine le type de régime politique qui convient à une population. « Le déni de la nationalité implique donc le déni de la liberté politique », écrit Acton. La pensée de Trudeau renfermait aussi une échelle des nationalités, de la moins à la plus éduquée politiquement, en vertu de laquelle il incombait au Canada britannique d’initier le Canada français à l’art du gouvernement démocratique. Le Canada français, en effet, formait pour lui « un peuple qui n’a pas encore appris à se gouverner lui-même », « un peuple où la démocratie ne peut pas être prise pour acquise[vii] ».
Un autre point de la pensée d’Acton que n’aurait pas désapprouvé Trudeau est la nécessité de mêler les « races », c’est-à-dire les nations, pour garantir à l’ensemble multinational plus de stabilité et atteindre un degré de perfection plus achevé que la rudimentaire synthèse des États moins mélangés[viii], comme le Mexique qui, aux yeux d’Acton, se contentait de diviser les « races » en fonction du sang, sans les distribuer sur plusieurs régions[ix]. C’était là aussi un des aspects centraux de la pensée politique de Trudeau, qui a conçu justement sa politique de bilinguisme officiel en vue de déconcentrer la population canadienne-française, pour inciter les Franco-Québécois à immigrer en dehors du Québec par la promesse qu’ils pourront y faire instruire leurs enfants en français dans le système public d’éducation aux cycles primaire et secondaire. De même, une politique d’immigration active conduite sous le chapeau idéologique du multiculturalisme encourage le métissage multiethnique des populations, surtout dans les centres urbains, dont le pays devrait sortir fortifié. Ce brassage de populations contribuera également à amoindrir l’homogénéité prétendument monolithique que l’élite canadienne-anglaise a longtemps prêtée au Canada français dont la morale close aurait empêché un sain mélange et l’émancipation individuelle. Autrement dit, si le brassage multiethnique ne pouvait garantir l’éradication rapide du fait français au Canada, on pouvait en espérer néanmoins l’alignement progressif des moeurs des Canadiens français sur le libéralisme anglo-protestant. […]
Il y a toutefois un point central sur lequel Trudeau s’écarte d’Acton et qui révèle la radicalité de la pensée du futur premier ministre. Tous les deux conçoivent, pour reprendre l’expression de John Porter, l’empire multinational ou l’État non national comme des mosaïques verticales qui rassemblent des nations diverses soumises à une émulation en principe bienfaisante sous la tutelle d’une nation dominante. Chez Acton, la verticalité de l’empire ne vise toutefois pas l’extinction entière des nations, il doit, au contraire, les maintenir, leur assurer un minimum de vitalité, en les dissuadant toutefois de vouloir s’ériger elles-mêmes en États ; elles doivent donc subir une certaine dépolitisation, qui leur fait accepter leur existence sous les angles social, culturel, religieux, ethnolinguistique en renonçant toutefois à la liberté politique. Acton écrit : « [u]n État qui est incapable de satisfaire différentes races se condamne lui-même ; un État qui s’efforce de les neutraliser, de les absorber ou de les expulser détruit sa propre vitalité ; un État qui ne les inclut pas en son sein se prive du fondement du gouvernement démocratique (self-government)[x] ». Or, chez Trudeau, une ambivalence fondamentale apparaît très tôt dans sa pensée, qui va ensuite se dissiper quand il deviendra premier ministre. Dans son essai « La nouvelle trahison des clercs », bien qu’il évoque l’État multinational, qui serait l’option préférée des constitutionnalistes qui récusent le principe des nationalités et l’État-nation, et même l’idée de nation canadienne-française ou britannique, il envisage aussi l’État multiethnique, où il n’y aurait en somme aucune nation particulière et qui ne serait constitué que de groupes ethniques. Il est révélateur que, s’agissant du partage fédératif des compétences législatives, il concède d’emblée toutes les matières à « incidence ethnique » aux autonomies fédérées, alors que les autres activités, qui touchent au « bien commun de l’ensemble de la société canadienne », ressortiraient au magistère fédéral[xi]. Or, pendant ses années au pouvoir, Trudeau s’est systématiquement opposé à toute reconnaissance du Québec comme nation, voire comme société distincte. De même, la politique fédérale du multiculturalisme a soigneusement évité d’introduire l’idée que la diversité culturelle du Canada serait adossée à une diversité de nations. Autrement dit, la mosaïque verticale rêvée par Trudeau puis mise en oeuvre par ses décisions et ses politiques serait celle qui aurait réussi, ou prétendu avoir réussi à « neutraliser » les ambitions nationales de ses communautés ethniques. En ce sens, l’État multiethnique parfait déboucherait sur l’État véritablement postnational, qui aurait dépassé la nation après avoir réussi à désamorcer la contestation nationaliste de ses groupes internes. Mais cette visée nourrit bien sûr une illusion, puisque, voulant saper la revendication politique de sa nation minoritaire, elle tait l’emprise de la nation dominante sur le corps politique tout entier.
L’exception ou la latence de la souveraineté impériale canadienne, p. 510-511
La crise de la covid-19 a conduit nombre d’États à se prévaloir de pouvoirs exceptionnels, qui restreignent considérablement les libertés et octroient aux organes exécutif et sanitaire des capacités qu’ils n’ont pas en temps normal. D’ordinaire, les États se fondent sur une disposition expresse de la constitution pour exercer ce pouvoir extraordinaire ou sur des lois qui les y autorisent. Bien qu’il n’y ait nulle mention d’un pouvoir d’urgence dans la constitution canadienne, les tribunaux britanniques ont reconnu au gouvernement fédéral la faculté de concentrer les pouvoirs pour faire face à une situation exceptionnelle, bel exemple des non-dits ou des « béances » dont le droit au Canada a fait un art de gouverner. Depuis le début de la crise, le gouvernement fédéral s’est jusqu’ici abstenu de déclarer l’urgence, en laissant aux états provinciaux le soin de décréter l’état d’urgence sanitaire chacun sur son territoire. Aux dires du constitutionnaliste André Binette, le gouvernement fédéral pourrait néanmoins, en usant de son pouvoir d’urgence aménagé depuis 1988 par une loi qui remplace la Loi sur les mesures de guerre utilisée en 1970 au Québec, prendre le contrôle des systèmes de santé provinciaux[xii].
Le Canada possède deux constitutions, l’ordinaire, qui divise la puissance publique en deux ordres, indépendants juridiquement l’un de l’autre, les états fédérés exerçant, au titre de la constitution, une compétence législative interne, puis l’exceptionnelle, de sorte qu’en situation d’urgence, que le cabinet fédéral est fondé à déclarer unilatéralement, le Parlement fédéral peut s’approprier l’ensemble des pouvoirs législatifs disponibles. Il se mue donc en Parlement impérial unitaire et retrouve ainsi la vérité originaire de son pouvoir à l’égard de la paix, de l’ordre et du bon gouvernement, tel qu’il est libellé au début de l’article de la loi constitutionnelle qui énumère ses compétences exclusives et qui forme la base légale du pouvoir résiduaire au Canada. Le pouvoir d’urgence fédéral entraîne une « éclipse pro tanto de la dimension fédérale de la Constitution », écrit le juriste Gérald Beaudoin[xiii]. Dans l’arrêt qui a validé ce pouvoir devant le Conseil privé de Londres, l’affaire Fort Frances de 1923, le juge Haldane – et adepte de la réconciliation du droit avec la sittlichkeit [xiv]– a vu dans la clause Paix, Ordre et Bon Gouvernement la seule disposition constitutionnelle qui exprime la souveraineté de l’État dans sa plénitude et transforme le Parlement fédéral canadien en égal du Parlement de Westminster[xv]. Pouvoir de création purement judiciaire, aucunement mentionné dans la constitution, il échappe à tout contrôle véritable de son déclenchement. Le cabinet fédéral l’a utilisé en temps de paix, notamment pour pacifier les résistances périphériques, comme à l’occasion des événements d’octobre 1970 au Québec. La nouvelle Loi sur les mesures d’urgence, adoptée en 1988, en a raffiné les modalités d’exercice[xvi]. Elle a maintenu le principe que l’exécutif fédéral, possédant à la fois l’auctoritas et la potestas, peut déclarer de son propre chef différents états de crise – état de sinistre, état d’urgence, état de crise internationale, état de guerre –, sans devoir préalablement recevoir l’autorisation d’une instance qui lui est extérieure. Il doit au plus consulter les exécutifs des états provinciaux. On prévoit certes que les deux chambres du Parlement doivent être saisies d’une motion en vue de ratifier la déclaration de l’exécutif dans un délai d’une semaine. Cependant, c’est là une exigence purement formelle, dans un contexte de parlementarisme majoritaire, où le gouvernement dispose d’ordinaire d’une majorité à la première chambre et peut aussi compter à la deuxième chambre sur le ralliement de sénateurs nommés par les cabinets fédéraux, chambre à la légitimité démocratique trop faible pour fonder un quelconque contre-pouvoir crédible.
[i] George Orwell, « Comment on exploite un peuple : l’Empire britannique en Birmanie », dans Écrits politiques (1928-1949), Paris, Agone, 2009, p. 42
[ii] Ibid.
[iii] Nigel Dalziel, The Penguin Historical Atlas of British Empire, Londres, Penguin Books, 2006, p. 38.
[iv] John George Bourinot, « Canadian Studies In Comparative Politics », 1- Canada and England, Mémoires de la société royale du Canada, section II, 1890, p. 3 et ss.
[v] Lord Acton, « Political Thoughts on the Church », dans John Emerich Edward Dalberg-Acton, The history of freedom and other essays, New York, Books for Librairies Press, 1967, p. 204.
[vi] Acton, op. cit., « Nationality », p. 297.
[vii] Pierre Elliott Trudeau, « Un manifeste démocratique », Cité libre, octobre 1958, 22, p. 1-31 ; reproduit dans Yvan Lamonde (dir.), Cité libre une anthologie, Montréal, Stanké, p. 102.
[viii] Acton, op. cit., « Nationality », p. 296.
[ix] Acton, op. cit. p. 295.
[x] Acton, op. cit., « Nationality », p. 298.
[xi] Trudeau, « La nouvelle trahison des clercs », reproduit dans Yvan Lamonde (dir.), Cité libre une anthologie, op. cit., p. 165.
[xii] Voir André Binette, « La pandémie et la constitution canadienne », L’Aut’Journal, 5 mai 2020, en ligne : http://lautjournal.info/20200505/la-pandemie-et-la-constitution-canadienne. Les pouvoirs exceptionnels octroyés à l’exécutif fédéral par la Loi sur les mesures d’urgence sont aussi étudiés dans cette chronique de David Dyzenhaus, « Canada the Good? », Centre d’études constitutionnelles, 27 avril 2020, en ligne : https://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/2020/04/canada-the-good/ .
[xiii] Gérald-Beaudoin, Le fédéralisme au Canada, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2000, p. 469.
[xiv] La sittlichkeit, ou la moralité objective selon le philosophe Hegel.
[xv] Voir Fort Frances Pulp and Power c. Manitoba Free Press co., [1923] A.C., p. 704-705.
[xvi] L.C. 1988, ch. 29.