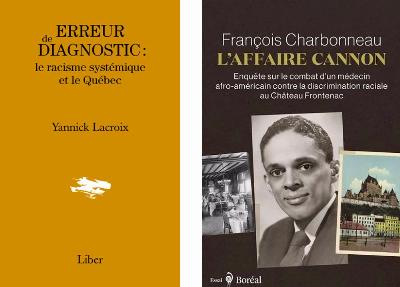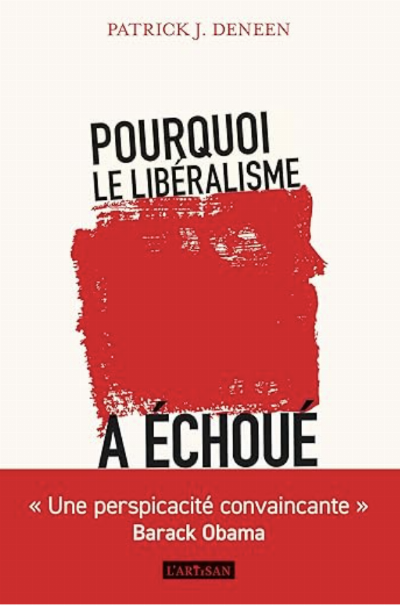La double allégeance de l’électeur souverainiste ou l’hypothèse du bluff électoral québécois
Pour une 42e fois depuis la fondation du Dominion canadien en 1867, les électeurs seront appelés, le 19 octobre prochain, à renouveler la députation de la Chambre des Communes à Ottawa, exercice démocratique qui conduit, dans la tradition parlementaire britannique, à la formation d’un gouvernement.
La participation des souverainistes aux élections fédérales canadiennes
Or, il est un fait étrange, un comportement électoral jusqu’ici inexpliqué que l’on observe au Québec depuis la naissance d’un mouvement indépendantiste dans les années 1960. En effet, on pourrait penser que la lutte pour l’indépendance nationale du Québec aurait entraîné nombre d’électeurs québécois à s’abstenir de voter aux élections fédérales. Si des citoyens dans un État démocratique sont insatisfaits de lui au point de vouloir briser le lien de loyauté à son égard et fonder un autre État, c’est que ce premier souffre d’un défaut de représentation fondamental, d’une incapacité de servir ces citoyens que l’exercice routinier du droit de vote ne saurait combler. L’électeur indépendantiste serait donc en théorie enclin à penser que peu importe ce que l’État fédéral ou central lui offre pour se disputer ses faveurs, quoi que lui proposent les partis dans l’arène fédérale ou centrale, il ne peut y trouver son compte, car sa liberté politique doit s’exercer dans le cadre d’un autre État. Dans ce cas, voter aux élections fédérales ne présenterait aucun intérêt, aucun sens.
 Pourtant, ce que l’on observe est tout autre. L’irruption du Parti québécois dans le système de partis québécois en 1970, puis son élection en 1976, suivi de plusieurs autres, ainsi que de la tenue de deux référendums sur la souveraineté du Québec, ne semble pas avoir provoqué de défection des électeurs québécois aux élections fédérales. Au Québec, comme ailleurs au Canada, on observe certes une baisse tendancielle de la participation à ces élections, mais rien ne permet d’attribuer cette diminution à une quelconque abstention significative des électeurs souverainistes1. S’il fallait faire de la participation aux élections fédérales un indice de fidélité à l’État, on conclurait plutôt que Terre-Neuve supplante le Québec dans la défection lors de ces électionsalors qu’au Québec, le taux de participation aux élections fédérales tend à s’approcher de la moyenne canadienne.
Pourtant, ce que l’on observe est tout autre. L’irruption du Parti québécois dans le système de partis québécois en 1970, puis son élection en 1976, suivi de plusieurs autres, ainsi que de la tenue de deux référendums sur la souveraineté du Québec, ne semble pas avoir provoqué de défection des électeurs québécois aux élections fédérales. Au Québec, comme ailleurs au Canada, on observe certes une baisse tendancielle de la participation à ces élections, mais rien ne permet d’attribuer cette diminution à une quelconque abstention significative des électeurs souverainistes1. S’il fallait faire de la participation aux élections fédérales un indice de fidélité à l’État, on conclurait plutôt que Terre-Neuve supplante le Québec dans la défection lors de ces électionsalors qu’au Québec, le taux de participation aux élections fédérales tend à s’approcher de la moyenne canadienne.
À Terre-Neuve, ce taux est systématiquement plus faible que cette moyenne, et il arrive souvent que la participation électorale dans les États provinciaux de l’ouest (Alberta, Saskatchewan, Manitoba) soit plus faible qu’au Québec2. On ne peut sans doute pas exclure que des électeurs souverainistes refusent de voter aux élections fédérales par souci de cohérence avec leur option, mais aucune enquête, aucun indice ne permettent d’en faire le principal facteur explicatif de la baisse tendancielle du vote. Les appels au boycott dans les rangs souverainistes québécois sont rares et n’ont suscité jusqu’ici aucun mouvement organisé. Un des rares scrutins fédéraux où la participation québécoise est quelque peu en-dessous de la moyenne canadienne est celui du 25 octobre 1993, où la participation québécoise est de 64% contre 70% pour la moyenne canadienne. Ce scrutin est survenu un an après l’échec des accords de Charlottetown rejetés par les électeurs canadiens et québécois lors de deux référendums simultanés. Par contre, lors des élections fédérales qui suivent immédiatement l’élection du Parti québécois ou un référendum sur la souveraineté, on n’observe aucune baisse notable de la participation électorale des Québécois.
Depuis les élections fédérales d’octobre 1993, le mouvement souverainiste québécois s’est transporté sur la scène fédérale, avec la création du Bloc québécois, qui a réussi à remporter une majorité de sièges au Québec lors de six élections d’affilée, de 1993 à 2008. Ces succès l’ont propulsé à l’Opposition de 1993 à 1997 et lui ont permis d’exercer de quelque façon la balance du pouvoir lors des gouvernements minoritaires de Paul Martin (2004-2006) et de Stephen Harper (2006 et 2008). Cependant, ces succès ne semblent pas avoir reposé sur une ferveur électorale accrue des électeurs souverainistes; après les élections d’octobre 1993, à l’occasion desquelles le Bloc québécois a recueilli les suffrages de plus de 1846 000 électeurs, ses appuis aux élections subséquentes seront moindres et fluctuants, avant de tomber à moins de 900 000 voix aux élections de mai 2011, qui infligèrent au parti une débâcle sans précédent, réduit à un quartetto de députés. Aujourd’hui, avec seulement deux députés et le retour du chef défait en 2011, Gilles Duceppe, le parti joue son avenir aux prochaines élections.
Mais par-delà la discussion sur la possibilité d’une résurrection électorale du Bloc québécois, le fait demeure que la campagne électorale actuelle se déroule, comme toutes les précédentes depuis la naissance d’un mouvement indépendantiste au Québec, sur la supposition que l’électeur aux convictions indépendantistes est un « client » électoral comme un autre, dont les partis fédéraux, peu importe leur orientation canadianiste ou souverainiste, peuvent se disputer le suffrage à l’envi. Puisque la participation des électeurs indépendantistes aux élections fédérales est tenue pour normale et acquise, l’enjeu de cette participation se résume depuis 1993 à cette question : « Dois-je accorder mon suffrage à un parti voué à la défense de l’indépendance du Québec au sein des Communes canadiennes ou à un parti canadien dont les orientations, sur les thèmes autres que l’indépendance nationale, sont plus conformes à mes convictions? ». Ce dilemme révèle que l’indépendance nationale peut être entièrement dissociée des questions de politique ordinaire, sur lesquelles les électeurs se divisent selon des clivages classiques, opposant gauche et droite, libéraux et conservateurs, centres urbains et zones rurales, etc.
Quelques comparaisons avec les « bloquismes » irlandais, écossais et catalan
Quelques comparaisons avec d’autres expériences de partis indépendantistes jettent ici une lumière utile. Le Bloc québécois a pour ancêtre un prédécesseur très peu connu au Québec, dont les bloquistes savent eux-mêmes peu de choses ou dont ils n’osent traiter publiquement. C’est le bloquisme irlandais de la fin du XIXe siècle, qui fit connaître au parlementarisme britannique une des périodes les plus turbulentes de son histoire. À cette époque, l’Irlande, depuis 1800 annexée à la Grande-Bretagne pour former le Royaume-Uni et sans parlement propre, aboli par cette union, envoyait néanmoins une députation à Chambre des Communes britannique. Les Irlandais catholiques, sans droits politiques avant leur « émancipation » en 1829, portèrent à partir de 1885 leurs suffrages sur un parti irlandais qui rafla la grande majorité des circonscriptions irlandaises, au point d’enlever à plusieurs reprises aux grands partis britanniques la possibilité de former des gouvernements majoritaires. Ce parti irlandais n’avait de cesse de réclamer pour l’Irlande le Home Rule, soit l’autonomie politique doublée de la recréation du parlement dublinois.
Loin de se comporter en sages sujets de Sa Majesté, les députés du parti irlandais usèrent de l’obstruction systématique, comme le fameux « filibuster » dont Charles Stuart Parnell était passé maître, pour contrarier le gouvernement britannique et arracher des concessions. Mais à la longue, le parti irlandais sera dépassé par les événements. La Première Guerre mondiale et l’insurrection de Pâques 1916 à Dublin, durement réprimée par l’armée britannique, changèrent la donne; le Sinn Fein, partisan sans compromis de l’indépendance – quitte à conserver la couronne anglaise –, délogea le parti irlandais aux élections de décembre 1918 et conduisit l’Irlande au statut de Dominion en 1922, au prix d’une guerre de deux ans contre les troupes britanniques et de la partition du Nord de l’île.
Il est clair que l’action du Bloc québécois s’est inscrite dans un tout autre registre. Sous la direction de Gilles Duceppe, il ne n’est jamais agi de pratiquer l’obstructionnisme à la manière irlandaise, ni de refuser de concourir au bon fonctionnement du parlementarisme canadien, ni à la discussion des politiques fédérales, tâches auxquelles il a même excellé, aux dires de certains, mieux que les autres partis fédéraux. En somme, loin d’opter pour la défiance, la contestation de l’ordre établi, le refus de concourir ou de siéger, il s’est comporté en parti parfaitement légitimiste, ne se distinguant sur ce point aucunement des partis canadianistes traditionnels.
Par ailleurs, il existe en Occident d’autres partis dont l’ambition est de mener à l’indépendance une minorité nationale, le Scottish National Party (SNP) en Écosse, et des partis en Catalogne, la droite modérée de Convergence et Union, et la gauche républicaine (ERC). Malgré la défaite de l’option indépendantiste au référendum de septembre 2014, le SNP a obtenu aux dernières élections générales britanniques 50% des suffrages des électeurs écossais et 56 sièges sur les 59 réservés à l’Écosse au sein des Communes. Jamais dans son histoire le SNP n’a-t-il connu un aussi franc succès aux élections britanniques, qui dépasse même celui remporté par le Bloc québécois en 1993.
Cependant, les élections britanniques de mai 2015 ont donné au parti conservateur de David Cameron une majorité de sièges, ce qui enlève au SNP le pouvoir de blocage qu’il a espéré décrocher pour peser sur les choix du gouvernement. Par son orientation social-démocrate et progressiste, le SNP ressemble au Bloc québécois. On s’est d’ailleurs demandé si le SNP ne devra
pas renouer avec les tactiques de l’ancien parti irlandais s’il ne veut pas connaître ce qu’on appelle déjà le « syndrome québécois », c’est-à-dire ce piège mortel – « death spiral » en anglais – qui voit un parti indépendantiste se faire aimer et élire à répétition en raison de son programme social-démocrate à la tête d’une administration régionale et néanmoins, quand son option fondamentale est soumise aux électeurs, essuyer une cuisante défaite3.
En Catalogne, les partis indépendantistes font élire depuis le retour de la démocratie en Espagne en 1978 de petites députations aux Cortès madrilènes et ont exercé une certaine influence lors de certaines législatures où le parti espagnol dominant n’avait pas la pluralité des sièges. Mais c’est surtout dans le parlement de la communauté autonome de Catalogne et dans les conseils municipaux catalans que ces partis indépendantistes sont les plus présents. En réalité, les partis indépendantistes catalans et écossais ont en commun de vouloir occuper toutes les scènes démocratiques, du local jusqu’au parlement européen; ils évoluent dans des systèmes partisans intégrés où ce sont à peu près les mêmes partis qui luttent pour le pouvoir à toutes les échelles démocratiques.
À l’inverse, l’indépendantisme québécois s’est traduit sur le plan électoral par une pratique prononcée de la dissociation politique. Le Bloc québécois s’est constitué organiquement comme un parti distinct du Parti québécois, et le mouvement indépendantiste n’a jamais débordé dans l’arène municipale, qui obéit à un jeu partisan complètement étranger à la dynamique des élections québécoises4. Au vu de l’épuisement probable de la projection bloquiste dans l’arène fédérale et de l’incapacité structurelle des souverainistes à élargir leur base en pénétrant le monde municipal, le mouvement indépendantiste au Québec, bien loin de se consolider, se confine à un indépendantisme de surface, comme si la participation aux élections fédérales pouvait se marier parfaitement avec l’espérance qu’une victoire aux élections québécoises suffirait pour enclencher, malgré deux référendums négatifs, un nouveau processus d’accession à la souveraineté.
La première fonction du vote
Ce qui nous conduit à poser une question fondamentale : à quoi sert le vote? La réponse la plus commune est de nature subjectiviste; l’élection serait un mécanisme d’enregistrement des préférences des électeurs. C’est la vision que partagent les instituts de sondage, les médias, plusieurs chercheurs en études électorales. Or, si l’on regarde l’histoire de la représentation politique, il est clair que l’expression des préférences des électeurs n’est pas la première fonction du vote, ni non plus la formation du gouvernement. Sa première fonction est de légitimer le pouvoir dans l’État. Le gouvernement représentatif est né en Europe dans un contexte féodal, tout d’abord au nord de l’Espagne à la fin du XIIe, puis en Angleterre au début du XIIIe siècle. Dans tous les cas, un roi, souvent occupé à faire la guerre et sans ressources pour la financer, se vit contraint de convoquer les états du royaume, le clergé, l’aristocratie et les bourgeois des villes, pour obtenir d’eux le consentement à la levée d’impôts. C’est ainsi qu’est né le vote, sous la forme d’un échange entre le pouvoir, investi du droit de gouverner, et les sujets, dont l’obéissance est signifiée par le consentement. Au fur et à mesure que la démocratie remplacera l’hérédité comme principe premier de légitimité dans l’État, le vote, qui fut longtemps le privilège d’une petite minorité, sera élargi à des catégories nouvelles de la population, et deviendra le véhicule principal de légitimation de l’autorité constituée. En démocratie, comme l’écrit l’historien et humaniste Guglielmo Ferrero, « [l]e pouvoir ne devient légitime et n’est libéré de la peur que par le consentement, actif ou passif, mais sincère, de ceux qui doivent obéir5. » Le vote est la procédure conçue pour exprimer ce consentement et équilibrer la domination et l’obéissance, d’où naît l’obligation politique qui, selon Raymond Polin, « répond à la vocation propre de l’homme, à son essentiel désir de vivre en homme, c’est-à-dire d’être reconnu dans ses valeurs et justifié dans son existence, et les autres hommes avec lui6. »
Or, dans une démocratie qui garantit le droit d’opposition, porte au pouvoir de vraies majorités, libère le citoyen de la peur du pouvoir arbitraire et des révolutions violentes, la « vertu cardinale » qui rend la vie collective possible est selon Guglielmo Ferrero la loyauté du citoyen envers les autres et envers lui-même7. En somme, si l’on suit l’historien italien, le vote conférerait au pouvoir la légitimité nécessaire pour gouverner et serait un moyen par lequel les citoyens témoignent de leur loyauté à l’État, dont ils renouvellent la pérennité élection après élection. On comprend dès lors que les électeurs indépendantistes se retrouvent dans une position difficile; ils doivent choisir en quelque sorte entre le bris de loyauté à l’égard de l’État en place ou la légitimation de l’État dont ils aimeraient sortir. Ils se réclament d’un nouveau principe de légitimité, la souveraineté de la nation dont ils souhaitentl’indépendance, alors que ce principe n’est pas encore effectif. Seule demeure effective la légitimité de l’État en place, sur les procédures démocratiques duquel les forces indépendantistes comptent pour se donner une existence électorale, au risque toutefois de renforcer toujours plus l’État avec lequel il s’agit de rompre.
Le souverainisme québécois a clairement opté pour la légitimation de l’État canadien, et ce même si pendant plusieurs élections fédérales, une partie du vote indépendantiste s’est portée sur un parti souverainiste. Car même si un électeur indépendantiste croit agir conformément à ses convictions en donnant son suffrage à un tel parti, il n’empêche, que par sa participation au scrutin fédéral, il en reconnaît la pertinence, l’importance, la valeur, et donne à l’État fédéral canadien ce qui a de plus précieux : la légitimité. Cet électeur évolue dans un monde à double loyauté ; loyal à l’État canadien, il anime la démocratie canadienne de son vote, et fait par là même la démonstration que cette démocratie est à ce point évoluée, raffinée, généreuse, qu’elle peut même admettre en son sein un parti indépendantiste et lui octroyer la jouissance de tous les privilèges et les honneurs du parlementarisme à l’anglaise. Enfin, loyal à un projet, une aspiration, une visée suprême, il vote pour un parti indépendantiste aux élections québécoises, dans l’espoir qu’un jour, par suite d’un référendum décisif, une pluralité des suffrages se matérialise instantanément en l’avènement d’un État nouveau sur la planète.
En fait, les Québécois ont voté continûment pour l’État canadien ou ses antécédents coloniaux depuis 1792, sans être tentés ni par le boycott électoral, ni par l’obstructionnisme parlementaire – mise à part, bien sûr, la période des Patriotes, où le parti de Papineau guerroyait en chambre contre le gouverneur et le Conseil législatif. La montée d’un mouvement indépendantiste ne semble pas avoir ébranlé les vieilles habitudes de participation électorale des Québécois, dont l’ancienneté semble avoir instillé chez eux une loyauté citoyenne indéfectible, somme toute comparable à la moyenne canadienne.
L’indépendantisme québécois tient-il du bluff?
Il n’est pas étonnant que l’ambivalence de cette loyauté des Québécois ait fini par exaspérer nombre d’acteurs politiques au Canada anglais. À propos des méthodes des souverainistes, Pierre-Elliott Trudeau a déclaré : « Chaque nouvelle rançon payée pour écarter la menace de scission encourage les maîtres chanteurs à renouveler la menace et à doubler la rançon8. » Autrement dit, le désir d’indépendance nationale des souverainistes québécois ne serait que du bluff, destiné à extorquer du Canada toujours plus d’autonomie et d’avantages pour le Québec… au sein du Canada9. Ce genre d’interprétation est assez courant dans les grands quotidiens du Canada anglais. C’est aussi la thèse qui est défendue dans l’ouvrage de Brian Lee Crowley, Fearful Symmetry – The Fall and Rise of Canada’s Founding Values, publié en 2009, qui a connu un grand succès de librairie et auquel les médias ont fait écho. Selon l’auteur, sous l’influence – à son avis délétère – du nationalisme québécois que le Canada a dû sans cesse contenter pour éviter l’éclatement, le pays a pris une trajectoire social-démocrate qui consomma une rupture malheureuse avec les valeurs libérales, individualistes et impériales des pères fondateurs – et le Québec, plus encore que le reste du Canada, a sombré dans l’enflure collectiviste qui aurait détruit chez les Québécois le sens de la liberté individuelle et l’éthique du travail. D’une certaine manière, si l’on en croit l’auteur, le Québec serait la victime de son propre bluff. Devenu président de l’Institut Macdonald-Laurier, Crowley, qui estime que la Loi sur la clarté ne va pas assez loin pour réfréner les ardeurs des souverainistes, aime bien dépeindre ces derniers comme des tyranneaux « bullies » prompts à la menace10.
Selon l’historien René Castonguay, la première manifestation tangible d’une ambition indépendantiste dans l’histoire politique du Québec a pris la forme même du bluff. Il s’agit de la motion dite « Francoeur », que le député libéral de Lotbinière, Joseph Napoléon Francoeur, a présentée à l’Assemblée législative du Québec en janvier 1918 et qui envisageait que le Québec rompît le « pacte fédératif de 1867 » si les autres « provinces » devaient juger qu’il était devenu un obstacle au progrès de l’union canadienne. Le Québec était alors plongé dans les débats acrimonieux que l’effort de guerre avait suscités, et qui avaient dressé les partisans de la conscription, imposée en 1917, contre les anti-conscriptionistes, dont nombre de Québécois qui avaient encore en mémoire le règlement 17 de l’Ontario qui avait en 1912 quasiment éradiqué le français des écoles ontariennes.
Or, malgré l’émoi qu’elle provoqua, la motion fut à peine discutée en chambre. Il est clair selon Castonguay qu’« il faut voir la motion Francoeur comme un bluff politique de la part du gouvernement Gouin afin de faire tomber la pression qui étouffait alors le Canada. Le bluff vient du fait qu’il n’était aucunement question pour les libéraux d’aller jusqu’au bout de la motion, ni même de la faire voter, peu importe la réaction du Canada anglais11. » Après cette première velléité d’indépendance, plusieurs Premiers ministres québécois brandiront la menace de la sécession pour améliorer le statut du Québec au sein du Canada : Daniel Johnson, qui claironnera le slogan « Égalité ou indépendance », et même Robert Bourassa, après l’échec de l’accord du Lac Meech12.
Plus récemment, l’idée du bluff a fait irruption au Québec, mais sous la plume d’un auteur aux convictions indépendantistes adamantines, qui vient de publier chez Liber un pamphlet au titre évocateur : L’avenir du bluff québécois. Dans une prose incisive, qui mêle des références à Gaston Miron, au théoricien de la décolonisation Frantz Fanon et à Mao Tsé-Toung, Christian Saint-Germain écrit sans ambages : « Le discours nationaliste québécois carbure à la mystification, au bluff. Une classe politique issue de la Révolution tranquille ergote et vitupère depuis cinquante ans contre le fédéralisme canadien. Elle a su dévoyer l’impulsion nationaliste et la faire servir à chacun de ses intérêts ponctuels. L’exercice de cette domination de classe apparemment tourné vers l’émancipation du peuple n’a pas conduit à l’exaltation du patriotisme ni à une meilleure connaissance du Québec ou de la langue française […]13 »
Certaines des conclusions dirimantes tirées par Saint-Germain recoupent curieusement celles de Crowley sur le Québec : « Plus généralement, la montée d’une classe nationaliste s’inscrivait dans un projet de vacance global des idéaux individuels en implantant écoles avec décrocheurs en abondance et hôpitaux de salle d’attente. Corps sans esprit, ces institutions additionneraient des pauvres, mais surtout formateraient le Québécois moderne en bénéficiaire altermondialiste convaincu d’incarner la fine pointe des exigences éthiques de l’humanisme progressiste14. »
Quoi que l’on pense de la justesse des diagnostics posés par Crowley et Saint-Germain sur le Québec bluffeur, il convient d’ajouter que l’État canadien ne s’est pas contenté de satisfaire certaines réclamations nationalistes pour repousser la menace sécessionniste. Pour reprendre un joli terme qu’affectionne Stéphane Dion, il a pratiqué aussi « l’endiguement »15, ce qui inclut à vrai dire le recours à l’intimidation et à l’infiltration policières, à l’espionnage, aux mesures de guerre, à la propagande, aux manoeuvres électorales, au bâillonnement légal, au clientélisme auprès des groupes et des universitaires, à la guérilla judiciaire et au népotisme ciblé pour mettre les plus ambitieux au service du Dominion, ce qu’en anglais on nomme « patronage » et que le sociologue Stéphane Kelly a baptisé « la petite loterie » en retouchant une formule d’Adam Smith. Mais au bout du compte, le meilleur moyen d’attacher les Québécois au Canada demeure encore de leur donner envie de voter aux élections fédérales et d’éveiller à l’égard de l’État canadien le sens du devoir, une fascination constante et un désir pressant, afin de répondre aux appels de communion, d’engagement et de délibération dans une grande communauté bienveillante qui les persuade d’être indispensables à son existence.
Notes
1 Voir les résultats d’une enquête réalisée par Statistique Canada, « Raisons de l’abstention au vote », en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2012000/chap/sc/sc01-fra.htm .
2 Voir le tableau 2 de l’annexe « La participation électorale depuis la Confédération », Élections Canada, en ligne : http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=his&document=appx&lang=f .
3 Voir Neil Ascherson, « Scotland’s High Road to Home Rule », New York Times, 21 mai 2015. En ligne :
http://www.nytimes.com/2015/05/22/opinion/scotlands-high-road-to-home-rule.html?_r=0 .
4 Sur cette question, voir mon article « La mairie divine ou l’étrange dissociation du monde mu-nicipal québécois », Encyclopédie de l’Agora, 8 mars 2015, en ligne :
http://agora.qc.ca/documents/la_mairie_divine_ou_letrange_dissociation_du_monde_municipal_quebecois
5 Guglielmo Ferrero, Pouvoir. Les génies invisibles de la cité, Paris, Le livre de poche, 1992, p. 288.
6 Raymond Polin, L’obligation politique, Paris, Presses universitaires de France, 1971, p. 13.
7 Guglielmo Ferrero, Pouvoir. Les génies invisibles de la cité, déjà cité, p. 314-315.
8 Cité dans Stéphane Dion, « Le fédéralisme fortement asymétrique : improbable et indésirable », dans F. Leslie Seedle (dir.), À la recherche d’un nouveau contrat politique pour le Canada, Insti-tut de recherche en politiques publiques, Montréal, 1994, p. 133.
9 Voir aussi les « Notes pour le deuxième discours référendaire de M. Trudeau, le 2 mai 1980 », dans André Burelle, Pierre Eliott Trudeau, Montréal, Fides, 2005, p. 198.
10 Voir les déclarations de M. Crowley dans le site de l’Institut MacDonald-Laurier,en ligne : http://www.macdonaldlaurier#.ca/crowley-in-the-citizen-toward-greater-clarity-on-quebec/ .
11 René Castonguay, « Un bluff politique. 1917 : La motion Francoeur », Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec, no 53, 1998, p. 24.
12 Sur la tactique de la menace indépendantiste, voir Éric Bélanger, « “Égalité ou indépendance”. L’émergence de la menace de l’indépendance politique comme stratégie constitutionnelle du Québec », Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. 2, no1, 1999.
13 Christian Saint-Germain, L’avenir du bluff québécois, Montréal, Liber, 2015, p. 29.
14 Ibid., p. 35-36.
15 Stéphane Dion, « Belgique et Canada : une comparaison de leurs chances de survie », dans Serge Jaumain (dir.), La réforme de l’État… et après?, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 1997, p. 131-160.