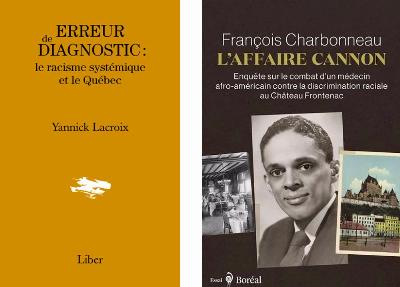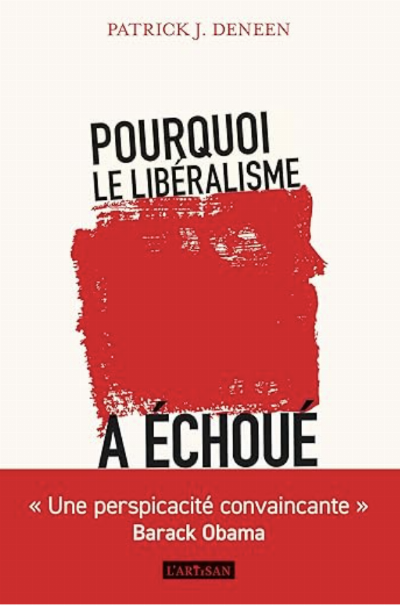La libéralité des Anciens et la pingrerie des Modernes
Cet article a d'abord paru en 1997 dans le magazine l'Agora, Vol 4, No 2.
La pédagogie moderne ayant banni des écoles le latin et les classiques romains, j’ai découvert, comme bien d’autres jeunes de ma génération, le monde fou des Romains, dans Astérix le Gaulois. Plus tard, j’ai troqué la bande dessinée pour les pavés savants, le hasard mettant sur ma route un livre étrange, Le pain et le cirque, de Paul Veyne, professeur d’histoire de Rome au Collège de France. Ce livre, paru en 1976, essaie de comprendre pourquoi le don à la collectivité, le mécénat envers la cité, occupait une si grande place dans la vie antique, à l’époque hellénistique, puis à l’époque romaine. Il est difficile de résumer ce livre touffu, encyclopédique, vertigineux, riche de 800 pages et de milliers de notes. Pour désigner ces dons particuliers que les notables des cités grecques, les sénateurs et les empereurs romains faisaient frénétiquement à la collectivité, Paul Veyne a inventé un mot, évergétisme, tiré du mot grec évergésie, qui désigne un bienfait en général. Ces donateurs munificents du monde antique étaient les évergètes, ceux qui par leurs dons faisaient du bien à la cité.
La libéralité des Anciens
L’évergétisme avait chez les Anciens une ampleur sans commune mesure avec ce que nous les Modernes connaissons de la générosité et de la philanthropie. Imaginons ce qu’il adviendrait de nos notables, sénateurs et empereurs à nous s’ils se mettaient à faire à qui mieux mieux des évergésies. On les verrait s’agiter soudain, s’inquiéter de leur honneur et de leur immortalité, répandant autour d’eux largesses et dons splendides.
Ainsi, M. Pierre Elliott Trudeau, en guise de célébration du quinzième anniversaire de sa constitution qui doit durer mille ans, ouvrirait les portes de sa superbe maison signée Ernest Cormier au peuple de Montréal, l’accueillant avec une dégustation de cham-pagne et de fraises–importées d’Espagne. M. Laurent Beaudoin vendrait la moitié de ses options d’achat sur les actions de Bombardier pour offrir aux enfants du Québec–ou du Canada–un tour d’avion gratuit en Challenger. Pour le mariage de ses enfants, on aurait vu M. Paul Desmarais offrir pendant 101 nuits des concerts gratuits dans les plus belles églises de Montréal, et faire cette grandiose pollicitation–une promesse de don–de financer une foule d’écoles de musique et de peinture à travers le Québec. Nos maires se cotiseraient pour faire ériger à leurs frais des monuments et des fontaines ou pour entretenir de somptueux jardins dans leur municipalité. Nos avocats, médecins et managers se précipiteraient pour se porter bénévoles aux charges de commissaires d’enquête, de directeurs d’hôpital, de juges administratifs ou d’inspecteurs d’impôt. Même nos vedettes sportives verseraient une partie de leur butin pour organiser et présider des jeux civiques, couronnés de concerts gratuits donnés par Roch Voisine et Céline Dion, et de banquets, où de grands crus, des bières sur lie et de divins fromages feraient le régal de tous. De généreux donateurs nous auraient légué leur fortune et leur nom pour nos barrages hydroélectriques et stations de métro. Et nos présidents d’entreprise, à chaque déclaration de dividendes, payeraient à leurs employés un bon verre–ou une bouteille–de Porto.
Oui, ce portrait fictif est délirant, mais celui que nous brosse Paul Veyne du monde antique ne l’est pas moins. Il y a une différence fondamentale entre les Anciens et nous: la munificence et la libéralité étaient chez eux des vertus civiques. Les archontes grecs et les oligarques romains se faisaient un honneur et une gloire de dépenser leur fortune pour la cité ou pour la république. Spontanément portés au mécénat, les riches rivalisaient de générosité. L’évergétisme confinait au patriotisme: on donne à la cité parce qu’on la veut belle, joyeuse et grande, ou parce que ses coffres sont vides ou que l’ennemi menace ses murs.
L’évergétisme naquit d’abord dans les cités grecques. Les notables finançaient la construction de temples, faisaient des offrandes aux dieux, lançaient à leurs frais des campagnes militaires, multipliaient les promesses de dons et créaient des fondations de bienfaisance.  Les magistrats acceptaient à titre gratuit leurs charges, entrant dans leur fonction par un don sans pareil. Chez les Romains, le mécénat était l’affaire des sénateurs et notables de province, qui enrichissaient la république de leurs largesses. Les jeunes ambitieux aspirant au Sénat se gagnaient la faveur du peuple en organisant des jeux, et honoraient ainsi la mémoire de leur père, souvent en dilapidant leur héritage. De là vinrent les jeux de gladiateurs. Avec la venue d’Auguste, le mécénat se confondit avec la générosité de l’Empereur, qui utilisait sa colossale fortune pour faire bâtir aqueducs, temples et thermes, et donner au peuple ses jeux et son pain.
Les magistrats acceptaient à titre gratuit leurs charges, entrant dans leur fonction par un don sans pareil. Chez les Romains, le mécénat était l’affaire des sénateurs et notables de province, qui enrichissaient la république de leurs largesses. Les jeunes ambitieux aspirant au Sénat se gagnaient la faveur du peuple en organisant des jeux, et honoraient ainsi la mémoire de leur père, souvent en dilapidant leur héritage. De là vinrent les jeux de gladiateurs. Avec la venue d’Auguste, le mécénat se confondit avec la générosité de l’Empereur, qui utilisait sa colossale fortune pour faire bâtir aqueducs, temples et thermes, et donner au peuple ses jeux et son pain.
Paul Veyne mobilise la philosophie, l’histoire, la sociologie et l’économie politique pour expliquer que ces cascades de dons unissaient par des obligations subtiles l’élite gouvernante, le peuple et la cité. Le peuple attendait des dons de ses gouvernants comme une chose naturelle. De là émergea chez les Romains le droit au bonheur; le peuple réclamait des jeux et des fêtes et les obtenait. En fait, ses oligarques et ses empereurs, ne se contentant pas de régner sur des sujets obéissants, voulaient être reconnus pour généreux et splendides.
Tous ces dons n’étaient pas que dissipation, ils remplissaient une fonction sociale utile, à une époque où la charité chrétienne et la sécurité sociale n’existaient pas vraiment. Les Grecs ne connaissaient ni l’État, ni le trésor public. Les Romains les inventèrent, mais la fortune publique consistait en assez peu de choses, les empereurs y ajoutant la leur, qu’ils avaient amassée avec leurs butins de guerre et les legs de leurs mercenaires. Mais dans un monde où il n’existait ni job ni profession interchangeable, ni droits du citoyen, la surenchère de don était avant tout pour les princes du monde antique la manière de prouver qu’ils étaient au service du peuple. Ainsi, chez les Anciens, le don gouvernait la politique: on donnait des récréations au peuple et glorifiait la cité, dans l’intérêt de l’autorité elle-même.
Image: Horace, Virgile et Varius à la villa de Mécène. F.J. Jalabert, peintre du XIX ème.
La pingrerie des Modernes
Nous les Modernes pouvons nous étonner de lire Aristote vantant les vertus de la magnanimité et de la libéralité dans son Éthique à Nicomaque ou Cicéron fustigeant la prodigalité de ses pairs dans Les devoirs. Nous comptons sur le marché et sur l’État pour produire et répartir la richesse. Se fier uniquement à la providence divine, aux aumônes et aux offrandes des riches ferait violence à l’idée que nous nous faisons de nous-mêmes et de notre capacité d’agir sur la société et d’y faire régner la justice. Or, comme l’a justement souligné Jacques T. Godbout dans son bel essai, L’esprit du don, le marché et l’État sont des systèmes anti-dons. Chacun s’appuie sur la règle: à chacun son dû.
Le marché, qui produit la plupart de nos biens de consommation, fonctionne sur le principe de l’échange marchand, réglé par l’intérêt mutuel entre étrangers. Dans un contrat, on ne se fait pas de cadeaux, on échange des biens ou des services de valeurs équivalentes, son travail contre un salaire, de l’argent contre un produit, le prix d’une action contre le droit de recevoir des dividendes.
L’État, lui, fait des lois, produit des services publics et répartit la richesse en suivant des règles préétablies, décidées collectivement. Ainsi, quand une mère reçoit son allocation familiale, un assisté social son chèque mensuel, un écolier son éducation, un malade ses soins de santé, ils reçoivent ce que la collectivité a voulu pour eux. La loi canalise la masse de nos impôts et détermine des bénéficiaires, ou ayants droit. Là, c’est à chacun son droit.
Autre différence d’avec les Anciens: nous séparons patrimoine privé et patrimoine public. La fortune de nos députés, ministres et fonctionnaires ne se confond pas avec le Trésor public. Ils reçoivent pour leur fonction un salaire, taxé au même titre que celui de tous les autres citoyens. Même dans le secteur privé, cette logique de séparation existe. Par l’artifice de la loi, la société commerciale, ou compagnie, possède sa propre personnalité morale et son patrimoine. Ses dirigeants et ses salariés ont un salaire et un patrimoine distincts.
La pseudo-générosité
Si puissants que soient aujourd’hui le marché et l’État, ils n’ont toutefois pas éliminé le don. Selon Godbout, la particularité des Modernes, c’est notre insistance à vouloir nier la présence du don dans nos vies, même s’il y est manifeste partout, et là où on le soupçonne le moins. Nous sommes persuadés que l’État a remplacé pour le mieux la bonne vieille charité chrétienne et les solidarités communautaires d’antan.
Or, le marché et l’État entretiennent des pratiques de pseudo-générosité, c’est-à-dire des distributions d’argent d’autrui présentées comme des dons à la collectivité. Dans les entreprises, la philanthropie corporative est devenue monnaie courante. De grandes entreprises jouent aux bons citoyens corporatifs, patronnent des festivals et des concerts, aident des oeuvres charitables, artistiques et savantes. C’est faire oeuvre sociale utile, mais est-ce là du don? Généralement, cette philanthropie est un investissement à long terme, un moyen de bâtir un capital de sympathie, du marketing civique. Ces dons viennent de l’entreprise, rarement de la fortune personnelle de ses dirigeants. Qui donne de ses profits, une organisation ou des personnes? Dans une économie capitaliste, les profits appartiennent à cette fiction qu’est la société par actions. Dans les faits, on semble se disputer la propriété des profits d’entreprise. Les présidents se payent volontiers des salaires magnifiques, rentabilité oblige. Les salariés, par leur syndicat, réclament leur part du gâteau. Les actionnaires, eux, veulent des dividendes, et s’ils s’appellent Templeton ou la Caisse de dépôt, ils savent exiger de meilleurs rendements, au prix de rationalisations multiples. Le don corporatif, à moins qu’il n’émane des personnes elles-mêmes, reste ainsi prisonnier du lacis des intérêts de tous et chacun.
Du côté de l’État, la pseudo-générosité prend une autre forme. L’État est un grand collecteur et répartiteur de richesse; les dirigeants que nous élisons établissent les règles de ce partage et administrent pour nous le trésor public. En principe, les distributions de l’État ne sont pas des dons: nous touchons notre part des ressources mises en commun pour la collectivité. Pourtant, la vie politique abonde en exemples de politiciens prétendument magnanimes promettant ça et là des emplois, distribuant des subventions et s’attribuant le mérite d’un grand ouvrage public, musée, école, route, etc. Parfois, magnificence et dépense publique s’unissent dans leur esprit, et ils font ériger aux frais des contribuables des mausolées à la gloire de leur règne. La nouvelle Bibliothèque de France, commandée et inaugurée à Paris par le président François Mitterand en est un, vaste temple du livre de deux milliards de dollars qui coûtera à la France environ 300 millions de dollars en frais annuels d’entretien. Ici, l’ex-maire Jean Drapeau, animé d’ambitions olympiennes, nous a légué une dette mémorable et un stade inachevé... Un chef d’État qui verse son salaire ou sa pension au trésor public a le geste large et noble. Si un politicien saupoudre avec fanfare le bien public, est-ce un vantard, un bouffon, un frimeur ou un tartufe?
La désaffection du citoyen pour la politique observée dans nombre de démocraties s’explique peut-être par la lassitude provoquée par les excès de la pseudo-générosité. L’une des grandes leçons que l’on peut tirer des peuplades primitives, nous dit Claude Lévi-Strauss dans Tristes tropiques, est que le lien qui unit le chef à la tribu ressemble à un échange symbolique, à un double don. D’un côté, la tribu accorde au chef sa confiance et un immense pouvoir. De l’autre, le chef donne de lui-même, par son charisme, ses talents guerriers ou ses vertus morales, se dépensant pour sa tribu. Dans nos sociétés modernes, nous attendons de nos chefs plus que des qualités de bons gestionnaires: ils doivent nous inspirer, être exemplaires, prodigues en promesses d’un avenir meilleur. La découverte qu’ils usent du bien public pour mousser leur carrière politique ou pour s’enrichir - par le cumul d’emplois et de privilèges par exemple - brise cet échange symbolique. Le scepticisme et le cynisme gagnent alors les citoyens, floués par des mercenaires de la politique.
Le libéralisme sans la libéralité: l’ère de la richesse cloîtrée
Le marché et l’État sont des systèmes anti-dons, ils nous dispensent d’être généreux, la générosité étant la vertu du don. Un citoyen qui travaille et paie ses impôts pourra se faire cette réflexion: pourquoi donnerais-je, puisque j’ai fait ma part? Ce citoyen compte sur la redistribution, qui est un outil puissant et utile; cependant, cet outil est mécanique et anonyme. Des lois et des bureaucraties ne scellent pas de solidarités concrètes mais le don, lui, qui se fait de personne à personne, peut le faire.
Certes, la générosité existe. Au Québec, une multitude d’organismes recueillent les dons charitables (au Canada, les Québécois demeurent pourtant les moins généreux). Des philanthropes comme les Bombardier, Bronfman, Desmarais, Péladeau et Stewart ont inauguré un mécénat naissant, encore timide. Par contre, notre nouvelle élite économique, championne du libéralisme économique, nous offre parfois le spectacle de parvenus tout occupés à jouir de leur richesse fraîchement acquise. Avoir de l’argent signifie s’acheter un condominium en Floride, se baigner aux Bahamas ou skier à Val d’Isère, rouler en Mercedes ou écouter La Traviata ou Madonna sur écran géant télécommandé. C’est le repli individualiste dans la jouissance tranquille et pantouflarde de ses dividendes. Faut-il s’inquiéter de voir tant de nos managers, professionnels et retraités se cloîtrer dans leur richesse? Comme l’a dit saint Thomas d’Aquin, le péché de la petitesse d’esprit est de ne pas actualiser sa puissance. La petitesse des Modernes, c’est d’avoir de grands moyens et de se complaire dans de petites satisfactions.
Aux États-unis, le sociologue Christopher Lasch a écrit avant sa mort, en 1995, un dernier livre où il exprime toute l’inquiétude que lui inspirait l’ascension dans son pays d’une nouvelle élite, indifférente aux qualités civiques qui avaient marqué la société américaine jusqu’au début de ce siècle. Dans son ouvrage au titre des plus révélateur, The Revolt of the Elites, Lasch soutient que c’est l’existence même de la démocratie américaine qui est ainsi menacée par la perte de ces qualités civiques. Cette nouvelle élite, habile au maniement des symboles mathématiques, informatiques et langagiers, est persuadée qu’elle ne doit rien à personne, ses succès étant dûs à son haut degré d’instruction. Cette élite méritocratique, mobile, bardée de diplômes, citoyenne du monde, friande d’exotisme et de cosmopolitisme, a peu de sympathie pour la classe moyenne, trop inculte et mal dégrossie pour elle. Plutôt que de se sentir un devoir de solidarité envers la communauté et la nation, elle recherche la compagnie de ses pairs, se réfugie dans des banlieues aseptisées et compte ses sous.
Or, nous dit Lasch, au début de la démocratie américaine, des obligations civiques étaient rattachées à la richesse. Les riches familles, établies depuis plusieurs générations dans leur communauté, se reconnaissaient le devoir de libéralité envers elle, la gratifiant d’hôpitaux, d’écoles, de bibliothèques, de monuments et de parcs. Avec la mobilité des capitaux et de la main-d’oeuvre et l’ascension de cette nouvelle élite, cet esprit de libéralité s’est effrité. Cette élite se persuade que le grand rêve américain réside maintenant dans la mobilité sociale de tous. Or, nous dit Lasch, tel n’a pas été ce rêve. C’est travestir le sens du génie démocratique américain, dont le grand rêve tient à l’égalité civique: qu’on soit ouvrier, fermier ou banquier, tous sont des citoyens responsables, égaux en dignité et dans leur droit de participer à la vie publique. Cette égalité civique est possible quand la classe moyenne possède quelques biens et exerce des métiers lui donnant indépendance d’esprit et d’argent. Quand la classe moyenne s’affaiblit, comme c’est le cas aux États-Unis depuis plusieurs années, l’égalité civique se perd et les inégalités sociales deviennent d’autant moins tolérables.
Le milliardaire Ted Turner, fondateur de CNN, a exprimé dernièrement des inquiétudes semblables à celles de Christopher Lasch. Lui aussi constate que la grande philanthropie américaine se meurt, les nouveaux superriches étant obsédés par l’accumulation de plus grandes richesses. Selon lui, si les gens fortunés aux États-Unis continuent de concentrer la richesse sans être plus généreux, licenciant sans vergogne des milliers d’employés et réclamant l’allégement de l’impôt, le spectre d’une révolution à la 1789 se profilera vite à l’horizon. Turner explique l’avarice des ploutocrates américains par leur obsession de figurer dans la liste des 400 Américains les plus riches fabriquée par la revue Forbes. Pour contrer les effets néfastes de cette liste fétiche, Turner propose qu’on instaure une liste annuelle des philanthropes les plus généreux et qu’on décerne un prix d’avarice (excellente idée, au Québec, ce serait le prix Séraphin). Turner, lui, a découvert les joies du don, ayant allongé 200 millions de dollars de sa fortune aux bonnes oeuvres.
Ce que nous disent Lasch et Turner, c’est que promouvoir le libéralisme économique sans l’assortir d’une éthique de la libéralité mène tout droit au cul-de-sac. Au Québec, de jeunes leaders économiques viennent de comprendre ce lien nécessaire entre libéralisme et libéralité. Pensons à Denis Langlois, président de Softimage qui, se réclamant de la grande tradition des mécènes, a récemment créé une fondation privée pour le soutien du cinéma d’auteur.
Dans leurs savantes analyses, les promoteurs du libéralisme économique se plaisent souvent à décrire le marché comme un système omniscient et capable de tout, se régulant par l’interaction de valeurs abstraites, masse monétaire, taux d’intérêt, fluidité des capitaux, taux d’épargne, etc. Ils confondent aussi souvent le marché avec la société civile–la société en dehors de l’État et des grandes corporations–, voyant ses membres comme des acteurs rationnels cherchant sans cesse à optimiser leurs intérêts. Ils oublient que ce qui rend possible cette société civile sur laquelle s’appuie le marché, c’est un ensemble de qualités humaines, comme la politesse, la confiance, le civisme, la solidarité, le sens de la parole donnée, l’ouverture d’esprit et même l’entrepreneurship. Or, et c’est ce qui découle des idées de Jacques T. Godbout, ces qualités naissent dans une culture du don, et non point du fait de l’intérêt marchand.
Des ultra-libéraux comme Friedrich Hayek avaient une grande confiance dans la capacité du marché de se tempérer. Son oeuvre est parcourue de la conviction que l’une des forces du marché est qu’il laisse aux riches toute liberté de soutenir les arts et les sciences et d’expérimenter de nouveaux modes de vie. Mais si les riches ignorent le mécénat, s’enferment dans leur richesse et s’éloignent des classes moyennes et démunies, sacrifiant l’égalité civique à leur fortune, quel est ce marché proclamé société de libertés? Un royaume pour happy few.
La société civile, lieu du don
Au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, les économistes et les intellectuels se disaient que le marché avait ses défaillances et ne pouvaient donc tout faire. Ils ont créé l’État-providence, qui stimule l’économie, produit des services et répartit la richesse au nom de la justice sociale. Aujourd’hui, on admet que l’État-providence a lui aussi ses faiblesses et qu’en bien des domaines, le marché est plus efficace que lui. Cependant, le marché et l’État ont l’un et l’autre leurs limites et ne peuvent nous garantir de vivre dans un monde humain, joyeux et fraternel. Il faudra bien que les économistes, gens d’affaires et intellectuels, réservent une plus grande place dans leurs pensées au don et à sa vertu, la générosité. Hélas, nombre d’économistes demeurent obnubilés par leurs statistiques et leurs équations, et plusieurs intellectuels, notamment ceux de la gauche caviar, ne jurent encore que par l’État. Il est peut-être temps de songer à quelles conditions la société civile peut s’épanouir et se muscler, car avec un marché triomphant et un État plus modeste, elle sera de plus en plus sollicitée.
Les Anciens ne connaissaient ni le bien-être social, ni l’impôt sur revenu, ni les cartes de crédit, ni les droits de l’Homme. Mais ils donnaient sans mesure, avec un sens de la fête et de la réjouissance publique que nous pouvons leur envier. Nous les Modernes, nous sommes pingres, et c’est là le paradoxe de notre époque, par efficacité et par justice. Nous avons le don triste et terne, presque honteux, rarement splendide. S’il fallait écrire l’équivalent de Le pain et le cirque pour notre époque, cet ouvrage s’intitulerait: Le vidéo et la bourse.