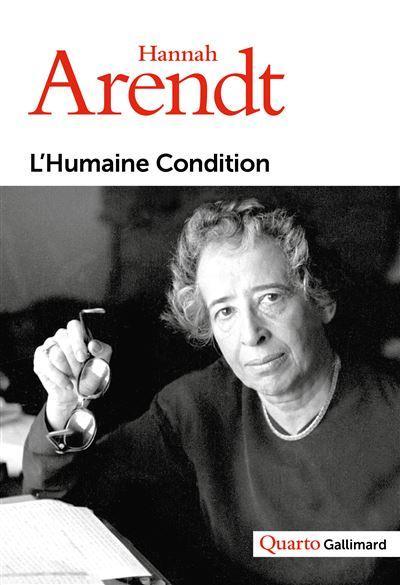Jacques Dufresne et le projet encyclopédiste
Entretien paru dans la revue Combats,Volume 9 • Numéros 3 et 4 • Automne-Hiver 2006-2007
 Le philosophe Jacques Dufresne rêve, depuis des décennies, d’une encyclopédie nationale. Mais d’autres activités l’ont tenu loin du projet pendant un certain temps. Après des études à l’Université de Dijon au cours desquelles il fera une thèse de doctorat sur l’œuvre de la philosophe Simone Weil, il fera partie de la première génération des bâtisseurs du réseau collégial. Homme d’action, animateur, brillant orateur, il organise, dès les années 1970, divers colloques internationaux autour de la revue Critère, activité qu’il renouvellera dans les années 1980 lorsqu’il lancera une PME L’Agora Recherches et Communications inc. Collaborateur au Devoir et à La Presse dans les années 1980-1990, il participe encore régulièrement à des émissions de radio ou de télé. Souvent associé à la droite en raison de sa défense de l’école privée, il réplique en proposant d’abolir les commissions scolaires et d’étendre le modèle institutionnel des cégeps à l’ensemble des écoles. De fait, Jacques Dufresne est l’un des ardents défenseurs de l’ordre collégial, car ce réseau incarne «le nouvel humanisme proposé par le Rapport Parent», comme il l’écrit dans la première version de son Panorama de la vie intellectuelle dans les collèges du Québec. Et il ajoute aussitôt : «N’eût été de la contribution des cégeps, la vie intellectuelle au Québec aurait été bien pauvre, tragiquement pauvre, au cours des trente-cinq dernières années» (www.agora.qc.ca). Personne n’a osé le contredire. Aujourd’hui, avec sa compagne de toujours, Hélène Laberge, il se consacre à sa réalisation : L’Encyclopédie de l’Agora, sur le Web. Et le magazine L’Agora, lancé en 1993, est toujours publié mais il a pris la forme d’un fascicule encyclopédique, traitant de divers thèmes actuels : l’éducation, l’inaptitude, etc.
Le philosophe Jacques Dufresne rêve, depuis des décennies, d’une encyclopédie nationale. Mais d’autres activités l’ont tenu loin du projet pendant un certain temps. Après des études à l’Université de Dijon au cours desquelles il fera une thèse de doctorat sur l’œuvre de la philosophe Simone Weil, il fera partie de la première génération des bâtisseurs du réseau collégial. Homme d’action, animateur, brillant orateur, il organise, dès les années 1970, divers colloques internationaux autour de la revue Critère, activité qu’il renouvellera dans les années 1980 lorsqu’il lancera une PME L’Agora Recherches et Communications inc. Collaborateur au Devoir et à La Presse dans les années 1980-1990, il participe encore régulièrement à des émissions de radio ou de télé. Souvent associé à la droite en raison de sa défense de l’école privée, il réplique en proposant d’abolir les commissions scolaires et d’étendre le modèle institutionnel des cégeps à l’ensemble des écoles. De fait, Jacques Dufresne est l’un des ardents défenseurs de l’ordre collégial, car ce réseau incarne «le nouvel humanisme proposé par le Rapport Parent», comme il l’écrit dans la première version de son Panorama de la vie intellectuelle dans les collèges du Québec. Et il ajoute aussitôt : «N’eût été de la contribution des cégeps, la vie intellectuelle au Québec aurait été bien pauvre, tragiquement pauvre, au cours des trente-cinq dernières années» (www.agora.qc.ca). Personne n’a osé le contredire. Aujourd’hui, avec sa compagne de toujours, Hélène Laberge, il se consacre à sa réalisation : L’Encyclopédie de l’Agora, sur le Web. Et le magazine L’Agora, lancé en 1993, est toujours publié mais il a pris la forme d’un fascicule encyclopédique, traitant de divers thèmes actuels : l’éducation, l’inaptitude, etc.
Dans une campagne des Cantons de l’Est, les Dufresne cultivent leur jardin et la signification des mots avec la même ferveur. L’esprit de Montaigne et celui de Diderot dessinent leur horizon…
André Baril
- Quel souvenir gardez-vous de vos études au séminaire de Joliette?
Je garde un souvenir extrêmement reconnaissant envers l’institution. Le professeur de philosophie qui m’a tant marqué s’appelait Yvon Desrosiers. Dans tout le petit réseau social de la région, tout le monde savait que Yvon Desrosiers était le plus brillant de sa génération et que le diocèse de Joliette l’avait envoyé étudier dans les meilleures universités européennes. J’aime à le souligner, car on ne verra plus cela par la suite. Nous savions et nous sentions tous que c’était un privilège : le plus brillant de tout ce que le terroir avait produit nous revenait comme professeur. Ce fut une grande force de l’Église. Quand l’État a pris le contrôle de l’éducation, il n’a pas aussi bien réussi cette opération. D’où mon attachement à cette institution et ma gratitude à l’égard de tous les professeurs que j’ai eus. D’où aussi le fait que, dès ma jeunesse, mes choix philosophiques et politiques ont été différents de ceux de bien des intellectuels de ma génération.
- Par exemple?
Parmi les choses dont je souffre le plus en tant que Québécois, il y a l’importance que ma génération a donnée au Refus Global de Borduas. Je n’aurais pas mis la note de passage à un étudiant qui m’aurait présenté le marxisme d’une façon aussi infantile. L’Église, je le reconnaissais, s’était laissée aller à des excès dans son emprise sur les consciences qui rendaient inévitable une certaine rupture avec le passé, mais de là à faire un demi-dieu de Borduas… Il y a eu des années, entre 1960 et 1970, pendant mes études en Europe et surtout au retour, durant lesquelles j’avais peine à m’identifier au Québec du changement inspiré par Borduas ... Je préférais le Québec de Jacques Lavigne.
Difficile retour d’Europe?
Non, je me méfiais plutôt de certains intellectuels que le Québec envoyait en Europe et qui revenaient «snober» ceux qui avaient payé leurs études. Je m’étais juré que je ne me réfugierais pas à Ottawa comme beaucoup de ces «retour d’Europe» l’ont fait. Je m’étais juré que je servirais le Québec - ce fut une constante dans ma carrière - , que je m’accomplirais en tant que penseur avec les Québécois et que jamais je n’appartiendrais à la catégorie de ceux qui accusent leur pays de les avoir empêchés de s’accomplir. J’estimais avoir été choyé au-delà de ce que j’étais en droit d’espérer. Le fardeau de la preuve était de mon côté, non du côté des contribuables, mes compatriotes qui m’avaient aidé à poursuivre mes études jusqu’au doctorat.
Encore une fois, peut-être ai-je vécu dans un milieu protégé, je n’avais pas senti sur moi cette contrainte épouvantable que tant d’intellectuels semblaient avoir subie au Québec. J’étais bien conscient des excès du triomphalisme de l’Église de l’époque, mais cette Église ne m’avait pas meurtri. Elle m’avait fait! D’ailleurs, j’arrive mal à comprendre une certaine agressivité contre l’Église québécoise, car comment pouvez-vous vous aimer vous-même si vous n’avez pas l’ombre d’une sympathie pour l’Église qui vous a fait? Est-ce que le résultat est si horrible? Voulez-vous me dire quels sont les jeunes Occidentaux qui, venant d’un milieu modeste, ont pu faire des études classiques comme celles que j’ai faites? Je les dois à l’Église. C’est la raison pour laquelle, à tous égards, je me situe aux antipodes de Borduas.
- Parlons un peu de vos influences intellectuelles, de votre formation philosophique.
J’ai eu le bonheur à 19 ans, en 1960, de rencontrer, sur une base personnelle et amicale, un philosophe français, Gustave Thibon. Je m’intéressais à Simone Weil. Or, Thibon l’avait fait connaître après sa mort, survenue pendant la guerre, en 1943, au reste du monde en publiant La pesanteur et la grâce. Cependant, Thibon n’était pas un universitaire mais un autodidacte. Il m’a mis en contact avec madame Jeanne Parain-Vial qui allait devenir ma directrice de thèse. À son tour, elle m’a fait rencontrer ma famille d’esprit, des penseurs comme Gabriel Marcel, par exemple. Mais ici, au Québec, j’étais marginal. Plusieurs avaient la tentation du marxisme. Mes réserves sur le marxisme étaient presque congénitales. Tous les auteurs que j’étudiais en étaient loin. J’étais et je suis encore un passionné de Max Scheler. Un des livres qui m’a le plus marqué est L’homme du ressentiment. L’étude du ressentiment s’est avérée cruciale pour moi. J’étais spontanément porté vers ce type de psychologie. J’étais aussi profondément critique à l’égard de l’idée de progrès, de toutes les formes de messianisme et de millénarisme. J’ai étudié dans cet esprit le philosophe allemand Ludwig Klages, dont nous reparlerons plus loin si vous le voulez bien.
- Vous étiez donc proche du personnalisme et de l’existentialisme chrétien. Ici au Québec, il y avait quand même Jacques Lavigne.
Je n’oublierai jamais le jour où Yvon Desrosiers, notre professeur de philosophie, est entré en classe avec, dans les mains, L’inquiétude humaine, l’un des premiers ouvrages d’un auteur québécois publié par un grand éditeur français, la maison Aubier, qui comptait Max Scheler et Gabriel Marcel parmi ses auteurs. C’est à ce livre peut-être que je dois d’avoir été immunisé très jeune contre le mythe de progrès. Notre professeur avait de telles affinités avec Jacques Lavigne qu’il est difficile pour moi, rétrospectivement, de distinguer ce qui nous a été donné par l’un ou par l’autre. Conscient de l’emprise démesurée que la morale chrétienne avait sur plusieurs d’entre nous, Yvon Desrosiers nous mettait en garde contre un sentiment de culpabilité qui portait moins sur les actes que sur les intentions et les tentations, empoisonnant ainsi la vie intérieure à sa source. S’il nous parlait si souvent et si éloquemment de l’inquiétude, c’est sans doute qu’il espérait nous aider à substituer en nous-mêmes une inquiétude ouvrant les chemins de la liberté à une culpabilité aliénante.
Peut-être est-ce aussi cette acceptation de l’inquiétude, synonyme de vide pour Lavigne, qui m’a préparé à comprendre Simone Weil, laquelle aurait pu écrire ces lignes qui sont pourtant de Jacques Lavigne : «Il n’y aura de sens que si nous sommes au faîte du temps, non pour y tomber, mais pour y incarner de l’éternel, pour y faire germer et grandir une vie spirituelle, pour y rencontrer l’Infini et nous y donner. C’est à ce don que nous prépare l’inquiétude.»
- Après vos études, vous vous retrouvez, à la fin des années 1960, dans un cégep, en pleine création du réseau collégial!
-
En quelques années, on avait détruit un système d’éducation auquel j’étais profondément attaché pour le remplacer par l’idéal proposé pour les nouveaux instituts dans le Rapport Parent. Cet idéal, plus inspirant à bien des égards que l’humanisme que nous quittions, où les lettres avaient trop d’importance. c’était la troisième culture qu’avait préconisée C.P. Snow, que l’on citait d’ailleurs dans le rapport : la synthèse de la culture littéraire et de la culture scientifique et technique. À 27 ans, je suis devenu directeur du secteur arts et lettres du cégep Ahuntsic.
- Puis, vous allez créer la revue Critère, qui eut beaucoup de retentissement à cette époque. Comment expliquez-vous ce succès ?
Nous sommes en 1970. Des professeurs sont venus vers moi; ils voulaient fonder une revue. C’était mes ennemis sur le plan intellectuel… et administratif (la revue devait, selon eux, être dirigié par un collectif ), mais ma conception de la liberté était telle que j’étais prêt à les aider. Au bout de 9 mois, ils sont venus me dire qu’ils ne feraient pas la revue. Or les fonds étaient débloqués, j’ai donc décidé de reprendre le projet. Dès les premières années, la revue Critère a organisé des colloques internationaux de premier ordre entre autres, celui intitulé Pour un nouveau contrat médical, qui a été marquant pour l’avenir du système de santé. La réussite dont je suis le plus fier est un numéro sur l’Environnement suite à un colloque international organisé avec les professeurs de chimie. On avait réuni des textes scientifiques sur les diverses pollutions et des textes des philosophes d’ici et d’ailleurs, qui venaient donner du sens à tout cela. Ce numéro a reçu tous les éloges de René Lévesque, alors journaliste.
Il faut dire que j’étais bien entouré. J’avais comme président du Conseil d’administration Yves Martin, qui était sous-ministre de l’éducation, homme influent au Québec et ami de Fernand Dumont. Nous avons organisé au moins huit grands colloques internationaux. Nous vendions jusqu'à 4 000 exemplaires de la revue Critère. L’un de nos conférenciers, le grand biologiste américain René Dubos, m’a dit après avoir pris connaissance de Critère : « Savez-vous qu’aux États-Unis une chose pareille n’est possible que dans quelques grandes universités ? » C’était pourtant possible dans les cégeps québécois… Entre parenthèses, il s’était demandé si la qualité de notre éducation serait maintenue après la disparition du cours classique…
- C’est à la revue qu’est né votre projet d’encyclopédie…
Oui, c’est là qu’a pris forme dans mon esprit l’idée d’un projet encyclopédique. À mes yeux, un pays qui prenait conscience de lui-même devait se donner une vision du monde et se donner à voir au monde. D’où le fait que, dès 1979, j’ai réuni des gens, des recteurs d’université et je leur ai rappelé que lorsqu’elle est devenue indépendante en 1867, la Hongrie s’est tout de suite dotée d’une encyclopédie.
- Mais vous avez pris, au cours des années 1980, une autre direction en collaborant, avec Fernand Dumont, à l’Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC).
Dumont qui me connaissait grâce à Yves Martin m’a confié la responsabilité du premier grand traité qu’il avait à l’esprit, un Traité d’anthropologie médicale. En me donnant cette responsabilité, il indisposait les grandeurs établies dans ce domaine là. J’ai compris après coup qu’il le faisait volontairement. On l’a cru pur intellectuel, c’était aussi un habile administrateur…
En 1985, le besoin de liberté était si fort que je suis revenu à ma vieille idée. Ma femme Hélène et moi avons alors proposé une série encyclopédique qui s’appellerait «Les routes du savoir» et dans laquelle on répondrait à la question suivante : ce qu’il faut absolument savoir à 18 ans; le savoir essentiel. Ce projet a rapidement obtenu l’appui financier du Centre éducatif et culturel (CEC). Et après quelques mois de travail intense (ma femme et moi avions déjà terminé six routes du savoir), ce projet a été abandonné.. Nous étions alors en 1988, au début de la révolution culturelle d’Internet… Or, une encyclopédie sur papier se rentabilise sur 25 ans. Mais nous avions avancé dans notre vision.
Toujours dans les années 1980, nous avons de nouveau organisé des colloques mais sur une base privée et avec le soutien de divers organismes professionnels. Ce fut l’époque des premiers colloques au Québec sur les médecines dites douces : nous avons contribué à la reconnaissance de certaines de ces thérapies, depuis l’acupuncture jusqu’à l’homéopathie. Avec l’Ordre des infirmières, nous avons organisé un colloque sur le thème de la mort; avec la Chambre des notaires, sur la judiciarisation de la société (dont on constate les méfaits dans notre société à l’heure actuelle). Et en 2003, un dernier colloque sur la Philia, cette amitié qui est le fondement de la société.
- À quel moment avez-vous fondé la revue L’Agora?
En 1990, j’écrivais dans La Presse. Mais en 1992, suite à ma prise de position sur les accords de Charlottetown, on a sans la moindre élégance mis fin à ma collaboration.. Alors, ma femme et moi avons décidé de lancer une revue, L’Agora, et une amie française nous a offert son soutien financier. Nous avons publié, dans nos premiers numéros, le programme du groupe Réflexion Québec, avec Jean Allaire, Claude Béland, Alain Gagnon, un groupe qui s’était formé avant la naissance de l’Action démocratique. Je continue de penser que c’est le meilleur programme jamais fait au Québec.
- Puis L’Agora est devenu un portail, une encyclopédie sur Internet. Comment en êtes-vous arrivé à ce nouveau projet?
À la même époque, un haut fonctionnaire m’appelle pour me proposer une recherche sur le sens à donner à Internet, sur l’usage qu’on devrait en faire et m’annoncer que l’État avait créé des subventions ad hoc. Nous avons présenté un projet et obtenu une subvention. Notre recherche nous a permis de voir, dès 1996, la nécessité de faire un grand site. Au Québec, nous n’avons pas les moyens d’en faire cinquante! J’ai réuni des décideurs et je leur ai dit : « Nous recommandons dans notre rapport de faire un grand portail national québécois et de mettre toutes nos ressources intellectuelles à contribution pour occuper le terrain. Pouvez-vous nous aider?»
- On vous a écouté?
Il y avait deux obstacles majeurs. D’une part, les universités subissaient des coupures mais surtout comment allaient-elles s’entendre sur des valeurs à défendre? J’ai senti que cela ne se ferait jamais. Nous avons décidé Hélène et moi de lancer le projet d’une encyclopédie sur Internet en faisant appel à l’aide des lecteurs de L’Agora. Une mécène (qui désirait conserver l’anonymat) s’est présentée; c’est à sa générosité que nous devons une grande partie de la mise en œuvre de l’encyclopédie.
Mais pourquoi une encyclopédie?
J’avais 15 ans, je lisais l’Encyclopédie de la jeunesse. Cette Encyclopédie a été lue par une famille sur deux dans les années 1950, alors que c’était le produit d’une compagnie américaine, gérée à Toronto, qui allait chercher un vieux fonds littéraire français de la fin du XIXe siècle ou du début XXe, sur lequel on saupoudrait des textes québécois, dont les auteurs, tel Marie-Victorin, étaient nos meilleurs chercheurs du moment. C’est d’ailleurs ce qui faisait la valeur de l’œuvre. Plus tard, j’ai compris que cette encyclopédie était un symbole parfait de notre état de colonisé. Le désir de faire une encyclopédie reflétant notre identité et nos racines intellectuelles m’est venu très tôt.
Mais quelles sont les caractéristiques de ce projet encyclopédique
-
Il nous arrive de le présenter comme la première et la seule encyclopédie orientée vers le développement durable, ou plutôt vers un rapport plus harmonieux de l’homme avec lui-même et avec la nature, car, je ne vous l’apprendrai pas, la notion de développement est ambiguë et celle de développement durable l’est encore davantage. Mais le mot est sur toutes les lèvres et le philosophe doit savoir parler la langue de sa tribu.
Nous pensons que pour rendre ce développement durable possible, il faut réhabiliter cette notion de limite qui, pour les Grecs, était la condition de la beauté et même de l’existence. Nous pensons aussi, dans le même esprit, qu’il faut repenser le sport, le détourner du culte du record et du mépris du corps pour en faire l’occasion d’une symbiose avec la nature. Ce n’est pas pour le plaisir d’utiliser un mot à la mode que nous avons consacré un numéro de notre magazine/fascicule et plusieurs dossiers de notre encyclopédie à la notion de « sport durable ». Notre corps est à la fois signe et instrument, lyre et levier. Dans le sport professionnel et dans le sport olympique, mais aussi dans le conditionnement physique pratiqué en milieu clos sous surveillance médicale, le corps est réduit à son rôle d’instrument et souvent méprisé au point qu’on n’hésite pas à l’empoisonner pour accroître sa performance. On le traite comme on traite l’humus du sol dans l’agriculture, sous le signe, dans l’un et l’autre cas d’une démesure, d’une ubris, qui est la cause fondamentale de tous nos excès dans l’exploitation et la consommation des ressources non renouvelables.
L’analogie entre le sport et l’agriculture, entre le corps et l’humus, il faudra, la chose est possible, l’étendre à l’ensemble des activités humaines. C’est la puissance abusive de nos analyses et l’insuffisance de nos synthèses qui est, sur le plan intellectuel, la cause de cette démesure avilissante dans nos rapports avec le monde et avec nous-mêmes.
D’où le fait que L’Encyclopédie de L’Agora repose sur une recherche d’unité entre les diverses disciplines, alors que l’encyclopédie Wikipédia, par exemple, est plutôt une juxtaposition de points de vue. Certes, l’une de nos faiblesses par rapport à Wikipédia, c’est que nous n’avons pas réussi à regrouper un si grand nombre de collaborateurs. Il fallait d’abord construire une unité. J’ai grandi à l’époque où l’on devait se révolter contre des systèmes trop structurés. Mais ce n’est pas le danger qui menace actuellement la pensée. Le danger qui la menace, c’est l’incohérence totale, c’est l’extrême variété des opinions.
- On pourrait aussi vous demander ce qui vous différencie du projet de Diderot au XVIIIe siècle…
Nous sommes critiques à l’égard du progrès. Par exemple, nous avons lancé l’idée d’une science réparatrice par opposition à la science conquérante des siècles précédents Qu’est-ce que nous entendons par science réparatrice? C’est une science qui suppose que l’on contemple davantage la nature, qu’on se familiarise avec sa complexité dans l’espoir, non de la transformer à grands risques, mais de la prendre comme modèle pour mettre au point des procédés et des produits non polluants. C’est dans ce contexte que se développent des approches comme celle du bio mimétisme. Telle araignée fabrique des fils beaucoup plus résistants que ceux que nous parvenons à tirer du pétrole. Le nouveau défi de la science est d’apprendre à imiter la nature.
Il faut aussi retrouver le savoir en dialogue. Dans les sociétés traditionnelles le savoir progressait lentement pour bien des raisons et notamment parce qu’il dépendait du dialogue de l’artisan avec ses clients. Chaque fois qu’une barque de pêcheurs ne revenait pas à bon port, le menuiser qui l’avait fabriquée se demandait comment l’améliorer pour réduire les risques de naufrage.
Quand la science devint plus abstraite, les savants commencèrent à échanger de l’information entre eux plutôt qu’avec la population. L’homme d’affaires s’associa à leur aventure, les artisans disparurent, remplacés par les prolétaires, dont on pourrait dire qu’ils furent les ouvriers tenus hors du secret.
Tout progressa ainsi beaucoup plus vite, mais au prix de décisions, comme celle de laisser se multiplier les automobiles, qu’une population responsable et éclairée aurait sans doute empêchée. S’il a été possible et même facile de prendre ainsi toutes les mauvaises décisions qui ont mis la santé de la planète en péril, seul un retour au savoir en dialogue permettra de redresser la situation.
- Au début, vous avez évoqué votre famille spirituelle, mais vous n’avez pas eu le temps de présenter votre définition de la philosophie…
La philosophie est essentiellement la combinaison de deux choses : la rigueur dans la conduite de la raison et la purification personnelle, qui est une rigueur dans la conduite de la vie. Une personne cultivée, pour moi, est une personne qui devient meilleure au contact des choses de l’esprit. La vie intellectuelle, c’est la vie tout court. Parmi les plus belles choses que je tiens de Simone Weil, c’est l’utilisation de la photosynthèse comme métaphore pour la vie spirituelle et intellectuelle. Devenir meilleur au contact des choses de l’esprit comme les plantes croissent au contact de la lumière. C’est comme cela que je vois et vis les choses littéralement. La vie intellectuelle suppose, comme la nature, un certain nombre de rites dans l’art de vivre : du temps, du silence, du recueillement, de la compagnie mais quand il faut, et de l’émulation dans le sens le plus noble du terme.
Il y a une autre image que j’aimerais développer : l’humus intérieur. Les poèmes que l’on apprend, les musiques et les conversations approfondies dont on s’imprègne, tout cela a pour effet d’enrichir l’humus dont on va tirer des images pour former ensuite une pensée. Ce que j’ai observé au Québec et qui m’a paru douloureux par moment, c’est que, pour des raisons qui tiennent à notre histoire, l’intégration de la culture à la vie ne s’est pas toujours bien faite. Assez souvent, des gens savent une foule de choses qui ne sont pas intégrées entre elles et qui ne sont pas intégrées en eux. Ils ont leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et quelque chose en marge qui est la culture.
Or, la vie de l’esprit, c’est la fine fleur de la vie. La culture, bien comprise, fait partie du grand milieu vivant. Il faut apprendre des poèmes par cœur. Nietzsche disait « Ce qui a été créé avec le sang mérite d’être appris par cœur ».
Les poèmes, la contemplation des œuvres d’art et des paysages, la joie que l’on en retire ne sont pas des choses qui sont données. Ce sont des choses qui se cultivent. Comment? Par le contact avec les grandes œuvres, pas autrement.
Pour revenir au Québec, je n’ai pas connu le Québec prolétaire. Pour moi, à l’intérieur de l’âme québécoise, la grande division est là. Je suis né dans un milieu ni pauvre ni riche. Assez riche pour jouir de la vie, assez pauvre pour ne pas nous perdre dans la consommation. Dans le milieu agricole, dans notre village de la région de Lanaudière, nous avons été épargnés. Nous étions entourés d’agriculteurs, d’hommes libres. Je n’ai pas vu, comme l’a vécu Fernand Dumont par exemple, ce que c’était un homme qui rentrait chez lui brisé par le patron. Mon grand-père avait construit un patrimoine, c’est ce qui m’a permis d’étudier. Il a vécu pour le très long terme. Et en réussissant mes études, j’avais le sentiment que c’est mon grand-père qui réussissait!
- Je voudrais revenir sur votre ouvrage publié en 1998, Après l’humain, le cyborg? Vous étiez alors quelques années en avance sur la réflexion actuelle qui porte sur le post-humain.
L’idée de mon livre a pris forme à la suite des recherches que nous avions faites sur l’inforoute et en continuité avec la pensée de Klages, le plus grand héritier philosophique du romantisme allemand. En 1930, il a occupé la chaire de Hegel à Berlin. Il avait déjà publié L’homme et la terre, en 1913. Il a influencé Max Scheler. Il a été connu du grand public pour ses travaux en graphologie. L’écriture était pour lui la trace immobile des mouvements de l’âme. Mais il est surtout le critique le plus radical de la conception mécaniste du monde. Il y a une conception de la vie qui est propre au romantisme allemand, une des seules philosophies qui ne viennent pas de la Grèce ou de Rome. Pour schématiser beaucoup la philosophie de Klages, je dirai qu’il oppose l’âme à l’esprit, l’esprit étant l’instrument de la saisie intellectuelle. Dans l’idée de saisie, il y a une violence faite au réel. Mais pour Klages, la connaissance est un enfantement. Il explique l’histoire comme la vampirisation de la vie par l’esprit. Il s’est penché sur la montée du formalisme depuis trois siècles. Son premier exemple est la Bourse, on y échange des valeurs sans tenir compte de la réalité : des êtres humains qui vont perdre leur emploi. Dès 1905, Klages avait écrit un texte prophétique; simplement par l’analyse de la montée du formalisme dans le monde, il a prévu l’ordinateur, l’avènement d’un automate qui ferait toutes les opérations de l’esprit. Il l’appelait le parfait formaliste.
Dans mon livre, j’ai montré tout ce qui conspirait à nous faire dériver vers le post-humanisme. J’ai réfléchi sur le fait que la connaissance immédiate est discréditée au profit d’une connaissance plus formelle. Cela aboutit à un homme si complètement coupé de la nature qu’il est désormais assimilé par les médias électroniques. À la fin, j’ai retrouvé un ouvrage de Thibon, Vous serez comme des Dieux. Dans les années 1950, Thibon avait lui aussi écrit un texte futuriste en partant des informations d’un ami biologiste qui prévoyait la fabrication des clones. L’univers qu’il évoque, c’est le meilleur des mondes. C’est le rêve millénariste selon lequel on fera le paradis sur Terre. En somme, le cyborg, c’est l’achèvement de l’homme progressiste...
- En terminant, parlons éducation. Vous prenez parfois des positions controversées, pour ne pas dire de droite. Vous semblez défendre inconditionnellement l’école privée. Que répondez-vous à vos détracteurs?
Je ne serai, je n’ai jamais été un homme de droite au sens habituel du terme. Quand je dis qu’il faut privatiser les écoles publiques, je sais que j’ai l’air d’un hurluberlu d’extrême droite, mais je veux seulement dire que les écoles secondaires devraient avoir l’autonomie des cégeps. Il faut simplement faire disparaître les commissions scolaires. Donnons aux écoles le statut des cégeps. Le cégep du Vieux-Montréal est dans le même quartier que des écoles en difficulté. Il s’est tiré d’affaire, il s’est fait une réputation. Il avait l’autonomie, cette capacité de créer des programmes nouveaux. Le cégep de Jonquière attire des étudiants de tout le Québec en communication, les cégeps de Lionel-Groulx et de St-Hyacinthe en attirent en théâtre, etc. Cette merveilleuse liberté, j’aimerais que les écoles secondaires puissent l’acquérir!